 This Machine Kills Fascists…
This Machine Kills Fascists…
Quand, dans le Monde diplomatique il est question du numérique en général et du Libre en particulier il y a de bonnes chances pour que l’article soit signé Philippe Rivière (alias Fil) et ce depuis près de quatorze ans.
Il faut dire qu’être l’un des papas de SPIP lui donne une certaine expérience, pour ne pas dire une expérience certaine.
Il a publié en juillet dernier, dans le magazine culturel en ligne Rictus.info, un papier qui synthétise bien la situation et que nous aimerions plus encore faire connaître, d’où cette reproduction.
« Il faut inventer un autre modèle, et pour cela, personne ne sait encore s’il faudra casser l’ancien, ou s’il saura s’adapter. »
« Chanter sans autorisation » : introduction aux enjeux du libre
URL d’origine du document (Rictus.info)
Philippe Rivière – juillet 2012 – Licence Creative Commons By-Sa
À l’occasion des Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, nous avons demandé à Philippe Rivière[1], de nous faire un petit tour d’horizon de la question du logiciel libre. Exposé des forces en présence et des enjeux.
Un peu de musique
Au début des années 1940, sur ses premiers disques, le compositeur américain Woody Guthrie avait fait inscrire la mention suivante sous le titre Copyright Warnings :
« Cette chanson est protégée aux États-Unis sous le sceau du copyright #154085 pour une période de 28 ans, et toute personne prise à la chanter sans autorisation sera mon meilleur ami, car je n’en ai rien à fiche. Publiez-la. Ecrivez-la. Chantez-la. Dansez dessus. Yodelez-la. Je l’ai écrite, c’est tout ce que je voulais faire. »
Aujourd’hui, chaque fois que vous insérez un film dans votre lecteur DVD, vous devez endurer une très longue présentation avec des écrans affreux du style :
« WARNING. La reproduction ou la redistribution non autorisée de cette œuvre copyrightée est illégale. Une violation criminelle de ce copyright, même sans gain monétaire, sera suivie d’une enquête du FBI et est punissable d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans dans une prison fédérale, et d’une amende de 250 000 dollars »
Drôle de manière de vous remercier d’avoir acheté le DVD.
Dans l’informatique, c’est la même chose : les auteurs de logiciels ont deux possibilités pour s’adresser à leur public — c’est-à-dire les utilisateurs ; soit ils leur font signer une clause légale expliquant qu’il faut faire très attention à d’utiliser le logiciel comme il convient, si on veut avoir quelques chances de ne pas aller en prison. Soit ils leur disent : que toute personne prise à jouer avec ce logiciel comme elle l’entend sera mon meilleur ami !
Dans le premier cas, on parle de logiciel propriétaire (ou privateur), dans le second, de logiciel libre.
Logiciel capturé
Le logiciel n’est pas né en cage. Les premiers programmes étaient comme des formules de maths ou des recettes de cuisine : en dollars, ils ne valaient rien, puisqu’on les donnait avec la machine — qui, elle, coûtait très cher.
Comme l’écrit Lawrence Lessig, un juriste américain spécialisé dans le droit d’auteur :
« Vous ne pouviez pas faire tourner un programme écrit pour une machine Data General sur une machine IBM, donc Data General et IBM ne se préoccupaient pas de contrôler leur logiciel. »
Mais bien évidemment leur valeur était énorme, puisque sans programmes, l’ordinateur se limitait à allumer un C> clignotant sur un écran noir… Ce qu’un certain Bill Gates avait bien compris, c’est que le contrôle du logiciel permet de mettre la main sur l’ensemble du dispositif : IBM, la gigantesque firme américaine, ne l’avait pas compris. Elle voulait vendre des ordinateurs personnels, et se fichait bien de savoir ce qui fonctionnerait dessus : pressée d’arriver sur le marché, elle y a installé MS-DOS, un logiciel fourni par le jeune Bill Gates… on sait ce qu’il est advenu de ce choix : Microsoft, l’éditeur de MS-DOS, est rapidement devenu le plus gros éditeur de logiciels, et continue aujourd’hui à prélever une rente énorme sur l’ensemble des usages de l’informatique.
Free Software Foundation et licence GPL
De son côté, un certain Richard Stallman, chercheur au MIT, à Boston, s’était habitué, comme tous les informaticiens des années 1970, à bidouiller les programmes qui se trouvaient sur ses machines, pour les améliorer ou les adapter à la configuration de son matériel. Ça faisait partie de la normalité dans l’informatique, et encore plus dans le monde universitaire ; il aimait le sens de la communauté qui se développait autour de la programmation. Des échanges d’astuces, des concours pour être le premier à trouver une solution, etc.
Mais un jour, il s’aperçut que le code du logiciel pilote d’une imprimante n’était pas livré avec la machine, et qu’il ne pouvait donc pas le modifier — seulement le faire tourner, sans savoir ce qui était programmé exactement. S’il y avait un bug, il fallait contacter l’éditeur pour signaler le problème, et attendre une hypothétique nouvelle version… qui viendrait sans doute plus tard, et qu’il faudrait, en plus, à nouveau payer. On était au début des années 1980. Ce genre de choses commençait à se répandre, et Stallman comprit que les logiciels, qui étaient nés libres, ne le resteraient pas si personne ne les défendait. Il faudrait les protéger, sur le plan légal ; et les structurer d’une manière efficace. Il décida d’en faire son combat.
En 1984, Stallman démissionna du MIT (pour ne pas avoir de liens hiérarchiques qui pourraient lui coûter son indépendance), et fonda le projet GNU, puis la Free Software Foundation. D’un côté, un projet technique, consistant à fabriquer un système d’exploitation totalement libre — c’est-à-dire sans aucun composant propriétaire. De l’autre, une fondation dédiée à la protection du logiciel libre.
Il écrivit de nombreux logiciels (le plus connu est peut-être l’éditeur de texte Emacs). Et en parallèle, fit un travail juridique qui aboutit à la Licence publique générale GNU, la « GPL ». Elle est nettement moins « fun » que la licence de Woody Guthrie, mais elle garantit à tout utilisateur :
- le droit d’utiliser le logiciel pour faire ce qu’il veut
- le droit de lire le code source du logiciel, c’est-à-dire les éléments qui permettent de comprendre ce qu’il fait
- le droit de modifier ce code source
- le droit de redistribuer le logiciel ainsi que les versions modifiées.
Pour bénéficier de cela, l’utilisateur s’engage en échange à passer ces mêmes droits aux personnes à qui il le redistribue.
Bien sûr, tout le monde n’a pas forcément envie d’aller modifier le code… mais savoir que quelqu’un peut le faire, c’est avoir une certaine garantie.
Pour une entreprise, par exemple, c’est l’assurance que, si on n’est pas satisfait du prestataire à qui on a demandé de programmer quelque chose, ou s’il disparaît, on pourra légalement aller en voir un autre sans devoir repartir de zéro. C’est important.
Libertés pour l’utilisateur
Pour un particulier, on peut apprécier le fait que les logiciels libres sont souvent gratuits, ou en tous cas moins chers que les logiciels propriétaires. Cela dit, il ne faut pas confondre libre et gratuit ; « free » software, c’est « free » comme « freedom », pas comme « free beer ». Il y a des logiciels gratuits qui ne sont pas libres. Et, vice versa, pour développer un logiciel libre il faut quand même parfois que quelqu’un travaille…
Mais le plus important, pour l’utilisateur, n’est pas dans la gratuité : c’est que l’informatique touche de plus en plus aux libertés quotidiennes. Sur l’ensemble de la planète, à part quelques irréductibles hommes des cavernes, chacun porte en permanence sur soi un mouchard qui signale à tout instant où il se trouve précisément. Ce mouchard, cinq milliards d’humains en sont équipés. Il sert, parfois, à téléphoner…
L’informatique est aussi dans les voitures ; bientôt dans les frigos ; dans les habits, avec les puces RFID ; dans les passeports biométriques ; dans les cartes d’électeur – les machines à voter ! – ; il faut aller sur Internet pour voir les notes de collège de ses enfants ; on parle de numériser toutes les données de santé dans un « dossier médical personnel » accessible sur Internet (certains l’appellent dossier médical « partagé », car il est tout de même difficile à l’heure de WikiLeaks de prétendre qu’on saura empêcher le piratage…).
Discuter, s’informer, créer, partager, faire de la politique… tout ça est en train de s’informatiser, et si on ne contrôle pas collectivement les machines autour desquelles se construit de plus en plus la vie sociale, ce sont les machines qui nous contrôleront … ou plus exactement, ceux qui les programment.
Un seul exemple : vous avez entendu parler de Kindle, le livre électronique vendu par Amazon.com ; c’est génial, vous pouvez acheter et télécharger des dizaines de livres, et les lire sur un petit écran. Un jour donc, en juillet 2009, les commerciaux d’Amazon s’aperçoivent qu’ils ont fait une boulette dans leur offre : ils ont vendu électroniquement un livre pour lequel ils ne disposaient pas des droits de reproduction.
Ni une ni deux, que font-ils ? Ils attendent que les Kindle des clients se connectent, et leur envoient l’instruction d’effacer le livre. De quel livre s’agit-il ? « 1984 », de George Orwell, le livre qui décrit Big Brother et la police de la pensée !
Succès ou échec ?
Je ne vais pas énumérer les succès du logiciel libre : en 1990, un étudiant en informatique de l’université de Helsinki, Linus Torvalds, aimerait bien utiliser chez lui le programme sur lequel il travaille à l’université, un « noyau ». Il repart donc de zéro et crée son propre « noyau », qu’il place sans guère y accorder de réflexion sous la licence GPL. Ce sont les débuts d’Internet dans les facs, et rapidement ce noyau se développe ; comme Stallman avait développé de nombreux morceaux de code de GNU, mais pas encore de noyau, les deux projets cohabitent et donnent naissance à ce qu’on appelle maintenant GNU/Linux.
Les logiciels libres sont partout ; ils font tourner des ordinateurs personnels, et l’essentiel d’Internet. Ils sont dans les labos de recherche, les entreprises, etc.
Et il n’y a pas que la GPL. D’autres licences libres existent, qui permettent parfois plus de souplesse, moins de contrainte pour des utilisateurs qui modifient le code pour l’utiliser dans des projets fermés. Pour des textes ou des photos, on peut préférer des licences comme les Creative Commons. Pour des librairies (morceaux de code qui peuvent servir de fondation à des logiciels plus élaborés), on peut exiger que toute modification de la librairie soit libre, mais sans exigence sur les logiciels élaborés en question. D’autres font des licences plus proches de celle de Woody Guthrie (« je m’en fiche »), comme la licence MIT, ou encore la WTFPL (Do What The Fuck You Want To Public License / licence publique rien à branler).
A l’heure actuelle, les smartphones sont dominés par deux systèmes : Apple iOS et Google Android, qui sont basés sur des logiciels libres. Bien sûr chez Apple, les logiciels ne sont pas du tout libres ; mais ils sont construits sur une fondation totalement libre, NetBSD. Quant à Android, il est tellement bardé de brevets qu’il n’est pas non plus vraiment libre. Mais enfin, il contient beaucoup de logiciels libres.
En termes quantitatifs, on peut parler d’un succès : ce qui était perçu par les médias comme « marginal » est désormais au centre du tissu économique et du développement de l’informatique.
D’après une étude publiée en 2010[2] : Le secteur est estimé à 1,5 milliard d’euros en France, avec un taux de croissance moyen de 17 % (par an). Environ la moitié des directeurs informatiques interrogés lors de l’étude ont déclaré utiliser des logiciels libres et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise.
La guerre contre le libre
Il y a la menace juridique : en ce moment, c’est la guerre des brevets. Google a racheté en août 2011 le fabricant de téléphones portables Motorola pour 12,5 milliards de dollars, dans le but de mettre la main sur 25 000 brevets ! Or on dépose actuellement des brevets sur tout et n’importe quoi, avec des effets très curieux. Des menaces de procès et des bras de fer judiciaires qui aboutissent à des accords entre les grandes sociétés qui possèdent ces portefeuilles de brevets.
Enfin, il y a la menace plus directe de la prise de contrôle de l’ordinateur. Au nom bien entendu de votre sécurité. Par exemple, ce qu’on appelle « l’informatique de confiance », un terme censé nous rassurer, est une stratégie qui interdit à tout logiciel qui n’est pas reconnu et « signé » par une société comme Microsoft, ou Apple, de s’exécuter sur votre machine.
Ou encore, au nom de la protection des droits d’auteurs, la loi HADOPI qui nous impose l’obligation de « sécuriser notre réseau ». Alors que même l’armée américaine n’est pas capable d’empêcher des documents de « fuiter » !
Les iPhone sont eux-mêmes totalement verrouillés et il faut passer exclusivement par le magasin en ligne d’Apple pour modifier le logiciel (même si techniquement il reste possible de « jailbreaker », ce n’est pas autorisé par le constructeur).
Et je passe sur les projets qui se multiplient au nom de la lutte contre le piratage, contre la criminalité ou contre le terrorisme (SOPA, ACTA, HADOPI, LOPPSI, DMCA, etc), sans parler de la surveillance des communications qui se pratique plus ou moins illégalement et de façon massive[3]. Aux États-Unis, l’association des producteurs de musique, la MPAA, demande que ce qui marche en Chine (la « grande muraille électronique » qui permet au pouvoir de surveiller les internautes) soit appliqué à l’ensemble de l’Internet !
Pour la FSF : « Le logiciel libre permet d’avoir le contrôle de la technologie que nous utilisons dans nos maisons, nos écoles, nos entreprises, là où les ordinateurs travaillent à notre service et au service du bien commun, et non pour des entreprises de logiciels propriétaires ou des gouvernements qui pourraient essayer de restreindre nos libertés et de nous surveiller. »
Pour le romancier Cory Doctorow (et excellent blogueur), les États et les entreprises se préparent à une « guerre à venir sur la computation à but général », et « l’ordinateur dont le contrôle complet est accessible à l’utilisateur est perçu comme une menace pour l’ordre établi ».
Biens communs
Et puis il y a la propagande.
Aujourd’hui, les manifestants d’Occupy Wall Street, qui contestent le système capitaliste, sont traités de « terroristes ». Ce qui pourrait permettre à la police de les pister, de placer des mouchards dans leur ordinateur, etc.
Déjà Bill Gates en 2005 voyait des rouges partout :
« Il y a certains communistes d’un genre nouveau, cachés sous différents masques, qui veulent se débarrasser des mesures incitatives dont bénéficient les musiciens, les cinéastes et les créateurs de logiciels. »
J’avoue que je ne suis pas totalement choqué par cette critique. Elle est maligne, car parmi les auteurs de logiciels libres il y a beaucoup de gens qui ne sont pas particulièrement de gauche, et même des « ultra-capitalistes » comme se définit par exemple le leader du Parti pirate suédois, Rickard Falkvinge. Mais en effet, quand on crée du logiciel libre, quand on défend le partage de la culture sur Internet, quand on construit des sites sur le Web, on produit, collectivement, un bien public. Qui appartient à tout le monde, et où chacun va pouvoir venir puiser à sa guise, et utiliser ce que vous avez fait pour faire avancer ses propres projets. Le savoir, la culture sont cumulatifs, nous sommes « des nains sur des épaules de géants »[4].
Au-delà du logiciel libre, il faut réfléchir à l’ensemble des biens communs informationnels : la science, la culture, l’amusement, le logiciel dans tous les domaines… Internet permet de les diffuser, mais comment mobiliser des ressources pour les produire, et comment les défendre ? Certainement pas en les enfermant derrière des murs de paiement, des systèmes de DRM provoquant l’autodestruction des fichiers… Il faut inventer un autre modèle, et pour cela, personne ne sait encore s’il faudra casser l’ancien, ou s’il saura s’adapter.
Crédit photo : Woody Guthrie NYWTS (Wikimedia Commons)

 This Machine Kills Fascists…
This Machine Kills Fascists…

 Framasoft se présente volontiers comme un réseau de sites web visant à faire connaître et diffuser le logiciel libre. Sauf qu’en s’arrêtant là rien ne le distingue à priori des autres sites web comme celui du télé-achat de TF1 par exemple.
Framasoft se présente volontiers comme un réseau de sites web visant à faire connaître et diffuser le logiciel libre. Sauf qu’en s’arrêtant là rien ne le distingue à priori des autres sites web comme celui du télé-achat de TF1 par exemple.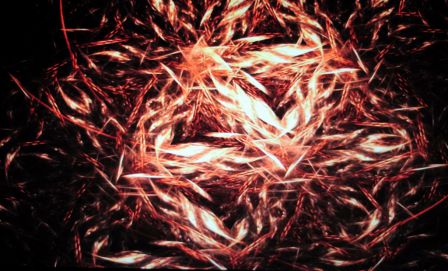

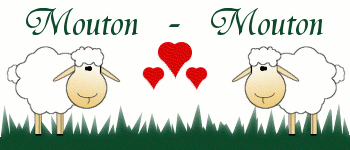
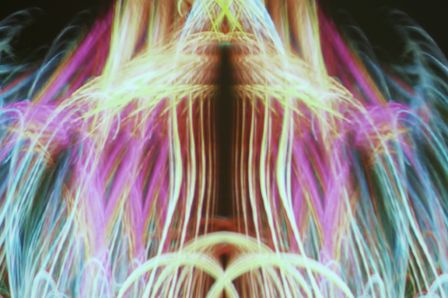
 À l’occasion de la sortie de Google Plus, on a beaucoup évoqué la question de l’identité numérique via le choix, imposé ou non, du pseudo ou du vrai nom (lire par exemple l’article d’Owni
À l’occasion de la sortie de Google Plus, on a beaucoup évoqué la question de l’identité numérique via le choix, imposé ou non, du pseudo ou du vrai nom (lire par exemple l’article d’Owni 