Pourquoi le logiciel libre est-il important pour moi ?
 Bruce Byfield est un journaliste américain que nous avons souvent traduit sur le Framablog.
Bruce Byfield est un journaliste américain que nous avons souvent traduit sur le Framablog.
Il nous livre ici une sorte de témoignage confession autour de cette simple question : Pourquoi le logiciel libre est-il important pour moi ? Une question qui, vers la fin, en cache une autre : Pourquoi le logiciel libre n’est-il pas important pour les autres ?
La réponse m’a alors fait fortement penser à l’Allégorie de la caverne de Platon parce que « pour une grande majorité, le Libre contraste tellement avec ce qu’ils connaissent qu’ils peinent à concevoir que cela existe »[1].
Mais je ne vous en dis pas plus…
Pourquoi les 4 libertés du logiciel sont plus importantes que jamais pour les Linuxiens
Why ‘Free as in Freedom’ is More Important Than Ever for Linux Users
Bruce Byfield – 17 novembre 2009 – LinuxPlanet.com
(Traduction Framalang : Don Rico)
Une marionnette heureuse de sa condition
La Free Software Foundation organise un concours de vidéos sur le thème « Pourquoi le logiciel libre est-il important pour vous ? » C’est une question qui tombe à point nommé, en raison, d’une part, de la récente sortie de Windows 7, et d’autre part des bisbilles au sein de la communauté du Libre qui ont tellement gagné en virulence que ses partisans semblent en passe d’oublier leur objectif commun.
Je n’ai pas le talent pour monter une vidéo, mais ce concours m’a poussé à m’interroger : Pourquoi le logiciel libre est-il important pour moi ? Pourquoi la plupart de ceux qui m’entourent s’en soucient comme d’une guigne ? Ces deux questions sont plus intimement liées qu’on pourrait le croire au premier abord.
Une changement de logiciel et de relations
À certains égards, il m’est plus facile d’expliquer ce qui ne présente pas d’intérêt pour moi dans le logiciel libre que ce qui en présente. Par exemple, le code que j’écris se limite à des modifications d’un code existant, aussi avoir accès au code source n’est pour moi qu’un avantage indirect.
De la même manière, être journaliste spécialisé dans le domaine du logiciel libre ne présente que peu de bénéfices pour moi. J’aurais davantage de débouchés et de lecteurs si j’écrivais des rubriques sur le matériel, Windows, et même OS X.
La gratuité du logiciel m’importe peu elle aussi, car depuis des années je peux défalquer le prix des logiciels acquis de ma déclaration de revenus. D’ailleurs, utiliser des logiciels libres et gratuits est même un désavantage lorsque je déclare mes impôts, car j’ai moins de frais professionnels à déduire.
Je ne peux même pas avancer l’argument que je voue une vive haine à Microsoft – mon sentiment envers cette entreprise est plus une grande méfiance et le désir d’avoir le moins possible affaire à elle.
Microsoft a néanmoins contribué à me pousser vers le logiciel libre. Un mois à peine après l’acquisition de ma première machine, je pestais déjà contre les carences du DOS, que j’ai remplacé par 4DOS. 4DOS était alors un partagiciel (à l’époque, quasi personne ne connaissait l’existence des logiciels libres) et ses fonctionnalités plus riches m’ont appris que le prix de vente d’un programme n’avait rien à voir avec sa qualité.
C’est aussi cette recherche de qualité qui m’a conduit à préférer OS/2 à Windows 3.0, et à vouloir être en mesure de bidouiller mes logiciels.
L’abandon d’OS/2 par IBM sous la pression de Microsoft m’a fourni un enseignement supplémentaire : je ne pouvais compter sur une entreprise commerciale pour protéger mes intérêts en tant que client. Lorsque j’ai découvert le logiciel libre, je me suis aussitôt rendu compte que mes intérêts en tant qu’utilisateur seraient sans doute mieux protégés par une communauté. Au moins, la mise à disposition du code source réduisait les risques que l’on cesse de veiller à mes intérêts.
Au cours des dix dernières années, l’évolution du monde des affaires et de la technologie n’a fait que renforcer ces convictions. À une époque où primait le bon sens, les ordinateurs et internet auraient été construits à partir de standards élaborés de façon collaborative et soumis à la régulation des pouvoirs publics, comme la télévision et la radio l’ont été au Canada et en Europe. Hélas, l’informatique et l’internet étant apparus à l’ère où dominait le conservatisme américain, ils ont été développés pour leur majeure partie par des entreprises privées.
Le résultat ? Qualité discutable, obsolescence programmée, et absence quasi totale de contrôle par l’utilisateur. Les utilisateurs de Windows et de Mac OS X ne possèdent même pas les logiciels qu’ils achètent, on leur accorde seulement un licence pour les utiliser. D’après les termes de ces licences, ils n’ont même pas le droit de contrôler l’accès que peuvent avoir Microsoft ou Apple à leur matériel ou à leurs données.
Du point de vue du consommateur, une telle situation serait inacceptable avec n’importe quel appareil. Qui tolérerait pareilles restrictions si elles s’appliquaient aux voitures ou aux cafetières électriques ?
La véritable liberté
Dans le domaine de l’informatique et de l’internet, pourtant, la situation est quasi catastrophique. Les ordinateurs pourraient être le plus formidable outil de tous les temps pour la promotion de l’éducation et de la liberté d’expression. De temps à autre, les entreprises propriétaires reconnaissent par un petit geste ce potentiel en créant des logiciels éducatifs ou en vendant leurs produits à bas prix aux pays en voie de développement.
Pourtant, dans la plupart des cas, ce potentiel n’est exploité au mieux qu’à 50% par les logiciels propriétaires. Leur coût élevé et l’absence de contrôle par l’utilisateur signifient que l’accès à ces outils reste bridé et filtré par leurs fabricants. À cause d’un hasard de l’Histoire, nous avons laissé des entreprises commerciales utiliser ces technologies, ce qui est bien sûr tout à fait acceptable, mais aussi avoir le contrôle sur tous ceux qui comme eux les utilisent.
Le logiciel libre, lui, reprend une partie de ce contrôle aux entreprises commerciales et rend l’informatique et internet plus accessibles à l’utilisateur moyen. Grâce aux logiciels libres, notre capacité à communiquer n’est plus restreinte par notre capacité financière à acquérir tel ou tel programme. Ce n’est pas la panacée, car le prix du matériel reste une barrière pour certains, mais il s’agit d’un pas de géant dans la bonne direction.
Pour résumer, le logiciel libre est une démocratisation d’une technologie privative. On retrouve cet esprit intrinsèque dans les communautés qu’il génère, dans lesquelles la norme est le bénévolat,le partage et la prise de décision collégiale. On le retrouve aussi dans l’utilisation de logiciels libres pour la création d’infrastructures dans les pays en développement, ou dans les initiatives que mènent l’Open Access Movement (NdT : Mouvement pour l’Accès Ouvert) pour affranchir les chercheurs universitaires des revues à accès restreint, de sorte que tout un chacun puisse les exploiter. En un mot, le logiciel libre, c’est un pas en avant pour atteindre les idéaux sur lesquels la société moderne devrait reposer.
On pourrait me rétorquer que d’autres causes, telles que la lutte contre la faim et la misère dans le monde, sont plus importantes, et je vous donnerais raison. Néanmoins, c’est une cause à laquelle je peux apporter ma modeste contribution. À mon sens, elle est non seulement importante, mais si essentielle pour les droits de l’homme et la liberté de la recherche que je peine à comprendre pourquoi elle n’est pas déjà universelle.
Hors du cadre de référence
Hélas, le logiciel libre ne peut se targuer que d’un nombre d’utilisateurs réduit, même si celui-ci augmente sans cesse. On cite souvent les monopoles, l’ampleur de la copie illégale, l’absence d’appui des constructeurs, les luttes intestines au sein des communautés et l’hostilité envers les non-initiés, pour expliquer pourquoi l’utilisation des logiciels libres n’est pas plus répandue. Toutes ces raisons jouent sans doute un rôle, mais je soupçonne les véritables causes d’être beaucoup plus simples.
« Je ne comprends pas qu’on puisse encore utiliser Windows », ai-je un jour grommelé en présence d’un ami. « Parce que c’est préinstallé sur tous les ordinateurs ? » a-t-il répondu. Il n’avait sans doute pas tort.
On pourrait penser que des gens qui passent de huit à quatorze heures devant leur machine souhaiteraient avoir davantage de contrôle sur elle. Mais il ne faut jamais sous-estimer la force de la peur du changement. Si les ordinateurs sont vendus avec un système d’exploitation préinstallé, la plupart des utilisateurs s’en accommodent, même s’ils passent leur temps à s’en plaindre ou à s’en moquer.
Je pense néanmoins que le frein principal à une adoption plus massive des logiciels libres est plus basique encore. Pour une grande majorité, le Libre contraste tellement avec ce qu’ils connaissent qu’ils peinent à concevoir que cela existe.
Le logiciel libre trouve son origine dans l’informatique universitaire des années 1960 et 1970, mais pour le plus grand nombre, l’histoire de l’informatique ne commence qu’avec l’apparition de l’ordinateur personnel sur le marché vers 1980.
Depuis, les logiciels sont avant tout des produits marchands, et le fait que les fabricants aient tout contrôle sur eux constitue la norme. Même si de temps à autre il arrive aux utilisateurs de râler, ils sont habitués à perdre les droits qui devraient être les leurs en matière de propriété dès qu’ils sortent leur logiciel de sa boîte.
De nombreux utilisateurs ignorent encore quels sont les objectifs du logiciel libre. Pourtant, s’ils sont un jour amenés à découvrir le logiciel libre, ils apprennent vite que ses aspirations sont radicalement différente.
Pour le mouvement du Libre, le logiciel n’est pas une marchandise mais un médium, comparable aux ondes télé ou radio, qui devrait être fourni à tous avec leur matériel informatique. Cette philosophie suggère que l’utilisateur moyen devrait être plus actif dans sa façon d’utiliser son ordinateur et modifier son rapport aux fabricants.
Face à des aspirations si opposées, quelle peut être la réaction de l’utilisateur moyen à part l’incompréhension et le rejet ? Il se peut que son premier réflexe consiste à penser que tout cela est trop beau pour être vrai. Il risque de ne pas croire à la façon dont sont conçus les logiciels libres, et craindre des coûts cachés ou la présence de logiciels malveillants. Cet utilisateur n’est pas près de prendre ces promesses pour argent comptant, et il n’y a rien d’étonnant à cela.
Le logiciel libre diffère tant des logiciels qu’il utilise depuis toujours qu’il n’a pas de cadre de référence. Le fait que le Libre offre plus de souplesse et plus de possibilité de contrôle qu’il n’en a jamais eu ne fait pas le poids contre l’incapacité de l’utilisateur à le rapprocher du reste de son expérience avec les logiciels. Plutôt que de de se jeter dans les bras du Libre, il risque de le rejeter par incompréhension.
Retour aux fondamentaux
Lors de mon premier contact avec le Libre, je l’ai considéré comme un phénomène isolé. Ses similitudes avec d’autres tendances ou mouvements historiques ne me sont apparues que plus tard. Aujourd’hui encore, il m’arrive de temps à autre de négliger trop facilement son importance, et je soupçonne qu’il en va de même pour de nombreux membres de la communauté.
Cette remarque s’applique surtout pour ceux qui se définissent comme partisans de l’Open Source, lesquels accordent de la valeur au logiciel libre principalement pour la qualité supérieure que permet le code ouvert. Ils oublient parfois, comme me l’a un jour confié Linus Torvalds, que ce confort accordé aux codeurs n’est qu’un moyen permettant d’accéder à la liberté de l’utilisateur.
Mais négliger l’importance du logiciel libre a un effet encore plus profond. Nous, qui appartenons à la communauté, sommes conscients de cette importance, mais nous la prenons souvent pour acquise. Pris dans notre routine, nous perdons de vue que ce qui nous semble normal peut se révéler déroutant et menaçant pour qui en entend parler pour la première fois.
Chaque année, le logiciel libre accomplit de nouvelles avancées. Quand je fais le point sur mes dix ans d’activité dans ce domaine, je suis souvent stupéfait par les progrès dont j’ai été témoin, à la fois concernant les logiciels eux-mêmes et le succès qu’ils remportent en dehors de la communauté. Néanmoins, le logiciel libre pourrait rencontrer le succès plus vite si ceux qui participent au mouvement se remémoraient plus souvent son importance et se rendaient compte du caractère déconcertant qu’il peut avoir pour les néophytes.
Notes
[1] Crédit photo : The unnamed (Creative Commons By-Sa)
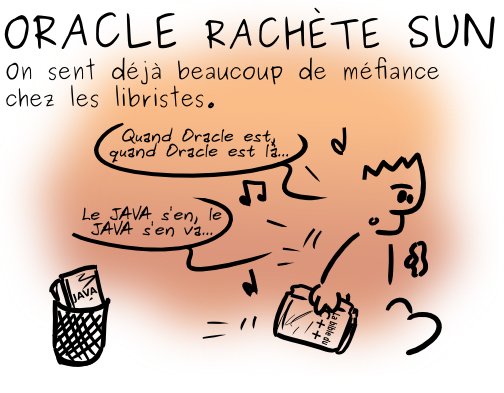


 Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons aujourd’hui une traduction qui non seulement ne parle pas de logiciel libre mais qui en plus provient de
Une fois n’est pas coutume, nous vous proposons aujourd’hui une traduction qui non seulement ne parle pas de logiciel libre mais qui en plus provient de  Ce matin je reçois dans ma boite aux lettres (électronique) un
Ce matin je reçois dans ma boite aux lettres (électronique) un  Quel est le dénominateur commun des récents évènements qui ont défrayé la chronique du Web ? L’absence de Microsoft.
Quel est le dénominateur commun des récents évènements qui ont défrayé la chronique du Web ? L’absence de Microsoft. On peut être éventuellement fiers d’exporter nos parfums et nos vins, mais certainement pas notre
On peut être éventuellement fiers d’exporter nos parfums et nos vins, mais certainement pas notre  La
La  Le site
Le site