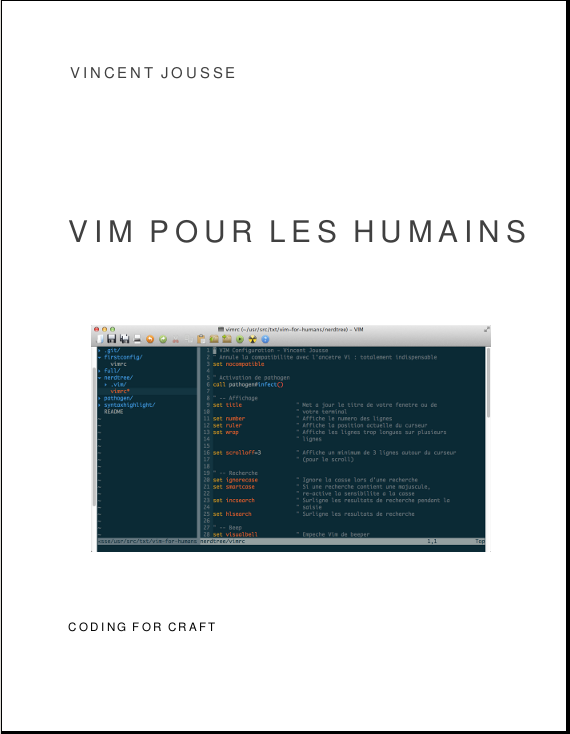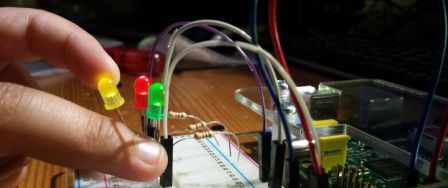Nous publions ci-dessous une tribune de Christophe Masutti, membre de Framasoft,
Elle paraît simultanément dans le magazine Linux Pratique, que vous trouverez dans tous les bons points presse et que nous remercions vivement pour son autorisation..

Internet. Pour un contre-ordre social
Christophe Masutti – Framasoft
19 juillet 2014
Ce document est placé sous Licence Art Libre 1.3 (Document version 1.0)
Paru initialement dans Linux Pratique n°85 Septembre/Octobre 2014, avec leur aimable autorisation
De la légitimité
Michel Foucault, disparu il y a trente ans, proposait d’approcher les grandes questions du monde à travers le rapport entre savoir et pouvoir. Cette méthode a l’avantage de contextualiser le discours que l’on est en train d’analyser : quels discours permettent d’exercer quels pouvoirs ? Et quels pouvoirs sont censés induire quelles contraintes et en vertu de quels discours ? Dans un de ses plus célèbres ouvrages, Surveiller et punir[1], Foucault démontre les mécanismes qui permettent de passer de la démonstration publique du pouvoir d’un seul, le monarque qui commande l’exécution publique des peines, à la normativité morale et physique imposée par le contrôle, jusqu’à l’auto-censure. Ce n’est plus le pouvoir qui est isolé dans la forteresse de l’autorité absolue, mais c’est l’individu qui exerce lui-même sa propre coercition. Ainsi, Surveiller et punir n’est pas un livre sur la prison mais sur la conformation de nos rapports sociaux à la fin du XXe siècle.
Les modèles économiques ont suivi cet ordre des choses : puisque la société est individualiste, c’est à l’individu que les discours doivent s’adresser. La plupart des modèles économiques qui préexistent à l’apparition de services sur Internet furent considérés, au début du XXIe siècle, comme les seuls capables de générer des bénéfices, de l’innovation et du bien-être social. L’exercice de la contrainte consistait à susciter le consentement des individus-utilisateurs dans un rapport qui, du moins le croyait-on, proposait une hiérarchie entre d’un côté les producteurs de contenus et services et, de l’autre côté, les utilisateurs. Il n’en était rien : les utilisateurs eux-mêmes étaient supposés produire des contenus œuvrant ainsi à la normalisation des rapports numériques où les créateurs exerçaient leur propre contrainte, c’est-à-dire accepter le dévoilement de leur vie privée (leur identité) en guise de tribut à l’expression de leurs idées, de leurs envies, de leurs besoins, de leurs rêves. Que n’avait-on pensé plus tôt au spectaculaire déploiement de la surveillance de masse focalisant non plus sur les actes, mais sur les éléments qui peuvent les déclencher ? Le commerce autant que l’État cherche à renseigner tout comportement prédictible dans la mesure où, pour l’un il permet de spéculer et pour l’autre il permet de planifier l’exercice du pouvoir. La société prédictible est ainsi devenue la force normalisatrice en fonction de laquelle tout discours et tout pouvoir s’exerce désormais (mais pas exclusivement) à travers l’organe de communication le plus puissant qui soit : Internet. L’affaire Snowden n’a fait que focaliser sur l’un de ses aspects relatif aux questions des défenses nationales. Mais l’aspect le plus important est que, comme le dit si bien Eben Moglen dans une conférence donnée à Berlin en 2012[2], « nous n’avons pas créé l’anonymat lorsque nous avons inventé Internet. »
Depuis le milieu des années 1980, les méthodes de collaboration dans la création de logiciels libres montraient que l’innovation devait être collective pour être assimilée et partagée par le plus grand nombre. La philosophie du Libre s’opposait à la nucléarisation sociale et proposait un modèle où, par la mise en réseau, le bien-être social pouvait émerger de la contribution volontaire de tous adhérant à des objectifs communs d’améliorations logicielles, techniques, sociales. Les créations non-logicielles de tout type ont fini par suivre le même chemin à travers l’extension des licences à des œuvres non logicielles. Les campagnes de financement collaboratif, en particulier lorsqu’elles visent à financer des projets sous licence libre, démontrent que dans un seul et même mouvement, il est possible à la fois de valider l’impact social du projet (par l’adhésion du nombre de donateurs) et assurer son développement. Pour reprendre Eben Moglen, ce n’est pas l’anonymat qui manque à Internet, c’est la possibilité de structurer une société de la collaboration qui échappe aux modèles anciens et à la coercition de droit privé qu’ils impliquent. C’est un changement de pouvoir qui est à l’œuvre et contre lequel toute réaction sera nécessairement celle de la punition : on comprend mieux l’arrivée plus ou moins subtile d’organes gouvernementaux et inter-gouvernementaux visant à sanctionner toute incartade qui soit effectivement condamnable en vertu du droit mais aussi à rigidifier les conditions d’arrivée des nouveaux modèles économiques et structurels qui contrecarrent les intérêts (individuels eux-aussi, par définition) de quelques-uns. Nous ne sommes pas non plus à l’abri des resquilleurs et du libre-washing cherchant, sous couvert de sympathie, à rétablir une hiérarchie de contrôle.
Dans sa Lettre aux barbus[3], le 5 juin 2014, Laurent Chemla vise juste : le principe selon lequel « la sécurité globale (serait) la somme des sécurités individuelles » implique que la surveillance de masse (rendue possible, par exemple, grâce à notre consentement envers les services gratuits dont nous disposons sur Internet) provoque un déséquilibre entre d’une part ceux qui exercent le pouvoir et en ont les moyens et les connaissances, et d’autre part ceux sur qui s’exerce le pouvoir et qui demeurent les utilisateurs de l’organe même de l’exercice de ce pouvoir. Cette double contrainte n’est soluble qu’à la condition de cesser d’utiliser des outils centralisés et surtout s’en donner les moyens en « (imaginant) des outils qui créent le besoin plutôt que des outils qui répondent à des usages existants ». C’est-à-dire qu’il relève de la responsabilité de ceux qui détiennent des portions de savoir (les barbus, caricature des libristes) de proposer au plus grand nombre de nouveaux outils capables de rétablir l’équilibre et donc de contrecarrer l’exercice illégitime du pouvoir.
Une affaire de compétences
Par bien des aspects, le logiciel libre a transformé la vie politique. En premier lieu parce que les licences libres ont bouleversé les modèles[4] économiques et culturels hérités d’un régime de monopole. En second lieu, parce que les développements de logiciels libres n’impliquent pas de hiérarchie entre l’utilisateur et le concepteur et, dans ce contexte, et puisque le logiciel libre est aussi le support de la production de créations et d’informations, il implique des pratiques démocratiques de décision et de liberté d’expression. C’est en ce sens que la culture libre a souvent été qualifiée de « culture alternative » ou « contre-culture » parce qu’elle s’oppose assez frontalement avec les contraintes et les usages qui imposent à l’utilisateur une fenêtre minuscule pour échanger sa liberté contre des droits d’utilisation.
Contrairement à ce que l’on pouvait croire il y a seulement une dizaine d’années, tout le monde est en mesure de comprendre le paradoxe qu’il y a lorsque, pour pouvoir avoir le droit de communiquer avec la terre entière et 2 amis, vous devez auparavant céder vos droits et votre image à une entreprise comme Facebook. Il en est de même avec les formats de fichiers dont les limites ont vite été admises par le grand public qui ne comprenait et ne comprend toujours pas en vertu de quelle loi universelle le document écrit il y a 20 ans n’est aujourd’hui plus lisible avec le logiciel qui porte le même nom depuis cette époque. Les organisations libristes telles la Free Software Foundation[5], L’Electronic Frontier Foundation[6], l’April[7], l’Aful[8], Framasoft[9] et bien d’autres à travers le monde ont œuvré pour la promotion des formats ouverts et de l’interopérabilité à tel point que la décision publique a dû agir en devenant, la plupart du temps assez mollement, un organe de promotion de ces formats. Bien sûr, l’enjeu pour le secteur public est celui de la manipulation de données sensibles dont il faut assurer une certaine pérennité, mais il est aussi politique puisque le rapport entre les administrés et les organes de l’État doit se faire sans donner à une entreprise privée l’exclusivité des conditions de diffusion de l’information.
Les acteurs associatifs du Libre, sans se positionner en lobbies (alors même que les lobbies privés sont financièrement bien plus équipés) et en œuvrant auprès du public en donnant la possibilité à celui-ci d’agir concrètement, ont montré que la société civile est capable d’expertise dans ce domaine. Néanmoins, un obstacle de taille est encore à franchir : celui de donner les moyens techniques de rendre utilisables les solutions alternatives permettant une émancipation durable de la société. Peine perdue ? On pourrait le croire, alors que des instances comme le CNNum (Conseil National du Numérique) ont tendance à se résigner[10] et penser que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) seraient des autorités incontournables, tout comme la soumission des internautes à cette nouvelle forme de féodalité serait irrémédiable.
Pour ce qui concerne la visibilité, on ne peut pas nier les efforts souvent exceptionnels engagés par les associations et fondations de tout poil visant à promouvoir le Libre et ses usages auprès du large public. Tout récemment, la Free Software Foundation a publié un site web multilingue exclusivement consacré à la question de la sécurité des données dans l’usage des courriels. Intitulé Email Self Defense[11], ce guide explique, étape par étape, la méthode pour chiffrer efficacement ses courriels avec des logiciels libres. Ce type de démarche est en réalité un symptôme, mais il n’est pas seulement celui d’une réaction face aux récentes affaires d’espionnage planétaire via Internet.
Pour reprendre l’idée de Foucault énoncée ci-dessus, le contexte de l’espionnage de masse est aujourd’hui tel qu’il laisse la place à un autre discours : celui de la nécessité de déployer de manière autonome des infrastructures propres à l’apprentissage et à l’usage des logiciels libres en fonction des besoins des populations. Auparavant, il était en effet aisé de susciter l’adhésion aux principes du logiciel libre sans pour autant déployer de nouveaux usages et sans un appui politique concret et courageux (comme les logiciels libres à l’école, dans les administrations, etc.). Aujourd’hui, non seulement les principes sont socialement intégrés mais de nouveaux usages ont fait leur apparition tout en restant prisonniers des systèmes en place. C’est ce que soulève très justement un article récent de Cory Doctorow[12] en citant une étude à propos de l’usage d’Internet chez les jeunes gens. Par exemple, une part non négligeable d’entre eux suppriment puis réactivent au besoin leurs comptes Facebook de manière à protéger leurs données et leur identité. Pour Doctorow, être « natifs du numérique » ne signifie nullement avoir un sens inné des bons usages sur Internet, en revanche leur sens de la confidentialité (et la créativité dont il est fait preuve pour la sauvegarder) est contrecarré par le fait que « Facebook rend extrêmement difficile toute tentative de protection de notre vie privée » et que, de manière plus générale, « les outils propices à la vie privée tendent à être peu pratiques ». Le sous-entendu est évident : même si l’installation logicielle est de plus en plus aisée, tout le monde n’est capable d’installer chez soi des solutions appropriées comme un serveur de courriel chiffré.
Que faire ?
Le diagnostic posé, que pouvons-nous faire ? Le domaine associatif a besoin d’argent. C’est un fait. Il est d’ailleurs remarqué par le gouvernement français, qui a fait de l’engagement associatif la grande « cause nationale de l’année 2014 ». Cette action[13] a au moins le mérite de valoriser l’économie sociale et solidaire, ainsi que le bénévolat. Les associations libristes sont déjà dans une dynamique similaire depuis un long moment, et parfois s’essoufflent… En revanche, il faut des investissements de taille pour avoir la possibilité de soutenir des infrastructures libres dédiées au public et répondant à ses usages numériques. Ces investissements sont difficiles pour au moins deux raisons :
- la première réside dans le fait que les associations ont pour cela besoin de dons en argent. Les bonnes volontés ne suffisent pas et la monnaie disponible dans les seules communautés libristes est à ce jour en quantité insuffisante compte tenu des nombreuses sollicitations ;
- la seconde découle de la première : il faut lancer un mouvement de financements participatifs ou des campagnes de dons ciblées de manière à susciter l’adhésion du grand public et proposer des solutions adaptées aux usages.
Pour cela, la première difficulté sera de lutter contre la gratuité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la gratuité (relative) des services privateurs possède une dimension attractive si puissante qu’elle élude presque totalement l’existence des solutions libres ou non libres qui, elles, sont payantes. Pour rester dans le domaine de la correspondance, il est très difficile aujourd’hui de faire comprendre à Monsieur Dupont qu’il peut choisir un hébergeur de courriel payant, même au prix « participatif » d’1 euro par mois. En effet, Monsieur Dupont peut aujourd’hui utiliser, au choix : le serveur de courriel de son employeur, le serveur de courriel de son fournisseur d’accès à Internet, les serveurs de chez Google, Yahoo et autres fournisseurs disponibles très rapidement sur Internet. Dans l’ensemble, ces solutions sont relativement efficaces, simples d’utilisation, et ne nécessitent pas de dépenses supplémentaires. Autant d’arguments qui permettent d’ignorer la question de la confidentialité des courriels qui peuvent être lus et/ou analysés par son employeur, son fournisseur d’accès, des sociétés tierces…
Pourtant des solutions libres, payantes et respectueuses des libertés, existent depuis longtemps. C’est le cas de Sud-Ouest.org[14], une plate-forme d’hébergement mail à prix libre. Ou encore l’association Lautre.net[15], qui propose une solution d’hébergement de site web, mais aussi une adresse courriel, la possibilité de partager ses documents via FTP, la création de listes de discussion, etc. Pour vivre, elle propose une participation financière à la gestion de son infrastructure, quoi de plus normal ?
Aujourd’hui, il est de la responsabilité des associations libristes de multiplier ce genre de solutions. Cependant, pour dégager l’obstacle de la contrepartie financière systématique, il est possible d’ouvrir gratuitement des services au plus grand nombre en comptant exclusivement sur la participation de quelques uns (mais les plus nombreux possible). En d’autres termes, il s’agit de mutualiser à la fois les plates-formes et les moyens financiers. Cela ne rend pas pour autant les offres gratuites, simplement le coût total est réparti socialement tant en unités de monnaie qu’en contributions de compétences. Pour cela, il faut savoir convaincre un public déjà largement refroidi par les pratiques des géants du web et qui perd confiance.
Framasoft propose des solutions
Parmi les nombreux projets de Framasoft, il en est un, plus généraliste, qui porte exclusivement sur les moyens techniques (logiciels et matériels) de l’émancipation du web. Il vise à renouer avec les principes qui ont guidé (en des temps désormais très anciens) la création d’Internet, à savoir : un Internet libre, décentralisé (ou démocratique), éthique et solidaire (l.d.e.s.).
Framasoft n’a cependant pas le monopole de ces principes l.d.e.s., loin s’en faut, en particulier parce que les acteurs du Libre œuvrent tous à l’adoption de ces principes. Mais Framasoft compte désormais jouer un rôle d’interface. À l’instar d’un Google qui rachète des start-up pour installer leurs solutions à son compte et constituer son nuage, Framasoft se propose depuis 2010, d’héberger des solutions libres pour les ouvrir gratuitement à tout public. C’est ainsi que par exemple, des particuliers, des syndicats, des associations et des entreprises utilisent les instances Framapad et Framadate. Il s’agit du logiciel Etherpad, un système de traitement de texte collaboratif, et d’un système de sondage issu de l’Université de Strasbourg (Studs) permettant de convenir d’une date de réunion ou créer un questionnaire. Des milliers d’utilisateurs ont déjà bénéficié de ces applications en ligne ainsi que d’autres, qui sont listées sur Framalab.org[16].
Depuis le début de l’année 2014, Framasoft a entamé une stratégie qui, jusqu’à présent est apparue comme un iceberg au yeux du public. Pour la partie émergée, nous avons tout d’abord commencé par rompre radicalement les ponts avec les outils que nous avions tendance à utiliser par pure facilité. Comme nous l’avions annoncé lors de la campagne de don 2013, nous avons quitté les services de Google pour nos listes de discussion et nos analyses statistiques. Nous avons choisi d’installer une instance Bluemind, ouvert un serveur Sympa, mis en place Piwik ; quant à la publicité et les contenus embarqués, nous pouvons désormais nous enorgueillir d’assurer à tous nos visiteurs que nous ne nourrissons plus la base de données de Google. À l’échelle du réseau Framasoft, ces efforts ont été très importants et ont nécessité des compétences et une organisation technique dont jusque là nous ne disposions pas.
Nous ne souhaitons pas nous arrêter là. La face immergée de l’iceberg est en réalité le déploiement sans précédent de plusieurs services ouverts. Ces services ne seront pas seulement proposés, ils seront accompagnés d’une pédagogie visant à montrer comment[17] installer des instances similaires pour soi-même ou pour son organisation. Nous y attachons d’autant plus d’importance que l’objectif n’est pas de commettre l’erreur de proposer des alternatives centralisées mais d’essaimer au maximum les solutions proposées.
Au mois de juin, nous avons lancé une campagne de financement participatif afin d’améliorer Etherpad (sur lequel est basé notre service Framapad) en travaillant sur un plugin baptisé Mypads : il s’agit d’ouvrir des instances privées, collaboratives ou non, et les regrouper à l’envi, ce qui permettra in fine de proposer une alternative sérieuse à Google Docs. À l’heure où j’écris ces lignes, la campagne est une pleine réussite et le déploiement de Mypads (ainsi que sa mise à disposition pour toute instance Etherpad) est prévue pour le dernier trimestre 2014. Nous avons de même comblé les utilisateurs de Framindmap, notre créateur en ligne de carte heuristiques, en leur donnant une dimension collaborative avec Wisemapping, une solution plus complète.
Au mois de juillet, nous avons lancé Framasphère[18], une instance Diaspora* dont l’objectif est de proposer (avec Diaspora-fr[19]) une alternative à Facebook en l’ouvrant cette fois au maximum en direction des personnes extérieures au monde libriste. Nous espérons pouvoir attirer ainsi l’attention sur le fait qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux doivent afficher clairement une éthique respectueuse des libertés et des droits, ce que nous pouvons garantir de notre côté.
Enfin, après l’été 2014, nous comptons de même offrir aux utilisateurs un moteur de recherche (Framasearx) et d’ici 2015, si tout va bien, un diaporama en ligne, un service de visioconférence, des services de partage de fichiers anonymes et chiffrés, et puis… et puis…
Aurons-nous les moyens techniques et financiers de supporter la charge ? J’aimerais me contenter de dire que nous avons la prétention de faire ainsi œuvre publique et que nous devons réussir parce qu’Internet a aujourd’hui besoin de davantage de zones libres et partagées. Mais cela ne suffit pas. D’après les derniers calculs, si l’on compare en termes de serveurs, de chiffre d’affaire et d’employés, Framasoft est environ 38.000 fois plus petit que Google[20]. Or, nous n’avons pas peur, nous ne sommes pas résignés, et nous avons nous aussi une vision au long terme pour changer le monde[21]. Nous savons qu’une population de plus en plus importante (presque majoritaire, en fait) adhère aux mêmes principes que ceux du modèle économique, technique et éthique que nous proposons. C’est à la société civile de se mobiliser et nous allons développer un espace d’expression de ces besoins avec les moyens financiers de 200 mètres d’autoroute en équivalent fonds publics. Dans les mois et les années qui viennent, nous exposerons ensemble des méthodes et des exemples concrets pour améliorer Internet. Nous aider et vous investir, c’est rendre possible le passage de la résistance à la réalisation.