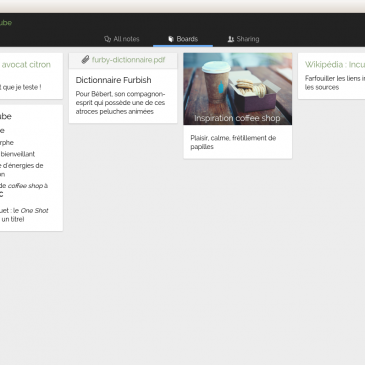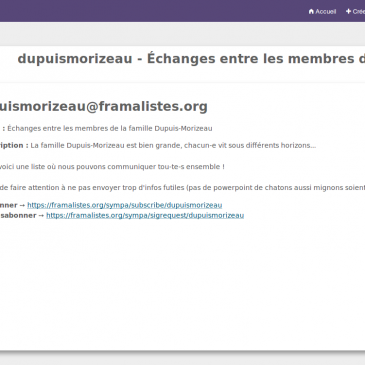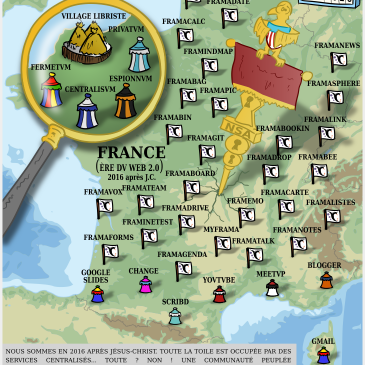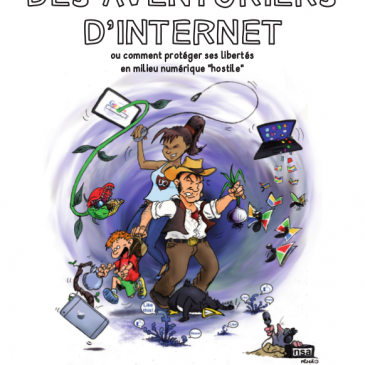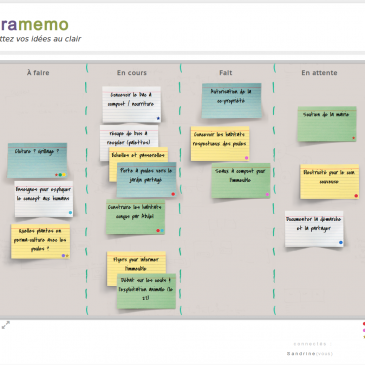Framaforms : n’offrez plus les réponses que vous collectez à Google !
Un formulaire d’inscription ? Une enquête en ligne ? Un questionnaire de satisfaction ? Bref : vous avez besoin de réaliser rapidement un questionnaire à diffuser en ligne et d’en collecter les réponses ?