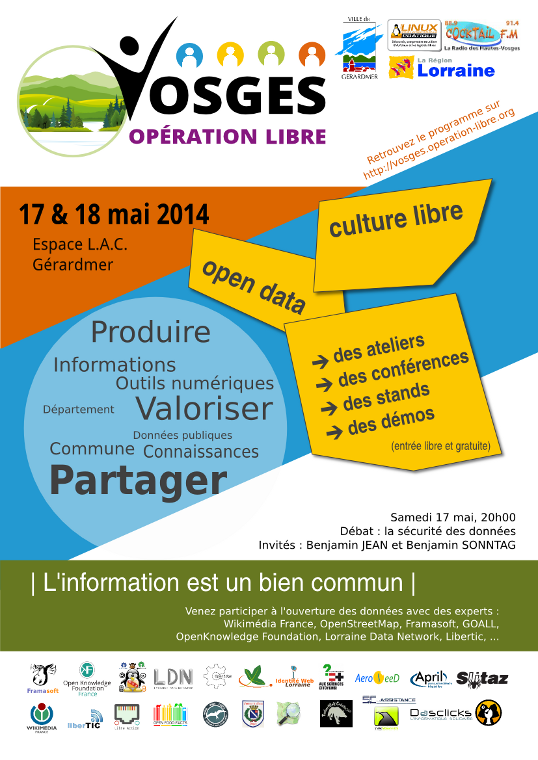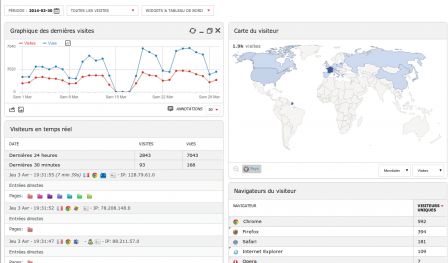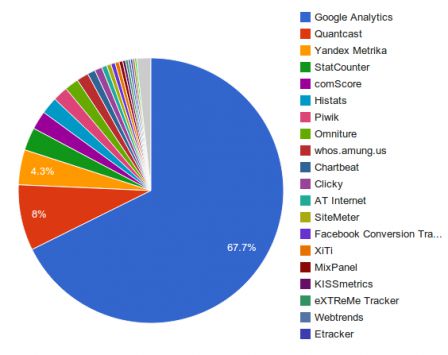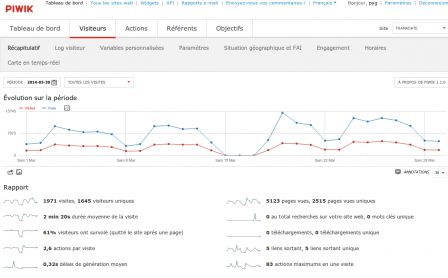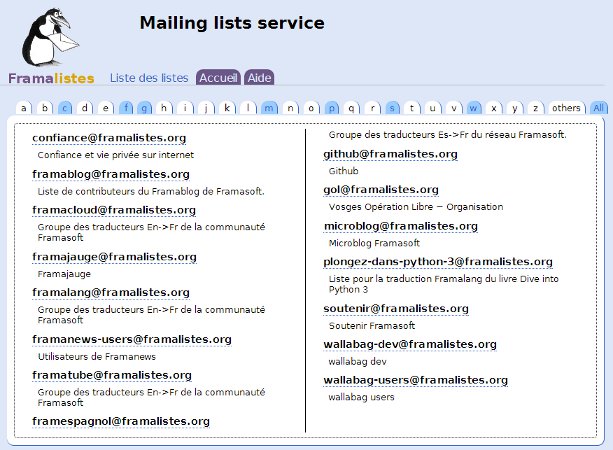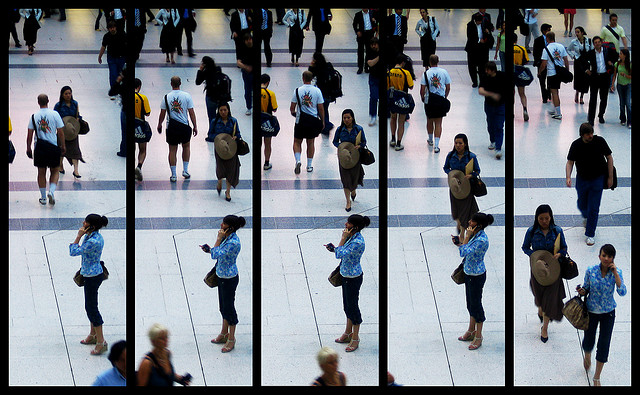« Le 12 mars 1989, Tim Berners-Lee propose un projet pour en finir avec certaines problématiques rencontrées lors du partage des informations au CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire). Sa proposition table sur la mise en place d’un système distribué s’appuyant largement sur les liens hypertexte. Comme on le sait, le principe a rencontré un succès tel qu’il a été généralisé les années suivantes pour toute sorte d’informations publiques. Le web était né. » (source PC Inpact)
Le problème c’est qu’envisagé au départ comme un bien commun à tous, il a subi depuis de nombreuses attaques de ce qu’on pourrait appeler « l’État/marché »…
Remarque : Ne pas confondre web et internet (le premier n’étant qu’une sous-partie du second).

Une Magna Carta en ligne : Berners-Lee en appelle à une déclaration des droits pour le web
Jemima Kiss – 12 mars 2014 – The Guardian
(Traduction : Penguin, Juliette, diab, Achille, Diin, goofy, lamessen, Kcchouette, Mooshka)
An online Magna Carta: Berners-Lee calls for bill of rights for web
L’inventeur du web nous met en garde sur le fait que la neutralité subit des attaques soutenues des gouvernements et des entreprises.
L’inventeur du World Wide Web croit qu’une « Magna Carta » en ligne à l’échelle mondiale est nécessaire afin de protéger et d’ancrer l’indépendance du moyen de communication qu’il a créé et les droits de ses utilisateurs.
Sir Tim Berners-Lee a déclaré au Guardian que le web a fait l’objet d’attaques croissantes de la part des gouvernements et d’influentes sociétés, et que de nouvelles règles s’imposaient pour protéger « l’ouverture et la neutralité » du système.
Parlant exactement 25 ans après qu’il a écrit la première ébauche de la première proposition de ce qui allait devenir le World Wide Web, l’informaticien a déclaré : « Nous avons besoin d’une constitution mondiale – une déclaration des droits ».
L’idée d’une Grande Charte de Berners-Lee s’inscrit dans le cadre d’une initiative appelée Le web que nous voulons, nous invitant à créer un projet de lois numériques dans chaque pays – principes qu’il espère soutenus par des institutions publiques, des fonctionnaires gouvernementaux et des entreprises.
« Sauf à avoir un Internet libre et neutre sur lequel nous pouvons nous appuyer sans nous soucier de ce qui se passe en coulisses, nous ne pouvons pas avoir un gouvernement ouvert, une bonne démocratie, un bon système de santé, des communautés reliées entre elles et une diversité culturelle. Ce n’est pas naïf de croire que l’on peut avoir cela, mais c’est naïf de penser que l’on peut l’obtenir en restant les bras croisés. »
Berners-Lee a été un critique virulent de la surveillance des citoyens américains et anglais à la suite des révélations faites par le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden. Compte tenu de ce qui a vu le jour, dit-il, les gens sont à la recherche d’une profonde révision dans la façon dont les services de sécurité ont été gérés.
Ses opinions font également écho dans l’industrie de la technologie, où il est particulièrement en colère sur les efforts fournis par la NSA et le GCHQ anglais pour saper les outils de sécurité et de cryptage – ce que beaucoup d’experts de sécurité affirment comme étant contre-productif et compromettant vis-à-vis de la sécurité de chacun.
Les principes de la vie privée, liberté d’expression et l’anonymat responsable seront étudiés dans cette Grande Charte. « Ces problèmes nous ont pris par surprise » a déclaré Berners-lee. « Nos droits sont bafoués de plus en plus souvent de tous les côtés et le danger est que nous nous y habituons. Je tiens donc à utiliser ce 25e anniversaire pour nous inviter à mettre la main à la pâte afin de reprendre la main et définir le web que nous voulons pour les 25 prochaines années. »
La proposition pour la constitution du web devrait aussi examiner l’impact des lois sur le copyright et les problèmes socio-culturels en rapport avec les éthiques de la technologie.
Alors que la régulation régionale et les sensibilités culturelles du web peuvent varier, Berners-Lee affirme croire en un document partagé sur les principes que pourrait apporter une norme internationale sur les valeurs d’un web ouvert.
Il demeure optimiste sur le le fait que cette campagne Le web que nous voulons puisse atteindre le grand public, malgré son manque apparent de prise de conscience dans l’affaire Snowden.
« Je ne dirais pas que les gens au Royaume-Uni sont indifférents. Je dirais qu’ils ont plus confiance en leur gouvernement que dans d’autres pays. Ils optent pour l’attitude : Comme nous avons voté pour eux, laissons les agir et faire leurs preuves. »
« Mais nous avons besoin que nos avocats et nos politiciens comprennent la programmation, comprennent ce qui peut être fait avec un ordinateur. Nous avons également besoin de revoir une grande partie de la législation, comme ces lois sur le copyright qui mettent les gens en prison pour protéger les producteurs de films. Il s’agit également de préserver et protéger l’expression des individus et la démocratie quotidienne dont nous avons besoin pour gérer le pays », poursuit-il.
Berners-Lee se prononce fermement en faveur du changement de l’élément à la fois clé et controversé de la gouvernance d’Internet qui supprimerait une petite, mais symbolique, partie du contrôle américain. Les États-Unis s’agrippent au contrat IANA, qui contrôle la base de données principale de tous les noms de domaines, mais ont fait face à une pression de plus en plus importante à la suite de l’affaire Snowden.
Il explique: « Notre demande du retrait du lien explicite menant vers la chambre du commerce des États-Unis est en souffrance depuis longtemps. Les États-Unis ne peuvent pas avoir une place prépondérante dans quelque chose qui n’est pas national. Il y a grand élan vers une séparation et une indépendance même si les États-Unis conservent une approche qui maintient les gouvernements et les entreprises à l’écart. »
Berners-Lee réitère aussi son inquiétude quant au fait que le web pourrait être balkanisé par des pays et des organisations qui morcelleraient l’espace numérique pour travailler selon leurs propres règles, qu’il s’agisse de censure, de régulation ou de commerce.
Nous avons tous un rôle à jouer dans ce futur, dit-il en citant les récents mouvements de résistance aux propositions de régulation du droit du copyright.
Il dit : « Le point-clé c’est d’amener les gens à se battre pour le web, de les amener à voir les dommages qui seraient causés par un web fracturé. Comme tout système humain, le web a besoin d’une régulation et bien-sûr que nous avons besoin de lois nationales, mais nous ne devons pas transformer le réseau en une série de cloisonnements nationaux. »
Berners-Lee fit également une apparition lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, en écrivant les mots “this is for everyone” (NdT : « Ceci est pour tout le monde ») sur un ordinateur au centre du stade. Il est demeuré fermement attaché au principe d’ouverture, d’inclusion et de démocratie depuis son invention du web en 1989, en choisissant de ne pas commercialiser son modèle. Il rejette l’idée qu’un contrôle gouvernemental ou commercial sur un moyen de communication aussi puissant soit inévitable, « Tant qu’ils ne m’auront pas ôté les mains du clavier, je continuerai à défendre cela. »
Le créateur du web accessible à tous
Ayant grandi dans le sud-ouest de Londres, Tim Berners-Lee était un fervent ferrovipathe, ce qui l’a amené à s’intéresser au modèle des chemins de fer puis à l’électronique.
Cela dit, les ordinateurs étaient déjà un concept familier dans la famille – ses deux parents ayant travaillé à la création du premier ordinateur commercialisé du monde, le Ferranti Mk1.
Berners-Lee sortit major de sa promotion en physique à Oxford et a ensuite travaillé à divers postes d’ingénieur. Mais ce fut au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève, qu’il prit part aux projets qui mèneront à la création du world wide web.
Son but était de permettre aux chercheurs du monde entier de partager des documents et ses premières propositions furent jugées « vagues mais intéressantes » par un directeur au CERN.
Il a combiné des technologies existantes telles que l’Internet et l’hypertexte pour produire un immense système interconnecté de stockage de documents. Berners-Lee l’appela le world wide web (NdT : la toile d’araignée mondiale), bien que ses collaborateurs francophones trouvaient cela difficile à prononcer.
Le web a d’abord été ouvert aux nouveaux utilisateurs en 1991. puis, en 1992, le premier navigateur a été créé pour parcourir et sélectionner les millions de documents déjà existants.
Bien que le web ait vu la création et la perte de fortunes innombrables, Berners-Lee et son équipe se sont assurés qu’il était libre d’utilisation pour tous.
Berners-Lee travaille maintenant, par le biais de diverses organisations, à s’assurer que le web soit accessible à tous et que le concept de neutralité du net soit respecté par les gouvernements et les entreprises.
Crédit photo : Wikimédia Commons