Cet article fait partie du dossier Wikipédia et éducation : un exemple de réconciliation.
C’est la traduction d’une interview du professeur et de trois de ses étudiantes parue dans la Gazette du Wikipédia anglais qui est ici présentée[1].
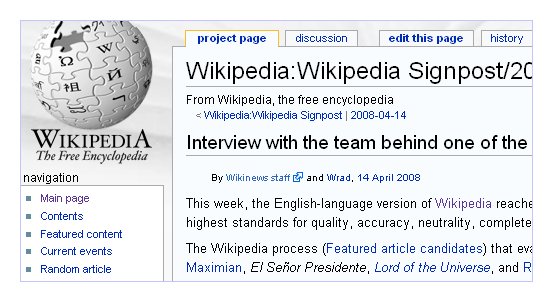
Rencontre avec l’équipe du 2000ème Article de Qualité
Wikinews interviews team behind the 2,000th featured Wikipedia article
Brian McNeil – 14 avril 2008 – Wikipedia Signpost
(Traduction Framalang : Olivier)
Cette semaine, la version anglaise de Wikipédia célèbre son 2000ème Article de Qualité avec l’accession à ce grade de l’article El Señor Presidente. Les Articles de Qualité (AdQ) sont les exemples de ce que Wikipédia a de mieux à offrir en termes de qualité, de précision, de neutralité, d’exhaustivité et de style, et sont par conséquent considérés comme les meilleurs articles sur Wikipédia.
Le système d’évaluation de Wikipédia (proposition d’Articles de Qualité) qui juge les candidatures a élevé cinq articles au rang d’Article de Qualité en même temps : Walter de Coventre, Maximian, El Señor Presidente, Lord of the Universe et Red-billed Chough. Lorsque cinq articles se voient simultanément attribuer cette distinction comment déterminer lequel est le 2000ème autrement qu’arbitrairement ? À vrai dire chacun de ces articles pouvait légitimement revendiquer cet honneur.
Ce qui démarque El Señor Presidente des autres est qu’il est le premier exemple connu d’Article de Qualité directement issu d’un projet pédagogique, le wikiprojet Madness, Murder, and Mayhem (NdT : Meurtre, Folie et Chaos). Jon Beasley-Murray, professeur de littérature espagnole à l’Université de la Colombie Britannique, a en effet décidé de demander à ses élèves de participer à Wikipédia plutôt que de rendre des dissertations classiques. Il leur a ainsi attribué un ensemble d’articles à créer sur la littérature espagnole. Et de la qualité de l’article dépendait la note finale, un Bon Article apportant un A à ses auteurs tandis qu’un Article de Qualité leur assurait un A+. La classe a reçu l’aide de la FA-team, un nouveau Wikiproject dont le but est d’aider les nouveaux wikipédiens à obtenir le statut d’Article de Qualité. Parmi les douze articles sélectionnés, huit ont atteint le grade de Bon Article et trois au total sont devenus des Articles de Qualité (Mario Vargas Llosa et The General in His Labyrinth ont obtenu leur distinction dans la foulée de El Señor Presidente). Au début du projet la plupart de ces articles ne figuraient pas dans l’encyclopédie et certains ont donc été créés pour l’occasion comme ce fut le cas pour El Señor Presidente.
L’idée de Beasly-Murray était de se servir de Wikipédia comme d’un espace collaboratif où ses étudiants pourraient à la fois travailler leur matière et fournir, en quelque sorte un service public virtuel. Il a donc initié un projet Wikipédia, Murder Madness and Mayhem, dans le but de créer ou bonifier des articles sur les ouvrages de littérature d’Amérique Latine étudiés dans son cours. El Señor Presidente est l’œuvre de l’écrivain guatémaltèque lauréat du prix Nobel Miguel Ángel Asturias. C’est donc sans surprise qu’il est vu comme l’un des titres majeurs de la littérature sud-américaine.
Beasley-Murray a décrit cette expérience dans un essai. Il y raconte comment ce devoir a permis aux étudiants d’améliorer leurs aptitudes de recherche et comment ils se sont adaptés au cas particulier de l’écriture à destination d’un large public. Wikipédia, dit-il, n’encourage pas le type d’écriture persuasive généralement demandée en université, mais c’est un très bon exercice de recherche où il faut faire preuve d’esprit critique. On notera que ce WikiProject a causé quelques remous dans certains forums Internet dédiés à l’éducation, comme dans ce message intitulé : « Est-ce que Murder, Madness and Mayhem représente le futur des études supérieures ? ».
Ce n’est pas le premier projet universitaire faisant partie d’un cursus. C’est en revanche le premier à rencontrer un tel succès. Par le passé, des projets semblables ont connu des destinées diverses et variées, certains n’apportant que peu d’informations aux pages concernées, d’autres étant carrément chaotiques, sans réelle gouvernance, ne montrant aucun respect pour les règles de Wikipédia et n’ayant pas vraiment d’autres consignes que « étoffez pour avoir une bonne note ». Ce projet a réussi là où d’autres ont échoué pour deux principales raisons : le leadership du professeur, Jbmurray et les conseils de la FA-Team qui a aidé les étudiants et leur professeur à se faire aux us et coutumes du site et autres bizarreries typiquement wikipédiennes.
L’équipe de Wikinews a contacté le professeur Beasley-Murray pour qu’il nous raconte plus en détails cette histoire dans une interview. Vous trouverez ses réponses ci-dessous. Elles sont complétées par les interventions de trois de ses étudiants qui ont participé à la création et à l’élévation de El Señor Presidente au rang d’Article de Qualité. En plus du 2000ème Article de Qualité, le projet a pour l’instant aussi donné naissance à sept Bons Articles.
Murder, Madness and Mayhem
Wikinews : Professeur Beasley-Murray, merci de nous accorder un peu de votre précieux temps et merci d’avoir accepté de nous rencontrer. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a conduit à initier ce projet ?
 Prof. Jon Beasley-Murray : En premier lieu, je voudrais dire que j’ai déjà écrit quelques réflexions à propos du projet sur Wikipédia même, c’est un essai que j’ai intitulé « Madness ».
Prof. Jon Beasley-Murray : En premier lieu, je voudrais dire que j’ai déjà écrit quelques réflexions à propos du projet sur Wikipédia même, c’est un essai que j’ai intitulé « Madness ».
Mais je peux vous en faire un résumé : j’ai fait quelques modifications sur Wikipédia il y a un an. J’ai commencé un peu par accident, après avoir découvert avec surprise qu’une partie de mes travaux universitaires se sont retrouvés sur le site. J’ai consacré un peu de temps à réorganiser et à étoffer des articles et des catégories liées à l’Amérique Latine, en particulier à la culture sud-américaine, qui est ma spécialité. J’ai découvert que la couverture de ce sujet sur Wikipédia était inégale, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est en m’engageant là dedans que j’ai pris conscience que des étudiants pourraient apporter une participation constructive au site. Ils se servent déjà de Wikipédia, pourquoi ne pas trouver une manière de les faire participer ? C’est là que j’ai réalisé que c’est seulement en contribuant à cette encyclopédie qu’on peut vraiment la connaître, mieux distinguer ses forces et ses faiblesses, mais surtout comprendre ce qui fait qu’elle est comme elle est.
En fait j’ai toujours été attiré par l’usage de la technologie dans l’enseignement : listes de diffusion, sites Web, etc. Mais je n’ai jamais été un grand fan des « technologies de l’éducation » et ses prgrammes comme WebCT que les élèves ne rencontrent qu’en classe. En créant une sorte ghetto pédagogique, les technologies de l’éducation semblent passer complètement à côté des possibilités les plus intéressantes et les plus passionnantes qu’offre Internet : l’ouverture sur le vaste monde qui existe en dehors de la salle de classe et la re-définition des liens, parfois fragiles, entre les enseignants (censés être des experts et des puits de savoir) et les étudiants (trop souvent considérés comme les destinataires passifs de ce savoir).
Globalement, le projet sur Wikipédia avait plusieurs avantages :
- faire mieux découvrir Wikipédia aux étudiants, un site important qu’ils emploient souvent (et trop souvent à mauvais escient);
- améliorer Wikipédia en créant du contenu nouveau sur des sujets encore incomplets;
- encourager les étudiants à créer quelque chose qui irradie au-delà du périmètre du cours, dans la sphère publique;
- leur donner des objectifs tangibles qui seraient jugés autrement que par mon point de vue professoral;
- changer leur approche de l’écriture en mettant en valeur l’importance de l’amélioration permanente;
- leur apprendre la recherche et comment utiliser et évaluer une source.
Avez-vous consulté d’autres universitaires ou des étudiants avant de lancer ce projet ?
JMB : Non, pas vraiment en fait. Peut-être aurais-je dû ! Mais j’ai évoqué cette idée l’été dernier avec un ami qui travaille dans les technologies de l’éducation à l’Université de Colombie Britannique qui m’avait déjà aidé par le passé à intégrer des blogs dans mes cours. Cet ami, Brian Lamb, s’est montré comme à l’accoutumée enthousiaste pour ce genre d’expérimentation. Il s’est renseigné pour savoir si des bourses allouées à ce type d’initiatives existaient, mais apparemment ce n’était pas le cas. J’ai malgré tout décidé de poursuivre mon idée en solo.
Et en janvier, au moment où le projet allait débuter, je me suis inscrit sur Wikipédia : Projets Pédagogiques. De nombreux autres projets y étaient déjà référencés, certains déjà achevés, d’autres encore en cours. Je me suis alors dit que je n’étais pas vraiment seul finalement et que mon projet n’était pas si innovant. Je ne me suis rendu compte à quel point notre projet était différent et ambitieux que bien plus tard : notre but était de créer des Articles de Qualité, douze si possible, alors qu’aucun autre projet pédagogique n’y était parvenu !
Je suppose que la communauté Wikipédia vous soutenait. Des personnes extérieures à cette communauté vous ont-elles adressé des critiques négatives ?
JMB : Non, mais comme je vous l’ai dit, je n’en ai parlé à quasiment personne.
Mais je voudrais quand même préciser qu’il ne fallait par prendre le soutien de la communauté Wikipédia pour argent comptant. Pour d’autres projets pédagogiques, la première réaction des wikipédiens n’était pas si favorable. C’est en partie dû au fait que les étudiants sont encouragés à créer un nouvel article sur ce qu’ils veulent et ceux-ci se retrouvent rapidement menacés de suppression. C’est aussi parce qu’ils écrivent leurs dissertations hors ligne puis les envoient, et évidemment le plus souvent elles ne respectent pas les règles en vigueur sur Wikipédia (celles sur les Travaux inédits par exemple). Ces articles se retrouvent très vite décorés de commentaires et les pages de discussion qui y sont associées sont remplies d’avertissements et de reproches. Nous avons globalement réussi à éviter cela… principalement par chance ! Mais aussi que c’est parce que j’avais déjà passé pas mal de temps sur Wikipédia, et que j’étais familier de certaines coutumes du sites (mais pas toutes, loin s’en faut). Et puis surtout nous avions un but précis : les étudiants ne contribuaient pas à Wikipédia juste pour le plaisir de contribuer à Wikipédia.
Malgré cela, l’un de nos articles a été marqué pour « suppression rapide ». L’article s’est retrouvé affublé de ce bandeau moins d’une minute après que je l’ai créé devant tous les étudiants pendant un cours. Ce fut, devant toute la classe, un horrible moment de solitude, et j’ai eu furtivement le sentiment que tout allait très mal se passer. L’article marqué pour suppression immédiate était El Señor Presidente… qui est devenu, comme vous le savez, le 2000ème Article de Qualité sur Wikipédia.
Quelle importance dans la notation finale des étudiants avez-vous accordée au travail sur Wikipédia ?
JMB : À la base, le travail sur Wikipédia devait seulement représenter 30% de la note finale pour ce cours. Mais arrivé à la moitié du semestre j’ai commencé à m’inquiéter car le projet n’avait que peu avancé. J’ai donc proposé aux élèves de modifier la méthode d’évaluation en annulant les examens de fin de semestre. Par conséquent, les autres travaux qu’ils avaient réalisés (un partiel, leurs blogs et Wikipédia) devenaient tous plus importants. Après avoir évoqué cette proposition je leur ai laissé le temps de la réflexion. La décision a été prise par vote à bulletin secret avec la règle suivante : l’évaluation ne serait modifiée que si au moins deux tiers (66%) de la promotion étaient pour. Finalement, 85% de la classe a voté en faveur de l’augmentation du coefficient du projet Wikipédia pour qu’il représente 40% de leur note finale.
Étant moi-même (Brian McNeil) membre du comité de communication de la fondation Wikimedia, j’entends souvent les arguments des deux camps sur la pertinence et la fiabilité de Wikipédia. Les cas de figure peuvent être diamétralement opposés : depuis des étudiants se demandant pourquoi leur bibliothécaire ou leurs professeurs ont proscrit l’usage de Wikipédia pour un devoir, jusqu’au cas plus récent d’un enseignant chirurgien au Royaume-Uni demandant la permission de citer abondamment Wikipédia pour une publication sur la pertinence de l’encyclopédie et l’utilité qu’elle pourrait avoir pour les étudiants en médecine. J’ai une réponse toute prête pour expliquer comment vérifier les sources de Wikipédia : Wikipédia est un point de départ formidable pour vos recherches et si vous rejetez Wikipédia vous devriez aussi rejeter Britannica. Êtes-vous d’accord avec ça ?
JMB : Au cours de ce semestre je me suis forgé ma propre réponse à cette question. Si l’article Wikipédia est bon vous n’aurez même pas à le citer car il contient tous les liens nécessaires. S’il ne contient pas ces liens, ce n’est pas un bon article et il ne devrait donc surtout pas être cité.
Avant ce semestre je demandais expressément à mes étudiants de ne pas citer Wikipédia dans leurs devoirs, et je vais continuer dans cette voie. Je me méfie aussi quand ils citent des définitions du dictionnaire. Et même s’ils ne citent pas l’encyclopédie Britannica (je pense que Wikipédia a remplacé Britannica en fait), je ne serais pas non plus impressionné s’ils le faisaient.
Mais évidemment, comme vous le dites, Wikipédia peut être un excellent point de départ pour une recherche. Je l’utilise d’ailleurs souvent dans cette optique.
Feriez-vous à nouveau appel à un wiki si vous deviez recommencer une expérience collaborative ? On parle de quelque chose qu’on pourrait appeler « Eduwiki » pour la création de contenu pédagogique. Seriez-vous prêt à vous impliquer dans un tel projet ? Pensez-vous que le logiciel Mediawiki pourrait être utilisé dans d’autres domaines de l’éducation ? Ce type d’initiatives pourraient faire partie de plus vastes projets lancés par la fondation Wikimedia tels que Wikibooks ou Wikiversity. Choisiriez-vous ce type de fonctionnement ouvert au détriment d’un projet fermé au sein du monde universitaire où les compétences des contributeurs peuvent être vérifiées ?
JMB : Je ne sais pas vraiment. Comme vous avez déjà pu vous en apercevoir, j’ai fortement tendance à douter de tout ce qui comprend « édu » dans la dénomination. Je dis ça avec tout le respect que je dois à mes amis qui sont dans « EduTech », mais je devrais ajouter qu’ils sont souvent aussi suspicieux que je le suis, si ce n’est plus ! J’ai déjà travaillé deux fois avec des wikis dans des environnements plutôt fermés, ça n’a jamais été un succès. Je pense que c’est parce que nous n’avions pas atteint la masse critique. Ce qui fait que Wikipédia marche c’est la masse critique (même si, bien sûr, un faible pourcentage des lecteurs de Wikipédia deviennent contributeurs).
 Il faut dire aussi que peu de gens du monde universitaire comprennent l’esprit des wikis. Il leur (nous) est difficile de ne pas se (nous) montrer possessifs vis-à-vis de leur (notre) travail. Je crois que c’est de là que naissent les antagonismes et la frustration que ressentent les universitaires lorsqu’ils s’impliquent sur Wikipédia. C’est rarement « l’expertise » qui est en cause mais plutôt la propriété. Je reconnais que je ne suis pas très précis, mais par exemple un wiki avait été mis en place dans mon université, mais il était impossible de modifier le texte de quelqu’un d’autre. On aurait très bien pu alors afficher des pdf. C’était plus un exercice de monographie qu’un exercice d’écriture collaborative.
Il faut dire aussi que peu de gens du monde universitaire comprennent l’esprit des wikis. Il leur (nous) est difficile de ne pas se (nous) montrer possessifs vis-à-vis de leur (notre) travail. Je crois que c’est de là que naissent les antagonismes et la frustration que ressentent les universitaires lorsqu’ils s’impliquent sur Wikipédia. C’est rarement « l’expertise » qui est en cause mais plutôt la propriété. Je reconnais que je ne suis pas très précis, mais par exemple un wiki avait été mis en place dans mon université, mais il était impossible de modifier le texte de quelqu’un d’autre. On aurait très bien pu alors afficher des pdf. C’était plus un exercice de monographie qu’un exercice d’écriture collaborative.
Et pour ce qui est des qualifications, sujet largement débattu sur Wikipédia, je pense que ce sont des sornettes. Je ne pense pas que les qualifications aient une si grande importance. Mes étudiants ne peuvent pas s’enorgueillir de beaucoup de titres, mais ils ont quand même produit un excellent résultat.
Comment qualifieriez-vous la réaction de vos étudiants à l’idée de faire ce devoir alors que tout le monde peut observer leur progression, y étaient-ils réceptifs ?
JMB : Dans les cours précédents j’ai souvent demandé à mes étudiants de tenir un blog, blog qui était évidemment visible de tous. Mais à vrai dire, peu de personnes se retrouvent pas hasard sur le blog d’un étudiant. Ce n’est pas vraiment le fait que les articles de Wikipédia soient publics qui importait mais plutôt le fait qu’ils allaient contribuer à l’un des dix sites les plus visités sur Internet. Alors je me suis décidé un jour à faire mes petites recherches pour savoir combien de personnes visitaient les pages sur lesquelles nous travaillions (j’ai accumulé ces résultats et je les ai plus tard mis à jour ici). Durant le cours suivant nous avons joué à deux petits jeux de devinette. Il fallait d’abord qu’ils devinent le pourcentage d’Articles de Qualité sur Wikipédia ; ils ont commencé avec 30% et ça leur a pris du temps avant de baisser leur estimation à 0,15%. Nous avons fait ce petit jeu juste après qu’El Señor Presidente eut atteint le statut d’Article de Qualité, ça leur a donné une idée de la performance qu’ils avaient réalisée je pense.
La deuxième devinette concernait le nombre de pages vues que généraient leurs articles chaque mois. Je ne sais plus quel nombre ils m’ont dit en premier, mais ce que je sais c’est qu’il était bien inférieur aux 50000 visites que l’article sur Gabriel García Márquez reçoit effectivement. Après avoir calculé que cet article devait recevoir plus de 600000 visites par an (je crois que c’est 750000 maintenant), l’équipe en charge de cette page a reçu un choc. Mais je pense aussi que réaliser l’importance de leur travail était excitant en même temps. Et je sais aussi que les étudiants qui verront bientôt leur article sur la page d’accueil du site anglais (le 5 mai) seront vraiment enchantés. Mais je crois que ce qui les intéresse le plus (eux et les autres étudiants) n’est pas le fait que le « public » ait accès à leur travail mais plutôt le fait de pouvoir dire à leurs amis et à leur famille de jeter un œil à leur travail.
Certains de vos étudiants ont-ils eu des problèmes d’adaptation qui les ont empêchés de travailler sur Wikipédia ?
JMB : Oui. Les réponses ont été assez variées. Certains étaient vraiment enthousiastes. Pour d’autres, il fallait laisser le temps à l’idée de faire son chemin. Quelques-uns ne se sont jamais vraiment sentis à l’aise avec le travail sur Wikipédia. Il m’est difficile de dire individuellement pourquoi. Certains ont été trop intimidés par la technologie, mais je pense surtout qu’ils n’y ont pas consacré assez de temps pour dépasser les premières barrières. De plus, comme c’était un travail de groupe, certains de ses effets pouvaient être angoissants par moments. C’est un aspect auquel je devrais réfléchir avant de tenter à nouveau une expérience similaire.
Pensez-vous que fonctionner ainsi, de manière aussi ouverte, a poussé les étudiants à travailler plus consciencieusement qu’ils ne l’auraient fait autrement ?
JMB : Oui, absolument, c’est certain ! Les étudiants, les plus actifs tout du moins, ont participé à l’élaboration d’articles comprenant entre 4000 et 8000 mots étayés par des recherches exhaustives, corrigés à maintes reprises, avec un souci du détail méticuleux. N’importe lequel des articles qu’ils ont rédigés est bien meilleur que n’importe quelle dissertation qu’ils auraient produite autrement. Évidemment, certains étudiants étaient plus actifs que d’autres. Ils ont donc appris plus et ont aussi été plus poussés que les autres. Mais les remarques et les questions incessantes des autres éditeurs de Wikipédia, en particulier des membres de la FA-Team, qui a réalisé l’essentiel du travail de révision, les ont forcés à toujours réfléchir à ce qu’ils disaient, à comment ils le disaient et à bien citer leurs sources.
Rétrospectivement, que feriez-vous différemment ?
JBM : Certains aspects du travail en groupe n’ont pas fonctionné de manière optimale. Nous avons également commencé assez lentement : il faudrait que je réfléchisse à comment y remédier. De plus, une fois que le projet sera achevé, la FA-Team et moi (et n’importe quel étudiant intéressé évidemment) prévoyons une réflexion « post-mortem » sur tous les aspects de la collaboration. On peut toujours améliorer les choses. J’ai aussi beaucoup appris grâce à ce projet et j’espère bien me servir de cette expérience la prochaine fois.
Vous en êtes à 6000 éditions, avez-vous attrapé le « virus wiki » ? Allez-vous continuer à participer ?
JMB : 7000 maintenant ! Il faudra bien que je lève le pied quand le projet sera terminé car il m’a pris énormément de temps. Mais je compte me remettre en selle à l’automne.
Maintenant que l’on peut dire que votre projet est une réussite, qu’auriez-vous à dire à d’autres universitaires pour les persuader de se lancer dans des expériences similaires ?
JMB : Je les y encouragerai c’est sûr, mais je ne voudrais pas passer pour un évangéliste de Wikipédia. Je peux tout à fait comprendre pourquoi des activités précédemment engagées avec l’encyclopédie ont pu se révéler décevantes, frustrantes ou pire encore. Mais je pense que, particulièrement si les universitaires prennent le temps de comprendre les aspects de la culture de Wikipédia, certaines activités peuvent se montrer très gratifiantes. Nous avons eu beaucoup de chance de croiser le chemin de la FA-Team, un groupe d’éditeurs expérimentés de Wikipédia qui venait juste de se former pour aider les autres à atteindre le statut d’Article de Qualité. Leur participation a été un vrai don du ciel. Mais je ne vois pas pourquoi d’autres ne pourraient pas bénéficier d’une assistance semblable (voire différente, sait-on jamais, et peut-être meilleure) dans d’autres circonstances.
Avant de continuer en faisant participer vos étudiants à la discussion, j’aimerais conclure en vous demandant votre avis sur l’intégration d’un tel exercice au programme. L’envisagez-vous ? Pensez-vous que d’autres institutions devraient étudier votre projet en vue de le reproduire ?
JMB : Je recommencerai cette expérience, ça ne fait aucune doute. Le seul côté négatif pour le professeur est que, s’il veut que le projet soit correctement mené, il doit y consacrer beaucoup de travail. Mais d’un autre côté, en terme de ressources, ce genre de projet n’en requiert quasiment pas. Mon université (et bien d’autres) paye des licences à plusieurs millions de dollars pour des logiciels pédagogiques comme WebCT. C’est de l’argent gaspillé, beaucoup d’argent gaspillé d’après moi, mais je reconnais que c’est un racket lucratif pour ceux qui vendent ces logiciels. Je pense aussi que l’université se désengage d’une part importante de sa mission : investir dans les Biens Communs. La tendance aujourd’hui, dans le monde universitaire, est à la privatisation et au cloisonnement (même si je dois dire qu’il existe encore quelques valeureuses exceptions, le travail sur l’accès libre de mon ancien collègue John Willinsky est à ce titre exemplaire). À mesure que les universités s’impliqueront dans Wikipédia, elles réaliseront qu’elles peuvent le faire sans nécessairement y perdre leurs exigences de qualité en matière de recherche et la rigueur universitaire qu’il est également de leur devoir de défendre, et que cela profite non seulement à leurs étudiants mais aussi au bien commun.
Bons Articles et Articles de Qualité
En plus de l’Article de Qualité, sept autres articles ont atteint le statut de Bons Articles. Était-ce une source de motivation pour tous ceux d’entre vous impliqués dans le projet ?
 Monica Freudenreich : Je ne peux pas parler au nom de toute la classe, mais je crois que nous étions tous un peu hésitants. Nous n’avions jamais été confrontés dans notre cursus à un projet d’une telle envergure et nous ne savions pas vraiment ce qui allait en ressortir, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous autres étudiants, nous avons l’habitude de toujours faire les choses à la dernière minute et pour ce projet ça n’était vraiment pas possible. Et donc, malgré un démarrage assez poussif dans l’ensemble, je pense que le statut que la plupart des articles du projet ont atteint est vraiment impressionnant et que cette réussite est une énorme motivation en elle-même.
Monica Freudenreich : Je ne peux pas parler au nom de toute la classe, mais je crois que nous étions tous un peu hésitants. Nous n’avions jamais été confrontés dans notre cursus à un projet d’une telle envergure et nous ne savions pas vraiment ce qui allait en ressortir, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous autres étudiants, nous avons l’habitude de toujours faire les choses à la dernière minute et pour ce projet ça n’était vraiment pas possible. Et donc, malgré un démarrage assez poussif dans l’ensemble, je pense que le statut que la plupart des articles du projet ont atteint est vraiment impressionnant et que cette réussite est une énorme motivation en elle-même.
Katy Konik : Je ne peux pas parler au nom de tous, mais je pense que de voir tous ces articles atteindre le statut de Bons Articles a prouvé que l’objectif était tout à fait atteignable. Je crois que le seul problème est qu’au sein de la classe chacun travaille à son rythme. Voir que d’autres ont déjà atteint le statut de Bon Article quand on n’y est pas encore peut mettre la pression.
Elyse Economides : Cela nous a servi d’encouragement, mais en même temps rendait la tâche un peu plus intimidante. C’était formidable de voir tant de groupes atteindre le statut de Bon Article au bout de quatre mois, mais cela nous rappelait également tous les efforts et le temps qui devaient y être consacrés. Heureusement, voir nos camarades obtenir le statut de Bon Article nous a convaincus que ce défi était à notre portée.
À quel moment avez-vous ressenti qu’il était possible d’atteindre les statuts de Bon Article ou d’Article de Qualité ? Depuis combien de temps travailliez-vous sur Wikipédia à ce moment là ?
MF : Je me suis créé un compte en janvier, comme beaucoup d’autres étudiants de notre classe, je ne savais même pas avant qu’on pouvait modifier Wikipédia. La page a été créée, je crois, le 15 janvier, avec l’aide du Dr Beasley-Murray. Comme je n’avais aucune idée de la manière de créer une page, après que le bandeau « suppression immédiate » ait été apposé sur l’article, je me suis dit que je devrais y apporter du contenu pour éviter qu’elle soit supprimée. Nous avions entrepris notre travail depuis 3 mois avant d’être promus sur la liste des articles candidats au grade de Bon Article puis à partir de là il nous a fallu 1 mois supplémentaire pour recevoir notre étoile d’or récompensant les Articles de Qualité. Mais je ne crois pas que ce soit le temps qui compte dans l’obtention d’un Bon Article ou d’un Article de Qualité, c’est plutôt la qualité du contenu et la volonté des autres wikipédiens de collaborer sur le projet. J’ai fait confiance aux utilisateurs plus expérimentés pour nous prévenir quand les statuts de Bon Article ou d’Article de Qualité étaient envisageables et pour nous donner une liste de choses qui restaient à faire pour atteindre ces étapes.
KK : Lorsque le projet nous a été présenté à la mi-janvier nous étions tous très motivés pour atteindre le grade d’Article de Qualité et je crois que je ne réalisais pas très bien la quantité de travail et de ré-écriture nécessaire pour atteindre ce but. À la mi-février nous avons consacré quelques jours à la lecture de toutes les sources en langue anglaise que nous pouvions trouver et nous balancions tout ce que nous trouvions sur la page. C’est à ce moment là que d’autres personnes ont véritbalement commencé à montrer de l’intérêt pour notre travail en proposant des suggestions et en faisant des tas de modifications elles-mêmes. Pour être honnête c’était un peu décourageant de voir à quel point les règles sur Wikipédia sont strictes et de se rendre compte de la quantité de travail de ré-écriture qui nous attendait. Même si ces critères pouvaient paraître de prime abord décourageants, ils nous donnaient une idée exacte de ce que nous devions faire et ils rendaient nos objectifs plus concrets et atteignables.
EE : Une fois que professeur Beasley-Murray nous a vraiment encouragés à commencer nos articles en nous donnant comme consigne de faire une modification, importante ou pas, à notre article, éditer un article sur Wikipédia était déjà moins intimidant même si l’entreprise nous semblait toujours pharamineuse. La base de l’article, le plan et les informations qui ont survécu aux révisions, ont été créés vers la fin février, c’est à ce moment-là que le statut de Bon Article est devenu un objectif tangible. C’est également à ce moment-là que les contributions extérieures à notre groupe se sont faites plus importantes, un apport positif qui s’est maintenu durant le reste de notre progression.
Si vous pouviez modifier les directives pour conseiller les gens qui désirent promouvoir un article au rang d’Article de Qualité, que changeriez-vous ?
KK : Je pense que les directives sont équilibrées et c’est ce qui fait que les Articles de Qualité sont des sources fiables. Je n’aurais en fait qu’une remarque à faire vis-à-vis des Conventions de Style qui sont carrément incompréhensibles pour les profanes comme moi. Si nous n’avions pas reçu le soutien d’éditeurs professionnels qui savaient ce qu’ils faisaient je ne sais pas si nous aurions pu surmonter cet obstacle.
EE : Même si je n’ai probablement pas une expérience des directives aussi importante que les autres membres de mon groupe, de ce que j’en ai vu, un certain niveau d’exigence technique et professionnel est requis, ce qui est nécessaire pour assurer la continuité et le sérieux des articles, mais cela peut se révéler compliqué à comprendre et à mettre en application pour les utilisateurs néophytes. Les directives sont une composante nécessaire de Wikipédia et Wikipédia fournit les explications nécessaires à leur compréhension. Je pense que pour bien se familiariser avec ces directives il faut s’entraîner et prendre exemple sur les autres articles.
Chacune de vos contributions était directement consultable sur Internet. Pensez-vous que ça vous ait encouragé à plus vous appliquer que pour une dissertation conventionnelle que le professeur est seul à lire ?
MF : Pas vraiment. Je pense surtout que ce sont les autres éditeurs de Wikipédia qui nous ont poussés à nous appliquer davantage. Ils nous stimulaient en permanence pour que nous trouvions de meilleurs sources à référencer. Lorsque vous visez un Bon Article ou un Article de Qualité ils mettent la barre extrêmement haut. Les blogs ou d’autres sites Internet comme Facebook rendent également toute contribution directement visible et pourtant leur contenu peut-être d’un niveau très médiocre, si l’on peut parler de niveau. Je pense donc que le fait que notre travail apparaissait sur Internet n’a rien à voir avec notre détermination à travailler dur sur ce projet. Le soutien que nous ont apporté les autres wikipédiens tout au long de l’aventure m’a permis de me motiver pour poursuivre le travail et aussi me fixer des objectifs de qualité élevés.
KK : Je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec le fait que notre travail était directement visible en ligne. Je crois personnellement que ce sont surtout la possibilité de recevoir des commentaires et de re-travailler les pages qui nous ont poussé à toujours améliorer la qualité de nos contributions. C’est vraiment très différent d’une dissertation que vous ne pouvez rendre qu’une seule fois sans pouvoir la corriger en fonction des commentaires reçus. Par cet aspect du travail nous avons appris beaucoup plus grâce à Wikipédia que grâce à une dissertation, nous pouvions vraiment utiliser les commentaires des autres éditeurs.
EE : J’aurais presque tendance à dire que ça a eu l’effet inverse. Même si de nombreux utilisateurs de Wikipédia font très attention à leurs contributions, Wikipédia reste anonyme et les contributions de chacun ne sont pas nécessairement retraçables. Il faut dire aussi que Wikipédia change perpétuellement au gré des allées et venues des éditeurs, une information que l’on ajoute n’est jamais inamovible. Une dissertation est toujours liée à son auteur et contrairement à Wikipedia, son contenu est définitif.
Ressentez-vous un sentiment d’accomplissement plus grand en ayant apporté quelque chose aux « Communs numériques » plutôt que d’avoir rendu une dissertation ?
MF : Cela ne fait aucun doute. Un nombre incalculable de personnes vont lire cette page au cours de son existence. J’ai investi tellement d’énergie dans la rédaction et l’amélioration de cet article que je suis vraiment fière du résultat final. Quand je le relis, j’ai même du mal à croire que j’y ai contribué. Les dissertations que je rends finissent en général dans un classeur, qui restera bien rangé sous mon lit ou alors dans un coin de mon disque dur, pour ne jamais être ré-ouvertes. La page sur Wikipédia sera consultée et servira certainement à quelqu’un. Je dois dire que je suis plutôt sure que la bibliographie référence quasiment tout ce qui a été publié en anglais sur le sujet. Si quelqu’un cherche à approfondir El Señor Presidente tout est là et je trouve que c’est vraiment incroyable !
EE : Oui et non. Contribuer à la création d’un Article de Qualité est synonyme de répandre cette information à un nombre potentiellement illimité de personne, mais rédiger une dissertation est également un accomplissement à part entière, ça implique beaucoup de recherches et de rédaction. Sur Wikipédia un nombre largement plus important de personnes pourront consulter et apprécier le travail de quelqu’un, je le reconnais, mais c’est aussi moins personnel. Je trouve que les deux font naître un sentiment d’accomplissement, peut-être mêlé à un sentiment de soulagement aussi.
Avez-vous attrapé le « virus wiki » ? Allez-vous continuer à contribuer ?
MF : Je n’en suis pas certaine, je pense que Wikipédia est une formidable ressource et j’éprouve beaucoup d’admiration pour tous ceux qui œuvrent pour que Wikipédia soit une source complète et fiable, mais je ne sais pas encore si je vais continuer à y participer. J’aimerais pouvoir dire que oui, mais entre deux emplois et les cinq cours que je suis, il va falloir que j’arrête ou que je me limite avant la fin du semestre. Ensuite, cet été, je cumulerai trois emplois et deux cours, là non plus je ne sais pas combien de temps je pourrai accorder à Wikipédia. Mais je pense que quand je lirai des romans ou que je ferai des recherches pour des devoirs futurs, j’utiliserai les informations et les références recueillies pour étoffer les articles concernant les sujets étudiés.
KK : Je ne sais pas si je vais continuer à contribuer, il faut voir la quantité de travail et de recherche nécessaire pour produire du contenu de qualité. Si j’ai attrapé le « virus wiki » ça serait plutôt pour le respect que j’accorde maintenant aux autres Bons Articles ou Articles de Qualité. Même si je n’ai pas forcément le droit de les citer dans mes dissertations, j’aurai au moins appris que ce sont des sources excellentes et qu’ils peuvent me mener vers d’autres articles universitaires. Quand je ne connais rien dans un domaine c’est toujours vers Wikipédia que je me tourne et si je peux y trouver des liens vers d’autres sources alors je sais que je suis sur un bon article.
EE : Je pense que je vais continuer à participer, même si ça sera surtout par des modifications mineures comme des corrections orthographiques ou grammaticales, c’est là que je m’épanouis le plus. Je pense que toute modification sur Wikipédia, peu importe son importance, donne à l’utilisateur un sentiment de satisfaction.
Si le Professeur Beasley-Murray souhaitait recommencer ce projet dans les années à venir, quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui prendraient votre relève et feraient leurs débuts sur Wikipédia ?
MF : Je leur conseillerais de s’y prendre tôt et de commencer avec les recherches. En plus du projet sur Wikipédia nous avions à rendre des comptes rendus de lecture. Je conseillerais également une approche hebdomadaire du projet aux étudiants, je leur recommanderais de prendre au moins une heure par semaine pour éditer Wikipédia ou pour faire des recherches sur le sujet. Pour commencer, les bases de données de journaux en ligne sont très utiles, mais il faut reconnaître que de nombreux articles traitant des romans ne sont pas publiés en ligne et l’aide de votre assistant bibliothécaire vous sera très précieuse. J’ai eu recours à leurs compétences trois fois pour savoir comment obtenir les informations que je cherchais. Je leur conseillerais également de ne pas se laisser dépasser par l’ampleur de la tâche. Les wikipédiens imposent des critères de qualité très élevés, mais ils ne sont pas hors d’atteinte. Ayez confiance en vous, même en tant que non diplômé et même si l’anglais n’est pas votre spécialité vous pouvez apporter une contribution importante et voir vos efforts se matérialiser en quelque chose de concret.
EE : Je les encouragerais moi aussi à commencer leurs recherches tôt afin de réunir autant d’informations que possible sur le sujet. Les vétérans et utilisateurs expérimentés de Wikipédia semblent graviter autour des pages qui font preuve d’une activité importante. Je les encouragerais également à trouver leur rythme (ce que j’aurais du faire), à prendre exemple sur d’autres pages et à chercher conseil auprès des autres utilisateurs. Je les encouragerais à se réunir avec les autres membres du groupe assez tôt pour mettre sur pied un plan pour la recherche et l’écriture.
Qui d’après vous note le plus sévèrement ? Les autres professeurs à qui vous avez rendu des devoirs conventionnels ou l’équipe qui juge les contributions faites à Wikipédia en vue de leur attribuer les grades de Bon Article ou d’Article de Qualité ?
MF : La question ne se pose même pas ! L’inspection pour obtenir le grade de Bon Article a vraiment été intense et je dois avouer que j’étais plutôt intimidée au début. Ils ont dégagé toute une liste de points à re-travailler, après les avoir corrigés je me suis rendu compte que ces améliorations étaient à la fois nécessaires et importantes. Mais nous n’étions pas encore au bout de nos peines. En fait, avant même la fin de l’inspection un autre éditeur a passé l’article en revue, vérifiant chaque ligne pour nous présenter à la fin une liste d’améliorations encore plus longue. Une fois qu’elles furent intégrées l’article a encore été révisé de fond en comble. Par moment j’ai vraiment été découragée par la montagne de travail que cela représentait et je n’étais pas tout à fait sûre de pouvoir tout corriger. Mais grâce à leur soutien indéfectible et leur aide nous y sommes parvenus. Pour les devoirs que nous rendons habituellement, les professeurs ne font que peu de commentaires avant de nous rendre les copies. En presque quatre ans passés à l’université, un seul professeur nous a rendu nos devoirs en nous laissant la possibilité de les revoir et de re-travailler les passages problématiques. Et personnellement, je trouve cet exercice de ré-écriture, clarification et amélioration du texte extrêmement formatrice. Au cours des mois écoulés j’ai appris tellement à propos de l’écriture que je ne saurais même pas par où commencer… et ça se voit. J’ai toujours eu des notes autour de B+/A- tout au long de mes études universitaires et aux deux derniers devoirs que j’ai rendus j’ai eu des A ! Je pense que les notes parlent d’elles-mêmes.
KK : Wikipédia était carrément plus intense, mais je pense aussi que le processus était plus juste. La critique ne me gène pas tant qu’on a l’occasion de corriger les choses. C’est exactement ce que j’ai apprécié dans le déroulement de ce projet sur Wikipédia et je crois que c’est la raison pour laquelle ce fut une très bonne expérience pédagogique.
EE : Dans l’ensemble, Wikipédia semble être plus constant et cohérent dans son appréciation alors que les professeurs peuvent parfois noter de manière inattendue. Mais malgré tout, que ce soit avec Wikipédia ou avec mes professeurs, dans les deux cas, un travail de très bonne qualité est attendu et l’auteur est mis au défi de produire un tel travail.
D’autres wikipédiens ne faisant par partie de la classe ont-ils apporté des contributions importantes ? Et si oui, cela vous a-t-il aidé ?
MF : Si au commencement nous étions pratiquement seuls, à mesure que nous nous sentions plus à l’aise sur Wikipédia et que nous étoffions nos recherches sur le sujet, nous avons reçu plus d’aide de la part d’autres wikipédiens, des gens que nous ne connaissions vraiment pas et qui désiraient nous aider à atteindre notre objectif ambitieux : l’Article de Qualité. Cette aide nous a été très précieuse, je pense même que nous n’aurions pu atteindre notre but sans l’assistance et les conseils qu’ils nous ont prodigués tout au long du projet. Je ne les remercierai jamais assez de nous avoir ainsi guidés et remis dans le droit chemin quand nous rencontrions des obstacles.
EE : Oui, d’autres utilisateurs de Wikipédia ont largement contribué, même avant que notre groupe n’approche du statut de Bon Article. Cet esprit communautaire développé entre tous les utilisateurs est vraiment l’un des éléments de base de Wikipédia. Lorsqu’ils identifient un besoin, ils apportent rapidement leur aide et leur soutien.
Une question assez ouverte : voyez-vous une place pour l’utilisation de la technologie wiki dans d’autres matières que vous suivez, ou même dans le futur emploi que vous visez ?
MF : Wikipédia est à mes yeux une formidable ressource où l’on peut trouver des informations concises et bien organisées. Notre société allant toujours plus vite, l’encyclopédie ne fera que gagner en importance pour les personnes qui doivent rapidement vérifier des noms ou des lieux pour leur travail. J’utilise déjà Wikipédia pour vérifier rapidement certaines références ou pour m’informer sur quelqu’un ou quelque chose lorsque je ne suis pas familière avec le sujet.
KK : Je vois plein d’usages potentiels de la technologie wiki. Mon premier réflexe lorsque j’ai une question est souvent de me rendre sur Wikipédia. Même si je ne peux pas citer Wikipédia dans mes devoirs, j’ai appris que si l’article est bon j’y trouverai beaucoup d’informations pour mes travaux universitaires et si ce n’est pas le cas, Wikipédia n’en reste pas moins une excellente ressource où trouver des connaissances de base. Je pense que si plus d’articles pouvaient atteindre au moins le statut de Bon Article l’encyclopédie commencerait à être reconnue comme une source fiable.
EE : J’ai toujours apprécié Wikipédia en tant que ressource où trouver des informations de base pour beaucoup des matières que j’étudie. Et même si elle n’est pas reconnue comme une source purement académique je m’en sers pour me familiariser avec un sujet avant de m’engager dans des recherches plus approfondies. Je trouve également Wikipédia très utile pour les sujets non-académiques, c’est d’ailleurs là que réside sa beauté.
Le 2000ème
Quel a été votre sentiment quand El Señor Presidente a reçu le statut d’Article de Qualité ? Y-avez-vous porté un toast ou avez-vous fait la fête pour célébrer ?
MF : J’étais (et je le suis toujours) extrêmement excitée. Avant que le semestre ne commence en janvier je ne savais même pas que n’importe qui pouvait modifier Wikipédia, ne parlons même pas de créer une page pour la commencer à partir de rien. Je ne savais vraiment pas si nous arriverions à le mener jusqu’aux propositions d’Articles de Qualité mais nous avons bénéficié de tant de soutien pour la révision et les aspects techniques de Wikipédia touchant à la création d’un article que rien n’aurait été possible sans l’aide que nous ont apportée quelques wikipédiens. Malheureusement nous n’avons pas pu fêter ça, le travail d’étudiant semble sans fin, mais je vous avoue que je m’en vante sans vergogne devant ma famille ou mes amis.
KK : C’était vraiment formidable mais, pour être honnête, j’avais tellement pris l’habitude d’éditer Wikipédia pendant deux mois que j’étais presque triste que tout se termine. Créer un article sur Wikipédia est vraiment un travail de groupe et j’étais un peu triste que tout s’arrête après avoir collaboré si intensément avec un groupe extraordinaire.
EE : C’était presque un sentiment surnaturel. On a du mal à croire qu’un article créé en janvier mérite maintenant le statut d’Article de Qualité moins de quatre mois plus tard. Toute notre classe a célébré la fin des cours, j’imagine que nous fêtions un peu en même temps la fin de notre projet sur Wikipédia.
Avez-vous été déçues que plus d’articles n’atteignent pas le statut d’Article de Qualité ?
MF : Je n’ai pas participé à l’élaboration des autres articles, donc ça me touche moins. Peut-être devriez-vous poser cette question à Dr. Beasley-Murray qui a participé, lui, à chaque article.
Est-ce que ça a été plus dur que vous ne l’imaginiez d’atteindre ce statut ?
MF : En fait je ne sais pas vraiment ce que j’attendais. Au début projet j’ai lu d’autres articles traitant de livres qui avaient atteint le statut d’Articles de Qualité et ils étaient vraiment très bons, donc dès le début je savais que ça allait être difficile et j’étais prête à affronter les difficultés et à me lancer.
KK : Je ne dirais pas que c’était plus dur que je ne l’imaginais, mais ça nous a demandé plus de travail. Par chance nous avions avec nous un groupe d’utilisateurs et d’éditeurs de Wikipédia fantastique qui nous a aidés à comprendre dès le début ce qui nous attendait. Et pour être honnête, sans leur aide je pense que tout ce processus aurait été bien plus difficile, voire impossible. J’ai appris à travers cette expérience que si vous êtes prêt à y accorder le travail et le temps nécessaire ce n’est vraiment pas impossible.
EE : L’engagement requis, en temps et en efforts, est important, mais je pense que l’on doit s’y attendre pour un article reconnu. Notre chance a été d’être guidés à chaque étape par des éditeurs expérimentés, c’est grâce à eux que nous sommes arrivés si loin et si vite.
Que les auteurs ne soient pas crédités sur Wikipédia vous pose-t-il problème ?
MF : Absolument pas. Wikipédia est vraiment un effort de groupe et je pense que ça serait injuste de ne citer que quelques noms. J’ai peut-être été l’un des principaux éditeurs, travaillant sans relâche sur l’article, mais en même temps il n’aurait jamais atteint le statut d’Article de Qualité sans le soutien indéfectible d’autres collaborateurs dont l’aide a été extrêmement précieuse. Ce qui m’impressionne toujours, c’est la rigueur de leur relecture, leur capacité à se concentrer sur les passages perfectibles, tout ceci a rendu l’article final tout simplement remarquable.
KK : Cela ne me dérange vraiment pas personnellement car je l’ai fait dans le cadre d’un devoir scolaire. Donc comme je ne me suis occupé que d’un unique article le manque de crédit ne me gène pas, surtout que c’est vraiment un effort collectif. Ce qui me dérange plus est le manque de reconnaissance dont est victime Wikipédia dans le monde universitaire. Beaucoup de personnes ont travaillé d’arrache-pied sur cet article, et il en va de même pour les autres Articles de Qualité évidemment, pour lui assurer de solides bases universitaires et pourtant l’encyclopédie a toujours mauvaise réputation. Je crois que les Articles de Qualité méritent plus de reconnaissance de la part du monde universitaire car ce sont d’excellentes sources d’informations.
EE : Pas vraiment. Le but de Wikipédia est de partager et de diffuser l’information, pas de formuler de nouvelles idées ou d’avancer des hypothèses. En fait, les utilisateurs sont surtout des agrégateurs, ils rassemblent les informations et les organisent en une page cohérente. Même si certains utilisateurs contribuent plus que d’autres, tous les utilisateurs travaillent de concert vers un objectif commun, et cet objectif n’est pas la reconnaissance individuelle. De plus, Wikipédia a mis en place son propre système de reconnaissance et de récompenses pour rendre à César ce qui appartient à César.
« Publier ou mourir » semble être le mantra du monde académique. Pensez-vous que le milieu éducatif devrait adopter Wikipédia, ou tout du moins sa technologie sous-jacente, pour réduire les coûts de publication ?
MF : Étant donné que je ne suis pas encore diplômée je ne peux pas vraiment dire que j’ai été confrontée à cette pression du « publie ou crève » (NdT : publish or die). Je pense en revanche que ce devoir nous a été très profitable et j’y vois beaucoup de points positifs. D’habitude ce que nous autres étudiants écrivons n’est jamais publié, c’était donc une chance pour nous de publier quelque chose sur Wikipédia. Je pense aussi que nous avons acquis beaucoup de compétences importantes grâce à l’édition de Wikipédia parce que personne n’écrit jamais quelque chose pour ne plus jamais y revenir. Wikipédia encourage les révisions multiples, le travail de ré-écriture ou encore les recherches plus approfondies pour clarifier un point développé. Je pense que notre écriture s’est améliorée également et que nous avons pu amender nos points faibles. Je ne sais pas si j’ai vraiment répondu à la question, mais oui, je pense que le milieu éducatif devrait voir Wikipédia comme un outil pédagogique précieux pour les étudiants. Comme le nom des personnes n’est lié à aucun article ou que le vrai nom de la personne n’apparaît pas lorsqu’elle édite, je pense qu’il serait très difficile d’utiliser Wikipédia, sous sa forme actuelle, pour réduire les coûts élevés de publication.
EE : Wikipédia est très utile pour se renseigner (et même plus que simplement se renseigner dans certains cas) sur certains sujets universitaires et je pense que l’encyclopédie devrait être mieux reconnue. Il faudrait aussi que les étudiants, quel que soit leur niveau d’étude, puissent citer Wikipédia comme n’importe quelle autre source universitaire dans leurs devoirs ou leurs projets. Je peux tout à fait concevoir par contre qu’il est difficile de considérer Wikipédia comme une source universitaire rigoureuse puisqu’elle est ouverte aux modifications par des universitaires et des non-universitaires sans discrimination. Je crois que Wikipédia devrait continuer à être employée pour la recherche d’informations ou pour débuter une recherche et comme tremplin vers d’autres sources.
Après avoir travaillé sur un article pour qu’il atteigne le statut d’Article de Qualité, votre opinion sur Wikipédia a-t-il changé par rapport au début de ce projet ?
MF : Comme je l’ai déjà dit, j’ignorais même que quelqu’un pouvait éditer Wikipédia avant de commencer le projet, mon opinion sur Wikipédia a donc été profondément modifiée. Après avoir travaillé sur cette page si longtemps et après avoir obtenu le grade d’Article de Qualité ,j’ai nettement plus de respect maintenant pour les éditeurs qui œuvrent à améliorer l’information qu’on y trouve. Wikipédia est une ressource formidable et ça ne fait aucun doute pour moi que ça n’ira qu’en s’améliorant. Puisque, avant de commencer le projet, on nous demandait de ne jamais citer Wikipédia dans nos écrits universitaires, je m’étais dit qu’on ne pouvait pas faire confiance à son contenu. En même temps, l’un de mes professeurs cette année a inclus dans la bibliographie qu’il nous a transmise pour son cours certains articles de Wikipédia sur la théorie du Big-Bang et j’en ai été choquée. J’en ai tiré une leçon : Wikipédia peut être un outil de recherche extrêmement précieux, au moins en ce qui concerne les Bons Articles et les Articles de Qualité, le lecteur peut y trouver une liste complète et fiable de travaux universitaires. Je ne pourrais jamais exprimer tout mon respect pour ceux qui travaillent chaque jour sur les articles de Wikipédia à regrouper des sources et des informations, ils font vraiment quelque chose de remarquable. Que ça plaise ou non aux professeurs, Wikipédia est largement utilisée par les étudiants pour faire des vérifications rapides sur des faits, des personnes, des endroits, des évènements ou des travaux et je pense qu’avec l’aide d’éditeurs dévoués l’encyclopédie ne pourra que s’améliorer et en nous impressionnant toujours davantage.
EE : J’ai découvert l’attrait de Wikipédia, non seulement pour accéder à l’information, mais aussi pour la partager. J’ai aussi découvert tous les efforts qui sont faits « en coulisse » pour créer, entretenir et éditer les articles. Wikipédia m’avait toujours semblé être une ressource dominée par des personnes expertes dans leur domaine, ou en tout cas des passionnés. Travailler sur un article m’a cependant montré que vraiment n’importe qui peut apporter sa pierre à l’édifice « Wikipédia » et avoir un impact important.
Je voudrais tous vous remercier d’avoir pris un peu de votre temps pour aider à la création de cet article pour Wikinews… qui sait, finira-t-il peut-être aussi dans la liste des Articles de Qualité !

Les autres articles du dossier
- 3/6 – Le projet vu par un éditeur de Wikipédia
Le point de vue d’un éditeur de Wikipédia, membre de « l’équipe des Articles de Qualité », ayant accompagné et soutenu les étudiants pendant la durée de leurs travaux.
- 4/6 – Le projet vu par les étudiant(e)s
Interview du professeur Jon Beasley-Murray et de trois de ses étudiantes par la gazette anglophone de Wikipédia.
- 6/6 – Liens connexes
Une sélection de liens francophones autour de Wikipédia et l’éducation.
 Il y a un mois presque jour pour jour, je
Il y a un mois presque jour pour jour, je  Une nouvelle version de nos
Une nouvelle version de nos  Framatube, contraction pas forcément heureuse mais en tout cas signifiante de Framasoft et YouTube, a récemment franchi le cap symbolique des 100 vidéos (104 pour être précis), presque toutes en français ou sous-titrées, offrant par là-même un catalogue « spécialisé » qui pourra être utile à toute personne souhaitant s’informer et diffuser la « culture » et « l’état d’esprit » du logiciel libre, pris au sens large (et nébuleux) du terme.
Framatube, contraction pas forcément heureuse mais en tout cas signifiante de Framasoft et YouTube, a récemment franchi le cap symbolique des 100 vidéos (104 pour être précis), presque toutes en français ou sous-titrées, offrant par là-même un catalogue « spécialisé » qui pourra être utile à toute personne souhaitant s’informer et diffuser la « culture » et « l’état d’esprit » du logiciel libre, pris au sens large (et nébuleux) du terme.
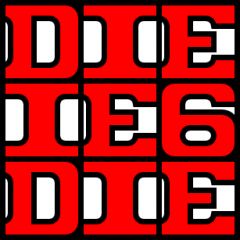 Mon titre est un peu accrocheur et inexact mais il témoigne d’un mouvement d’origine norvégienne de
Mon titre est un peu accrocheur et inexact mais il témoigne d’un mouvement d’origine norvégienne de 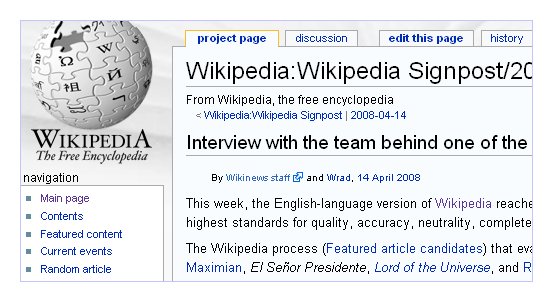
 Prof. Jon Beasley-Murray : En premier lieu, je voudrais dire que j’ai déjà écrit quelques réflexions à propos du projet sur Wikipédia même, c’est un essai que j’ai intitulé « Madness ».
Prof. Jon Beasley-Murray : En premier lieu, je voudrais dire que j’ai déjà écrit quelques réflexions à propos du projet sur Wikipédia même, c’est un essai que j’ai intitulé « Madness ». Il faut dire aussi que peu de gens du monde universitaire comprennent l’esprit des wikis. Il leur (nous) est difficile de ne pas se (nous) montrer possessifs vis-à-vis de leur (notre) travail. Je crois que c’est de là que naissent les antagonismes et la frustration que ressentent les universitaires lorsqu’ils s’impliquent sur Wikipédia. C’est rarement « l’expertise » qui est en cause mais plutôt la propriété. Je reconnais que je ne suis pas très précis, mais par exemple un wiki avait été mis en place dans mon université, mais il était impossible de modifier le texte de quelqu’un d’autre. On aurait très bien pu alors afficher des pdf. C’était plus un exercice de monographie qu’un exercice d’écriture collaborative.
Il faut dire aussi que peu de gens du monde universitaire comprennent l’esprit des wikis. Il leur (nous) est difficile de ne pas se (nous) montrer possessifs vis-à-vis de leur (notre) travail. Je crois que c’est de là que naissent les antagonismes et la frustration que ressentent les universitaires lorsqu’ils s’impliquent sur Wikipédia. C’est rarement « l’expertise » qui est en cause mais plutôt la propriété. Je reconnais que je ne suis pas très précis, mais par exemple un wiki avait été mis en place dans mon université, mais il était impossible de modifier le texte de quelqu’un d’autre. On aurait très bien pu alors afficher des pdf. C’était plus un exercice de monographie qu’un exercice d’écriture collaborative. Monica Freudenreich : Je ne peux pas parler au nom de toute la classe, mais je crois que nous étions tous un peu hésitants. Nous n’avions jamais été confrontés dans notre cursus à un projet d’une telle envergure et nous ne savions pas vraiment ce qui allait en ressortir, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous autres étudiants, nous avons l’habitude de toujours faire les choses à la dernière minute et pour ce projet ça n’était vraiment pas possible. Et donc, malgré un démarrage assez poussif dans l’ensemble, je pense que le statut que la plupart des articles du projet ont atteint est vraiment impressionnant et que cette réussite est une énorme motivation en elle-même.
Monica Freudenreich : Je ne peux pas parler au nom de toute la classe, mais je crois que nous étions tous un peu hésitants. Nous n’avions jamais été confrontés dans notre cursus à un projet d’une telle envergure et nous ne savions pas vraiment ce qui allait en ressortir, c’est le moins que l’on puisse dire. Nous autres étudiants, nous avons l’habitude de toujours faire les choses à la dernière minute et pour ce projet ça n’était vraiment pas possible. Et donc, malgré un démarrage assez poussif dans l’ensemble, je pense que le statut que la plupart des articles du projet ont atteint est vraiment impressionnant et que cette réussite est une énorme motivation en elle-même.

 En ce début d’investiture Obama, de nombreux internautes expriment souhaits et desiderata à la nouvelle administration.
En ce début d’investiture Obama, de nombreux internautes expriment souhaits et desiderata à la nouvelle administration.