Et si l’on créait ensemble une forge libre pour les métiers de l’édition ?
 Voilà, on y est. Après la musique, c’est désormais la sphère du livre qui est pleinement impactée, voire bousculée, pour l’arrivée inopinée et intempestive du numérique.
Voilà, on y est. Après la musique, c’est désormais la sphère du livre qui est pleinement impactée, voire bousculée, pour l’arrivée inopinée et intempestive du numérique.
Le second connaîtra-t-il les mêmes difficultés et résistances que le premier ?
On en prend le chemin… Sauf si l’on décide de s’inspirer fortement de la culture et des outils du logiciel libre.
Le samedi 24 septembre prochain, dans le cadre du BookCamp Paris 4e édition, Chloé Girard animera avec François Elie un atelier intitulé « Fabrication mutualisée d’outils libres pour les métiers de l’édition ».
Il s’agira de réflechir ensemble à comment « soutenir et coordonner l’action des professionnels du livre pour promouvoir, développer, mutualiser et maintenir un patrimoine commun de logiciels libres métiers » en développant notamment un forge dédiée destinée à « l’ensemble des acteurs de l’édition (éditeurs, distributeurs, diffuseurs, privés, publics, académiques…) »
L’expérience et l’expertise du duo sont complémentaires. François Elie, que les lecteurs du Framablog connaissent bien, sera en effet ici Monsieur Forge (en théorie dans son livre Économie du logiciel libre et en pratique depuis de nombreuses années au sein de la forge pour les collectivités territoriales ADULLACT). Chloé Girard, partenaire de Framasoft dans le cadre du projet Framabook, fera quant à elle office de Madame Métiers de l’édition.
C’est un entretien avec cette dernière que nous vous proposons ci-dessous.
C’est évidemment l’occasion de mieux connaître l’ambition et l’objectif de cette forge potentielle, en profitant de la tribune pour lancer un appel à compétences. Mais nous avons également eu envie d’en savoir davatange sur la situation générale et spécifique de l’édition d’aujourd’hui et de demain, sans taire les questions qui fâchent comme celle concernant par exemple Google Books 🙂
Remarque : Même si le site est encore en construction, nous vous signalons que les avancées du projet pourront être suivies sur EditionForge.org.
Edit : Finalement François Elie ne sera pas disponible pour l’atelier. Mais il reste bien entendu partie prenante du projet.
Une forge Métiers de l’édition – Entretien avec Chloé Girard
Chloé Girard bonjour, peux-tu te présenter succinctement à nos lecteurs ?
 Je travaille depuis quatre ans avec David Dauvergne au développement d’un logiciel libre pour les éditeurs, La Poule ou l’Oeuf. C’est une chaîne éditoriale destinée à une édition mixte, papier et électronique.
Je travaille depuis quatre ans avec David Dauvergne au développement d’un logiciel libre pour les éditeurs, La Poule ou l’Oeuf. C’est une chaîne éditoriale destinée à une édition mixte, papier et électronique.
Nous avons parallèlement créé une entreprise de service en informatique libre pour l’édition et travaillons avec plusieurs éditeurs et prestataires de services aux éditeurs pour de la production, parfois industrielle, de livres numériques. Nous travaillons également à la mise en place d’un processus interne de fabrication électronique lié au traditionnel processus papier.
Je suis également responsable de fabrication papier et électronique pour l’éditeur suisse d’érudition La Librairie Droz, et aborde le problème depuis le point de vue de l’éditeur, aspect financier compris.
Je suis donc au croisement entre l’édition associative, l’intégration et le service en logiciel libre métier et la fabrication de livres, papier et numérique chez un acteur traditionnel de la profession. Ces différentes expériences m’ont naturellement portées à me poser certaines questions qui sont à l’origine de mon intérêt pour cette notion de forge. Questions que nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à nous poser. Les différents BookCamp, salons du livre, commissions du CNL (Centre national du livre), associations professionnelles et éditeurs s’interrogent eux aussi sur les besoins, les outils, les limites, les possibles interactions, les manques, les évolutions, les formes, ou encore les formats dans la fabrication et l’exploitation des livres dans leur(s) version(s) numérique(s).
Comment vois-tu l’évolution actuelle du monde de l’édition, fortement impacté si ce n’est secoué, par les nouvelles technologies ?
Chez les petits éditeurs rien n’a changé. Les processus de fabrication sont toujours les mêmes, les livres sont conçus pour sortir en version papier, les processus de fabrication électronique, quand il y en a, sont externalisés et fortement subventionnés. Car peu d’éditeurs ont les ressources techniques, humaines et financières pour mettre au point de nouveaux mode de production en interne. Et leurs partenaires traditionnels n’en savent souvent pas plus qu’eux, d’autant que la question se pose encore de ce qu’il faut faire, de la pérénité des sources électroniques produites aujourd’hui, de ce qu’il faudra re-produire demain. Le marché s’amorce grace aux subventions à la production électronique. Elles se tariront forcément une fois le marché établi.
Pour autant il faudra bien le suivre ! Or les acteurs en bout de chaîne sont difficilement contrôlables. Par exemple les exigences de validité des fichiers ePUB par Apple sur le eBook Store changent régulièrement et renvoient des messages d’erreur que seuls des développeurs peuvent comprendre, et encore. Bref, beaucoup reste à faire. Une chose a changé au cours des trois dernières années c’est que les éditeurs ont compris qu’ils n’ont plus d’autre que d’y aller.
Je pense qu’il faut donner les moyens à tous les éditeurs de prendre les rênes de ces nouvelles technologies pour maintenir dans l’offre électronique une diversité de contenus et de formes que eux seuls, avec leurs auteurs, peuvent imaginer.
Une « forge Métiers de l’édition », mais quel est donc cet ambitieux nouveau projet ?
Une forge est une forme de département de recherche et développement (R&D) externalisé et, surtout, mutualisé. L’idée est de donner aux professionnels de l’édition les moyens de faire développer et évoluer ensemble les logiciels dont ils ont besoin pour leur métier.
Cela consiste en deux choses : d’une part réunir en un même lieu, atelier et magasin, les outils et compétences informatiques qui peuvent travailler ensemble, si nécessaire. Et, d’autre part, encadrer les éditeurs, imprimeurs, distributeurs, dans la rédaction des cahiers des charges de ces nouveaux outils (bureau d’étude).
Évidemment il est plus que souhaitable que ces outils soient libres, pour des questions d’interopérabilité, d’extensibilité, de transfert de compétences… mais aussi d’économies. Le code étant libre il est payé une fois pour son développement puis disponible pour tous. Disponible pour utilisation mais aussi pour le faire évoluer en fonction de nouveaux besoins, de nouveaux outils, de nouveaux support…
Tu évoques aussi « une place de marché entre clients métier, entrepreneurs et communauté du logiciel libre ». Peux-tu nous en dire plus et nous donner quelques exemples réels ou fictifs de situations où la forge est potentiellement un avantage ?
Les forges logicielles, horizontales, réunissent les acteurs du développement d’une application. Ici nous avons une forge cliente mise en place par les utilisateurs (professionnels de l’édition) qui y rencontrent les développeurs (représentés par les forges logicielles) aussi bien que les sociétés leur permettant de créer et de mettre en production ces outils. Les professionnels de l’édition peuvent donc lancer des appels d’offre auprès de prestataires qui peuvent y répondre ensemble ou séparément. Nous avons donc une réelle place de marché métier avec des clients et des vendeurs.
L’intérêt, par rapport à un système d’achat/vente classique de service informatique, c’est la mutualisation des expertises, du code et des services. Les éditeurs aujourd’hui rencontrent de nouveaux besoins, très techniques. Juger de la façon d’y répondre demande une expertise rare et coûte cher (voire très cher). Très peu d’éditeurs savent et peuvent assumer cela seuls et risquent d’y perdre beaucoup.
Imaginons qu’un éditeur convertisse aujourd’hui son catalogue d’ouvrages dans un format donné de livres électroniques. Que fera-t-il, ou plutôt comment fera-t-il si les supports de lecture de livre de demain, ebooks, tablettes ou PC, lisent un autre format que celui-là ou une version plus récente ? Nous sommes ici dans une situation parfaitement concrète et déjà réelle.
Sachant que la conversion d’un ouvrage papier en ePUB aujourd’hui coûte au minimum 1€ la page, qu’environ 60 000 ouvrages sont publiés par an en France et que le patrimoine à convertir regroupe des centaines de milliers d’ouvrages on peut imaginer les conséquences s’il faut re-produire ces fichiers.
Aujourd’hui cette conversion est largement subventionnée. Mais lorsque le marché du livre électronique sera suffisamment amorcé, ces subventions baisseront ou disparaîtront. Il faudra alors que les éditeurs assument seuls l’évolution de leur catalogue électronique. Et qu’ils en assurent l’évolution régulière. Une forge leur permettrait par exemple, si le format de départ est ouvert, de faire développer collectivement un outil de mise à jour automatisée du catalogue. Et de faire évoluer cet outil, avec une réactivité bien plus importante que s’il fallait attendre d’un éditeur de logiciel propriétaire qu’il décide lui-même de la sortie de la mise à jour nécessaire.
Les éditeurs y gagnent en matière d’autonomie, de réactivité sur leur marché et de capacité d’innovation. D’autant que les acteurs logiciels de la forge peuvent y déposer des « appels de demandes » c’est-à-dire des propositions d’innovation ou de développements auxquels les clients n’auraient pas forcément pensé. On a donc un lieu de propositions techniques en même temps que de marché, dans un cadre d’expertise partagée.
L’exemple simple d’évolutivité des formats est un problème que les éditeurs connaissent déjà bien ou qui les retient de se lancer dans l’édition numérique. Mais ils sont confrontés à bien d’autres problèmes : la réunion des processus papier et électronique (PDF imprimeur/ePUB, XML InDesign/XML divers…), l’exploitation des contenus en réseau (schémas de métadonnées, protocoles de communication entre catalogues et serveurs, schémas XML de description de contenus), le chiffrement des fichiers électroniques garantissant l’intégrité d’un document, l’enrichissement d’un ouvrage avec des contenus dynamiques ou multimédia, le lien livres et réseaux sociaux, l’offre de sorties s’adaptant à des écrans divers (graphisme), à des lecteurs divers (niveau de lecture, multilinguisme), sans perdre la notion de référence intellectuelle commune, les livres-applications, la gestion documentaire, les liens éditeurs/distributeurs/diffuseurs, la gestion des droits d’auteur, le lien entre l’exploitation du catalogue et les outils internes de gestion, de facturation, etc. Et encore, ces exemples ne sont qu’un petit apperçu des besoins et questions. Sachant que les réponses vont devoir évoluer au même rythme que les supports de lecture et les systèmes d’exploitation. Et que les problématiques ne sont pas les mêmes selon que l’on édite des romans, des thèses, des livres d’art, des manuels scolaires de la documentation technique ou des revues scientifiques.
Évidemment, chaque éditeur peut faire développer ses propres outils ou payer des licences pour chaque logiciel nécessaire. Mais gérer l’interopérabilité entre ces applications et un système un peu intégré deviendra impossible ou extrêmement onéreux. J’en suis témoin au quotidien. Les professionnels de l’édition ne pourront suivre l’évolution de leur métier, et la maîtriser, que collectivement.
Sauf s’ils décident de tout confier à Google Books !
Il faut considérer Google comme un prestataire comme les autres. Sauf que, étant donné la puissance du prestataire il vaut mieux être théoriquement et technologiquement averti et exigeant ! D’où la nécessité d’avoir ses propres outils pour ne pas être trop vulnérable.
En ce qui concerne leurs livres épuisés Google offre aux éditeurs une solution de facilité pour remettre sur le marché des livres qui n’y sont plus et n’y seront plus sans cela, étant donné le coût que cela représente. Pourquoi pas. La difficulté est alors de rester maître du cahier des charges et il vaut sans doute mieux posséder ses propres sources à négocier auprès de Google Books que de laisser Google convertir puis discuter des conditions.
Dans le passé beaucoup d’éditeurs ont confié la mise en page et l’impression de leurs ouvrages à des prestataires extérieurs, plus petits, plus locaux que Google, sans jamais réclamer en retour ni leurs fichiers natifs ni même les PDF imprimeurs ! Ils sont ainsi aujourd’hui dans certains cas obligés de racheter leurs propres fichiers à ces prestataires ou repartent du papier pour reconstituer leurs sources ! À eux de voir si ils veulent renouveler l’expérience.
Avoir des outils disponibles pour produire leurs sources efficacement et les faire évoluer, leur permettrait de négocier différemment avec Google aujourd’hui mais aussi demain. Parce que demain Google va offrir de nouveaux services sur ces sources. S’il est encore le seul à pouvoir, techniquement, les offrir, il sera à nouveau en position de force. Or ces épuisés constitueront sans doute une part non négligeable des ventes. Il vaut donc mieux se préparer à récupérer ces sources et à les exploiter intelligemment soi-même. Face aux équipes de développement de Google un éditeur seul, ou n’importe lequel de ses prestataires en édition numérique, à intérêt à avoir de sacrés moyens pour offrir des solutions concurrentes.
Pour les publications récentes et nouvelles la question se pose différemment. La question n’est pas seulement de mettre en ligne, de mettre à disposition pour achat, mais bien aussi de créer des versions numériques qui apportent quelque chose de plus par rapport au papier : pour le lecteur, pour l’exploitation des savoirs, pour la conservation du patrimoine. C’est un acte éditorial, ce n’est donc pas Google qui peut s’en charger.
Après, si Google offre des solutions libres assurant l’interopérabilité avec les outils internes de fabrication et de gestion des éditeurs, distributeurs, imprimeurs, etc. Si Google produit des sources ouvertes que les éditeurs peuvent récupérer, retirer, si l’on peut interfacer des outils libres de gestion de droits avec Google Books, si… alors bienvenue à Google au sein de la forge « métiers de l’édition » ! À voir…
Face à Google comme face à n’importe quel prestataire et plateforme d’exploitation il faut que les éditeurs travaillent ensemble, et avec leurs distributeurs, diffuseurs, etc, à des solutions qui leurs permettent de maîtriser leurs oeuvres et leur métier.
Après Google, en quoi cette forge se distingue-t-elle des API censés « ouvrir le contenu aux développeurs » telles que proposées par Amazon ou tout récemment par Pearson ?
L’initiative de Pearson est géniale ! « L’idée est de regarder si la créativité des développeurs permet d’amener l’exploitation de ces contenus dans des directions que les éditeurs n’avaient pas explorées jusqu’alors ». Mais ce qui est intéressant dans l’article de Guillaud c’est aussi sa dernière phrase : « Assurément, Pearson lance un mouvement que les plus gros ne devraient pas tarder de prolonger… »
Que vont faire les petits et moyens éditeurs pendant ce temps-là ? Et les diffuseurs, les libraires ? Je crois que la forge, la mutualisation, un patrimoine d’outils communs, leur permettront justement d’accéder à ce type de moyens d’exploitation, de plateformes éditoriales ouvertes aux codeurs, aux innovations. Demandez aux éditeurs, au hasard, si ils savent ce qu’est une API ! Il faut une sacrée expertise pour mettre en oeuvre ce type d’accès et les faire évoluer, sur les plans technique mais aussi juridique d’ailleurs. Même les gros éditeurs ont besoin, pour la plupart, de mutualiser, au moins en partie, les frais de R&D pour développer et innover dans de tels services. Or c’est ce que tous cherchent à faire. Mais je ne suis pas sûre que Pearson va leur donner ses trucs demain !
Est-ce une application directe et concrète des propositions de François Elie dans son livre Économie du logiciel libre ?
Oui, absolument. Et François Élie nous accompagne dans la réflexion et la présentation du projet, fort de son expérience de l’Adullact (Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l’Administration et les Collectivités Territoriales) et de son verbe coloré. La killer application openCimetiere fait toujours son petit effet !
« On ne peut utiliser que des logiciels qui existent » et « un logiciel libre est gratuit une fois qu’il a été payé ». Ces deux phrases extraites de son livre résument bien l’intérêt que peuvent trouver clients et développeurs libres au sein d’une telle forge : 1) coté client : maîtriser ses outils métier, gagner en réactivité, faire, éventuellement, des économies 2) coté développeurs : financer en amont le développement libre, intégrer une place de marché active réunissant des compétences multiples pour ne pas réinventer la roue.
Quels sont les principaux freins que vous risquez de rencontrer et qu’il faudra dépasser d’après toi ? Le poids des habitudes ? L’absence d’une réelle culture de la mutualisation ? La concurrence non libre ?
La forge Adullact, comme son nom l’indique, s’adresse à des clients et des fonds publics. L’idée de dépenser des fonds publics une seule fois pour tous est (semble !) naturelle. Dans le cas d’une forge métiers de l’édition nous nous adressons en grande partie à des acteurs privés. Et le premier frein que nous avons rencontré est bien celui de la mutalisation des fonds : « pourquoi est-ce que je paierais pour des logiciels dont tous bénéficieront, y compris ceux qui n’auraient pas participé ? » Le problème n’est pas seulement celui du partage mais de la perte d’un avantage concurenciel.
En ce qui concerne le partage ce n’est pas très difficile à argumenter : ceux qui en profiteront ne tarderont pas à participer, à hauteur de leurs moyens et de leurs besoins. D’autre part plus un logiciel sera utilisé plus il sera pérenne.
Pour la question de la concurrence c’est plus délicat puisque le service autour des livres électroniques devient un enjeu économique. Il ne s’agit plus seulement de vendre des exemplaires mais aussi des services sur les contenus. Or les outils de fabrication ont un impact sur les possibilités de services commerciaux en aval. Imaginons par exemple un outil offrant de fabriquer des livres avec plusieurs niveaux de contenus auxquels les lecteurs auraient accès ou non selon qu’ils sont acheteur unique, abonnés ou abonnés premium.
Mais les éditeurs sont libres de faire développer certains outils, qui leurs semblent moins concurrenciels dans cette logique de mutualisation, et de faire développer chacun pour soi des extensions ou des modules d’exploitation qui leurs seraient propres. Une forge n’implique pas d’y faire produire tous ses projets. Quitte à se rendre compte finalement qu’il est plus intéressant de les y verser pour les faire maintenir et évoluer collectivement.
Cette logique de mutualisation dans une économie privée et auprès d’acteurs dont les finances sont souvent fragiles n’est pas gagné. Pourtant nous travaillons avec plusieurs éditeurs qui en rêvent. Ils n’ont ni les compétences ni les moyens de faire développer seuls les outils qu’il leur faut et que personne ne leur propose aujourd’hui.
Un autre obstacle est l’absence de culture du logiciel libre dans l’édition : elle était celle que l’on peut imaginer dans un milieu très peu technophile et surtout préoccupé de ne pas avoir à mettre les mains dans le cambouis, l’image du logiciel libre étant celle de la ligne de code dans un terminal. D’autant que les besoins étaient en (très) gros jusqu’ici celui d’un seul outil, de mise en page, propriétaire, cher, produisant un PDF, unique besoin des imprimeurs.
Depuis quelques années la notion de format ouvert fait cependant son chemin, notamment avec le format ePUB et le XML. Mais on est encore dans la logique du bon format, plutôt que dans celle du format ouvert.
J’ai quand même entendu il y a un an et demi un responsable de l’édition électronique chez un éditeur important affirmer qu’il n’utiliserait plus en fabrication que des logiciels libres. Pour des questions de pérénité et de maîtrise de son catalogue.
Mais pour répondre à cela il faut des acteurs et des outils libres qui répondent aux besoins de marchés importants, de volumes importants et d’éditeurs pressés. Il faut des partenaires libres solides, aisément identifiables, dans un écosystème libre métier qui permet de répondre rapidement aux évolutions des besoins.
C’est ce à quoi nous appelons aujourd’hui. Nous devons présenter dès l’origine de cette forge les acteurs du logiciel libre, éditeurs de logiciels, communautés, intégrateurs, pertinents, compétents et innovants pour répondre aux besoins de ces métiers. Nous connaissons un certains nombre de ces ressources et acteurs, mais pas tous. D’autant que certaines des compétences dont ont besoin les éditeurs aujourd’hui étaient jusque-là exploitées dans d’autres domaines métiers, telles que la gestion documentaire.
Nous avons besoin de constituer un catalogue de ressources libres à présenter aux éditeurs pour amorcer cette forge.
Ensuite se posera la question de sa gouvernance puisque, comme pour l’Adullact, la forge est un outil monté par les clients pour les clients, donc par les éditeurs pour les éditeurs. Je pense qu’une association professionnelle métier devrait prendre en charge ce projet comme une forme de nouveau service offert à ces membres.
Deux réunions sont prévues pour envisager concrêtement les actions à mettre en oeuvre pour que cette forge soit effective : le 24 septembre au BookCamp Paris 4 qui se tiendra au Labo de l’Édition (atelier 13) et début octobre dans une réunion organisée par le MOTif, organisme de politique du livre de la Région Île de France.



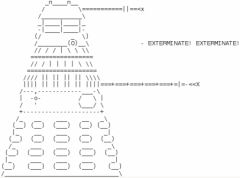


 Il y a tout juste vingt ans, un jeune étudiant en informatique finlandais,
Il y a tout juste vingt ans, un jeune étudiant en informatique finlandais, 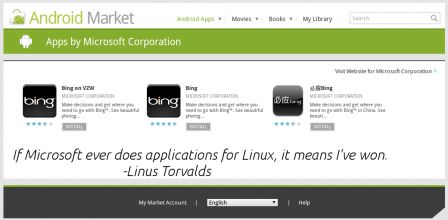
 Ce qui nous invite à nous interroger sur les modalités d’expression de la persona publique de Linus Torvalds. D’une génération (et d’une culture politique) différente de celle de
Ce qui nous invite à nous interroger sur les modalités d’expression de la persona publique de Linus Torvalds. D’une génération (et d’une culture politique) différente de celle de  « Papa, tu faisais quoi quand les crédits Facebook sont devenus l’unique moyen de paiement sur internet ? »
« Papa, tu faisais quoi quand les crédits Facebook sont devenus l’unique moyen de paiement sur internet ? » Les 24 et 25 mai derniers se tenait à Paris le « Forum e-G8 », en prélude au
Les 24 et 25 mai derniers se tenait à Paris le « Forum e-G8 », en prélude au  « Un certain nombre de forces convergentes vont faire passer la fabrication personnelle, ou autofabrication, du statut de technologie marginale utilisée par les seuls pionniers et passionnés à un outil quotidien pour le consommateur et l’entreprise lambda.
« Un certain nombre de forces convergentes vont faire passer la fabrication personnelle, ou autofabrication, du statut de technologie marginale utilisée par les seuls pionniers et passionnés à un outil quotidien pour le consommateur et l’entreprise lambda.