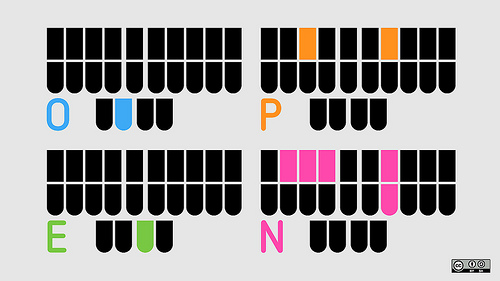Chaque jeudi à 21h, rendez-vous sur le framapad de traduction, le travail collaboratif sera ensuite publié ici même.
Traduction Framalang : Lycoris, grosfar, merlin8282, Sky, Julius22, _noskill, Nyx, lenod, KoS, lerouge, alexb, Ex0artefact, name?, SaSha_01, peupleLà, lamessen
Prendre de la distance pour atteindre l’excellence
Jono Bacon
Jono Bacon est gestionnaire de communauté, directeur technique, consultant et auteur. Il travaille actuellement comme gestionnaire de la communauté Ubuntu chez Canonical. Il dirige une équipe afin de faire croître, de stimuler et d’enthousiasmer l’ensemble de la communauté Ubuntu. Il est l’auteur d’Art of Community, le fondateur du Community Leadership Summit et le cofondateur du populaire podcast LugRadio.
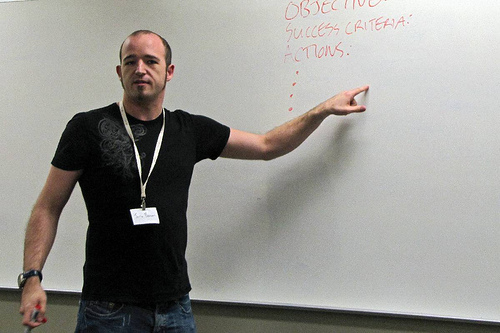 Jono Bacon au tableau blanc
Jono Bacon au tableau blanc
La première fois que j’ai entendu parler de Linux et d’open source remonte à 1998. La technologie était alors horriblement compliquée et il fallait fournir de gros efforts pour obtenir un système qui tourne correctement ; pourtant, le concept d’une communauté collaborative globale me subjugua. À l’époque, je ne possédais aucune connaissance, mes compétences techniques étaient limitées et j’avais des boutons.
J’étais un adolescent typique : tourmenté, cheveux longs, T-shirt Iron Maiden. Mon chemin était déjà tout tracé, au sens le plus traditionnel ; j’irais à l’école, puis au lycée, puis à l’université, puis je trouverais un travail.
Quatorze ans plus tard, le chemin que j’ai finalement suivi n’a rien de conventionnel. Cette fascination personnelle envers le communautaire m’a conduit partout dans le monde et m’a lancé des défis captivants. C’est intéressant de prendre du recul et d’analyser cette période. Enfin, ça pourrait être intéressant pour moi… Vous préférerez peut-être passer au chapitre suivant…
… Toujours avec moi ? OK, allons-y.
La science contre l’art
J’ai toujours cru que la gestion d’une communauté était moins une science qu’un art. Je définis la science comme l’exploration de méthodes permettant de reproduire des phénomènes à travers des étapes établies et clairement comprises. Dans le monde de la science, si vous connaissez la théorie et la recette pour un résultat donné, vous pouvez souvent reproduire ce résultat comme tout un chacun.
L’art est différent. Il n’y a pas de recette pour produire une chanson populaire, pour créer une peinture exceptionnelle ou pour sculpter une statue magnifique. De même, il n’y a pas vraiment d’ensemble d’étapes reproductibles pour créer une communauté prospère. Bien sûr, il y a des astuces et des techniques pour parvenir à réunir certaines composantes du succès, mais c’est la même chose pour les autres formes d’art : nous pouvons tous apprendre les notes et les accords d’une guitare, mais cela ne veut pas dire que nous allons écrire la prochaine Bohemian Rhapsody. La formule qui donne naissance à un titre comme Bohemian Rhapsody, c’est une dose de compétence acquise et une dose de magie.
Je ne suggère cependant pas que la gestion de communauté soit une forme d’art désespérément branchée et introvertie que seuls quelques bienheureux élus très talentueux peuvent accomplir. Ce dont je me plains est qu’il n’y ait pas de manuel sur la façon de créer une communauté magnifique et enthousiasmante ; il s’agit toujours d’une dose d’apprentissage et d’une dose de magie mais la part de magie ne vous sera pas insufflée par la grâce des dieux ; il vous faudra plutôt la chercher en essayant de nouvelles voies, en restant à l’écoute des retours et en évaluant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
C’est plutôt frustrant car cela veut dire que cette « magie » ne s’obtient pas en suivant une recette unique. Mais il reste la possibilité de partager les compétences acquises, comme j’ai cherché à le faire avec The Art of Community 1 et la conférence annuelle Community Leadership Summit 2.
Avant de commencer mon introspection, et pour ceux que ma carrière n’ennuie pas mortellement, je vais résumer rapidement les communautés avec lesquelles j’ai travaillé afin de poser le contexte. En bref, j’ai commencé dans mes jeunes années chevelues par la création de l’un des premiers sites web communautaires britanniques sur Linux, appellé Linux UK, et j’ai intégré la communauté des Groupes d’utilisateurs de Linux (Gul). Je me suis ensuite lancé dans la création de mon propre Gul à Wolverhampton, au Royaume-Uni, et j’ai fondé le projet Infopoint pour encourager les Gul à prêcher Linux sur les salons informatiques du Royaume-Uni. J’ai ensuite poursuivi en contribuant à la communauté KDE et en fondant le site KDE::Enterprise ; j’ai établi le KDE Usability Study et contribué de-ci, de-là à diverses petites applications. J’ai ensuite fondé le groupe d’utilisateurs PHP des West Midlands. J’ai aussi commencé à m’intéresser à GNOME. J’ai développé quelques applications (GNOME iRiver, XAMPP Control panel, Lernid, Acire) et également participé à la conception et un peu au code d’une nouvelle application audio simplifiée appelée Jokosher. C’est à peu près à cette époque que j’ai co-fondé le podcast LugRadio qui fonctionna pendant quatre ans avec plus de deux millions de téléchargements, ce qui a entraîné la mise en place de cinq événements en direct au Royaume-Uni et aux États-Unis. À cette époque, j’ai également commencé à travailler comme consultant open source pour l’initiative publique OpenAdvantage. Là, j’ai vraiment eu l’occasion de me faire les dents sur le communautaire en aidant des organisations à travers tout les West Midlands à passer à l’open source. Après quelques années passées chez OpenAdvantage, je suis parti rejoindre Canonical comme gestionnaire de la communauté Ubuntu où j’ai mis en place une équipe de quatre personnes. Ensemble, nous nous investissons dans des projets très variés chez Ubuntu et Canonical. Vous êtes toujours là ?
Ouah, vous êtes tenace. Ou assommé d’ennui. Probablement assommé. Il y aura interro à la fin, ça vous apprendra…
Réfléchir
Ceci m’amène donc à l’objet de cet article : la curieuse question de savoir ce que je me dirais si je savais ce que je sais aujourd’hui. À ce jour, je pense que ce que j’ai appris au cours de ma carrière peut se diviser en deux grosses catégories :
Pratique — les trucs et astuces du métier, par exemple, les différentes approches des moyens de communication, les différentes façons d’utiliser la technologie, la gestion du temps, les différentes approches de la gestion de projet, etc.
Personnel — les leçons de vie et apprentissages qui modifient l’approche que nous avons de notre monde.
Je ne vais pas m’étendre sur la catégorie pratique — vous devriez lire mon livre si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet (le livre couvre aussi l’aspect personnel). Aujourd’hui, je vais plutôt m’intéresser aux leçons de vie. Les approches et les pratiques changeront toujours, mais les leçons que l’on en tire ne changent pas tant que ça : elles évoluent plutôt au fur et à mesure que votre sagesse grandit.
L’importance des convictions
Les communautés sont fondamentalement des réseaux de personnes poussées par leurs convictions. Chaque communauté possède son propre état d’esprit et un domaine d’expertise propre. Cela peut être une idée aussi grandiose que de rassembler l’intégralité des savoirs de l’humanité, changer la face du monde avec le logiciel libre ou, plus simplement, animer un « club » pour que les gens puissent échanger autour de leurs livres préférés. Que ce soit pour changer le monde ou simplement pour s’amuser, chaque communauté fait valoir son propre système de valeurs ; l’humble club de lecture accorde beaucoup de valeur au fait de fournir un environnement amusant, sécurisé et libre afin de pouvoir partager des avis et des conseils de lecture. Cela ne change pas le monde, mais cela reste toujours une bonne chose à laquelle n’importe qui peut se rallier.
La règle, souvent tacite, d’une communauté est que chaque contribution d’un membre de la communauté doit bénéficier à l’ensemble de celle-ci. C’est pourquoi il est amusant d’écrire un correctif pour un bogue d’un logiciel libre, de contribuer à la documentation ou d’organiser un événement gratuit. Mais il est rare que quiconque veuille contribuer de façon bénévole si sa contribution ne bénéficie qu’à une seule personne ou entreprise.
Bien sûr, je suis certain que vous tous, enfoirés cyniques que vous êtes, allez chercher et trouver une exception. Mais souvenez-vous que cette décision est profondément personnelle : les membres de la communauté décident par eux-mêmes si leur contribution doit bénéficier à tous. Par exemple, certains vont arguer que n’importe quelle contribution à Mono va seulement bénéficier à Microsoft et à l’ubiquité de leur infrastructure .NET. Mais des centaines de contributeurs participent à Mono parce qu’ils ne le voient pas de cette manière : ils voient leurs contributions comme un moyen utile et amusant de permettre aux développeurs d’écrire des logiciels libres plus facilement.
Si je devais parler au Jono de 1998, j’insisterais sur l’importance de cette conviction. J’avais alors une intuition à ce propos, mais je ne compte plus les exemples qui m’ont prouvé depuis que cette conviction incite réellement les gens à participer. J’ai souvent parlé de l’histoire du gamin d’Afrique qui m’a envoyé un courriel pour me dire qu’il devait marcher trois heures aller-retour jusqu’au cybercafé le plus proche pour contribuer à Ubuntu. Il le faisait car il était convaincu par notre mission d’apporter le logiciel libre aux masses. On pourrait aussi citer l’énorme croissance de Wikipédia, l’incroyable réunion de la communauté GNOME autour de GNOME 3, le succès d’OpenStreetMap et bien d’autres exemples.
Ceci dit, la conviction n’est pas juste un artifice pour les relations publiques. Il faut qu’elle soit réelle. Bien que nous ayons tous des convictions différentes — certains ont des convictions sur le logiciel, sur l’éducation, sur le savoir, sur la transparence ou sur n’importe quoi d’autre — vous ne pouvez pas fabriquer un système de convictions à moins qu’il n’ait un but valide, auquel un groupe puisse s’intéresser. Certes, il peut être obscur, mais il doit être réel. Avec le succès du mouvement open source, nous avons vu des exemples d’entreprises qui tentaient de jouer cette approche et ce registre sémantique autour de la conviction, mais dans le but de servir leurs propres besoins. Je pourrais essayer de vous faire adhérer à cette idée : « Travaillons tous ensemble pour aider Jono à devenir riche » et fabriquer de toutes pièces quelques sophismes pour justifier de cette acte de foi (par exemple, si j’étais riche, je pourrais me concentrer sur d’autres travaux, au bénéfice d’autres communautés ; mes enfants seraient élevés et éduqués dans de bien meilleures conditions, ce qui profiterait à tout le monde), mais ce serait n’importe quoi.
En tant que telle, la conviction est un puissant moteur pour la contribution comme pour la collaboration, mais il est important de l’utiliser de manière équilibrée et de l’associer au respect. Alors qu’elle peut déclencher d’incroyables changements, elle peut être terriblement dévastatrice (comme c’est le cas avec certains prédicateurs à la TV qui utilisent la religion comme un moyen de vous soustraire de l’argent, ou encore les faux médiums qui utilisent la lecture à froid et s’accrochent à votre besoin désespéré de croire que vous pouvez à nouveau vous connecter à un être cher disparu).
Votre rôle
Aujourd’hui, les gestionnaires de communauté ont un rôle intéressant. Par le passé, j’avais parlé de deux types de gestionnaires de communauté ; ceux qui sortent, font des conférences et s’agitent en parlant d’un produit ou d’un service et ceux qui travaillent avec une communauté de volontaires pour les aider à connaître une expérience collaborative, productive et amusante. Le second type m’intéresse plus — je pense que c’est ce que fait un vrai gestionnaire de communauté. Le premier de ces positionnements est tout à fait sympa et respectable mais cela convient mieux dans le domaine de la promotion et des relations publiques et cela nécessite d’autres compétences. J’ai quelques conseils que je pense être assez intéressants pour être partagés.
La première et probablement la plus importante des leçons est d’accepter que vous pouvez et allez parfois avoir tort. Jusqu’ici, dans ma carrière, j’ai fait certaines choses correctement et j’ai commis des erreurs. Bien que je croie être généralement sur le bon chemin et que l’essentiel de mon travail soit couronné de succès, il y a eu quelques flops ici ou là. Ces loupés, accidents et faux pas n’ont jamais été dus à de la malveillance ou de la négligence ; ils ont plutôt été causés par une sous-estimation de la difficulté de mon objectif.
Ça a l’air assez évident, mais ça l’est moins quand vous avez une fonction relativement publique. En gros, les gestionnaires de communautés sont souvents vus comme les représentants d’une communauté donnée. Par exemple, je sais qu’à titre personnel, on me considère comme l’une des figures publiques d’Ubuntu et cette responsabilité, s’accompagne d’une certaine pression publique quant à la manière dont les gens vous perçoivent.
Avoir les projecteurs braqués sur soi en se retrouvant à la tête d’une communauté déclenche chez certains un mécanisme défensif. Ils reculent à l’idée de faire des erreurs en public, comme si les masses dans leurs bavardages s’attendaient à une prestation parfaite. C’est dangereux, et on a déjà vu, par le passé, des personnages publics qui ne reconnaissent jamais avoir fait une erreur par crainte d’être ridicules en public. Non seulement, c’est une idée fausse (nous faisons tous des erreurs), mais cela ne donne pas non plus à la communauté un bon exemple de chef de file honnête et transparent tant dans les choses qu’ils font bien que dans celles qu’ils font moins bien. Il est important de se rappeler que nous gagnons souvent le respect d’autrui par leur acceptation de nos erreurs : c’est la caractéristique d’un individu honnête et accompli.
Je me rappelle mes débuts en tant que responsable chez Canonical. À l’époque, Colin Watson et Scott James Remnant, deux vieux briscards des tous débuts de Canonical et d’Ubuntu, faisaient aussi partie des responsables de l’équipe d’ingénierie d’Ubuntu. Nous avions des réunions hebdomadaires avec notre directeur technique, Matt Zimmerman, et j’y entendais régulièrement Colin et Scott avouer ouvertement qu’ils étaient mauvais dans ceci ou avaient fait une erreur dans cela ; ils étaient étonnamment humbles et acceptaient leurs forces et leurs faiblesses. En tant que responsable débutant, je l’ouvrais moins souvent, mais cela m’a appris que ce genre d’ouverture d’esprit et d’honnêteté est important non seulement en tant que responsable, mais en tant que leader d’une communauté. Depuis, je n’hésite plus à admettre publiquement mes erreurs ou à m’excuser si je foire quelque chose.
Écouter
De même qu’être ouvert aux erreurs est primordial, il est tout aussi important d’être à l’écoute et d’apprendre de ses pairs. Dans de nombreux cas, nos communautés perçoivent les responsables et les leaders de communauté comme des personnes qui devraient toujours fournir des orientations et des directions, mener activement le projet et réaliser ses objectifs. C’est sans aucun doute une responsabilité. Mais tout autant qu’être la voix qui montre la voie, il est important de prêter l’oreille pour écouter, guider quand c’est opportun et apprendre de nouvelles leçons et idées.
Les membres de nos communautés ne sont pas juste des mécaniques froides et insensibles qui font leur travail. Ce sont des humains qui vivent, respirent, ont des opinions, des sentiments et des idées. J’ai vu de nombreux exemples — et j’en ai déjà moi-même provoqué —, de ces situations où quelqu’un est tellement habitué à donner des instructions et des conseils qu’il oublie parfois de simplement s’asseoir, écouter et apprendre de l’expérience de quelqu’un d’autre. Toute industrie possède ses maîtres-à-penser et ses experts… des gens célèbres et reconnus pour leur sagesse. Mais, d’après mon expérience, certaines des leçons de vie les plus révolutionnaires que j’ai apprises sont venues de membres tout à fait anonymes, ordinaires. Savoir écouter les gens n’est pas seulement important pour nous aider à apprendre et à nous améliorer dans ce que nous faisons, c’est également essentiel pour gagner le respect et avoir de bonnes relations avec sa communauté.
Temps de travail contre temps libre
Pendant que je parle de la façon dont nous collaborons avec notre communité, il y a un autre résultat de mon expérience que je n’ai vraiment assimilé qu’assez récemment. Comme beaucoup de gens, de nombreux centres d’intérêts remplissent mes journées. À part être marié et essayer d’être le meilleur mari possible, et à part mon travail quotidien en tant que gestionnaire de la communauté d’Ubuntu, je participe aussi à des projets tels que Severed Fifth, le Community Leadership Summit et quelques autres choses. Comme on pourrait s’y attendre, je consacre mes journées à mon travail rémunéré : au boulot, je ne passe pas de temps à travailler sur ces autres projets. Et, comme on pourrait s’y attendre, lorsque ma journée de travail se termine, je me mets à travailler sur ces autres projets. La leçon qu’il faut retenir ici, c’est qu’il n’est pas toujours clair pour votre communauté de savoir où tracer les limites.
Au fil des années, j’ai développé toute une série de services en ligne que j’utilise tant dans mon travail qu’à titre personnel. Mes comptes Twitter, identi.ca et Facebook, mon blog et d’autres ressources sont les endroits où je parle de ce que je fais. Le problème est que si l’on tient compte de leur caractère public, du fait que je suis un représentant officiel du projet Ubuntu et de tous les fuseaux horaires autour du globe, même Einstein aurait du mal à faire la différence entre ce que j’écris en tant que Jono et ce que j’écris pour le compte de Canonical.
Ce qui a pu causer de la confusion. Par exemple, malgré mes clarifications répétées, OpenRespect n’est pas et n’a jamais été une initiative de Canonical. Bien sûr, quelques idiots ont choisi d’ignorer mes explications à ce sujet mais je comprends néanmoins comment la confusion a pu arriver. La même chose s’est produite pour d’autres projets tels que Severed Fifth, The Art of Community et le Community Leadership Summit, qui ne font pas et n’ont jamais fait partie de mon travail chez Canonical.
C’est une leçon pour moi car j’ai moi-même partagé un moment, cette vision des choses et disais : « Évidemment que c’est activité de loisirs, j’ai posté ça à 20 h. » tout en haussant les épaules à propos de la confusion entre travail et projets personnels. Quand votre travail vous met dans une position relativement publique, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de voir les choses comme ça. Au contraire, vous devez considérer que les gens vont avoir tendance à faire la confusion et que vous allez devoir travailler plus dur pour bien clarifier les choses.
Ne voyagez pas trop
À propos du travail pour une société qui vous a recruté pour être à la tête d’une communauté, vous devriez toujours avoir conscience des risques comme des bénéfices des voyages. C’est une chose que j’ai apprise assez tôt dans ma carrière chez Canonical. Je voyais toujours les mêmes têtes dans les conférences, et il était évident que ces personnes avaient très bien communiqué sur les bénéfices des voyages auprès de leurs employeurs, tout comme je l’avais fait, sauf que j’en ai aussi appris les dangers.
Je voyageais et ce n’était pas seulement un travail fatigant et épuisant psychologiquement, mais j’étais aussi plus loin de mes courriels, moins présent sur IRC, j’étais dans l’impossibilité d’assister à de nombreuses réunions et j’avais moins de temps à consacrer à mes engagements professionnels. Ainsi, mon rôle était principalement devenu de sortir et d’aller assister à des événements et, même si c’était amusant, cela ne rendait pas autant service à ma communauté qu’il l’aurait fallu. Aussi ai-je drastiquement réduit mes déplacements — pour tout dire, je suis allé au Linux Collab Summit il y a quelques jours, et hormis quelques événements d’Ubuntu auxquels je devais assister, je n’ai assisté à aucune conférence depuis près d’un an. J’ai l’impression à présent d’être allé un peu trop loin dans l’autre direction. Tout est donc une question d’équilibre. Mais j’ai aussi le sentiment de mieux servir ma communauté quand je peux prendre le temps d’être au bureau et d’être en ligne et disponible.
La planification
Pour certains, être à la tête d’une communauté, ou simplement l’animer, est un rôle qui tient moins de la structure pré-établie que du fait d’être réactif. À mes débuts, c’est également ce que je pensais. Bien qu’il n’y ait absolument aucun doute sur la nécessité de se montrer réactif et de pouvoir répondre aux choses qui se présentent, il est également essentiel de planifier suffisamment son travail sur une période donnée.
Cette planification devrait être effectuée de manière ouverte quand c’est possible et remplit plusieurs objectifs :
Partager la feuille de route — ça aide la communauté à comprendre sur quoi vous travaillez et lui offre souvent des opportunités de vous aider.
Apporter des garanties — ça prouve qu’un responsable de communauté fait quelque chose. Votre communauté peut constater votre travail effectif à l’œuvre. C’est très important puisque la majeure partie du travail d’un responsable de communauté s’effectue souvent sans que la communauté au sens large en ait connaissance (par exemple, avoir une conversation en tête à tête avec un des membres de la communauté). Et ce manque de visibilité peut parfois générer des inquiétudes sur le fait que peu de choses se produisent dans des domaines-clé alors qu’en fait, beaucoup de choses se produisent en coulisses.
Communiquer les progrès vers le haut et vers le bas de l’organisation — c’est pertinent si vous travaillez dans une entreprise. Avoir établi de bons processus de planification montre votre travail effectif à votre hiérarchie ; ça rassure votre équipe sur le fait que vous saurez toujours sur quoi travailler et ça donne beaucoup de valeur ajoutée à la communauté.
Au fil des années, j’ai attaché de plus en plus d’importance à la planification. Mais je garde suffisamment de temps et de flexibilité pour rester réactif. Quand j’ai débuté comme gestionnaire de la communauté Ubuntu, mon planning était plutôt personnel et je le gérais au coup par coup : je prenais le pouls de la communauté et je consacrais temps et moyens à m’occuper des domaines que je jugeais adéquats.
À présent, je répartis les objectifs dans un ensemble de projets qui couvrent chacun un cycle d’Ubuntu, je rassemble des informations avec les parties prenantes, je compose une feuille de route, je fais le suivi du travail dans des schémas directeurs. J’estime également les progrès effectués en utilisant toute une gamme d’outils et de processus tels que mon diagramme des tâches réalisées, des réunions régulières et d’autres encore. Bien que la méthode actuelle nécessite plus de planification, elle est d’une aide significative en termes de bénéfices sur les points cités ci-dessus.
Perception et conflit
Dans le monde de la gestion et de la gouvernance de communautés, j’entends souvent s’exprimer l’avis selon lequel tout serait affaire de perception. En règle générale, quand j’entends ça, c’est en réponse à quelqu’un qui se trouve du mauvais côté du bâton, le plus souvent au cours d’une période de conflit.
Bien sûr, la perception joue un rôle important dans nos vies, c’est vrai ; mais ce qui peut alimenter des perceptions erronées ou inadéquates, c’est le manque d’information, de mauvaises informations et, dans certains cas, des tensions et des tempéraments échauffés. Cela peut être une des tâches les plus complexes pour celui qui est à la tête de la communauté. Et j’en suis ressorti en tirant quelques leçons dans ce domaine également.
Les communautés sont des groupes de personnes et, dans chaque groupe, on trouve souvent des rôles stéréotypés dans lesquels les gens se glissent. On y trouve, en général, quelqu’un que l’on considère comme une rockstar ou un héros, quelqu’un de compréhensif pour les préoccupations et les soucis et qui prêtera son épaule pour pleurer, quelqu’un qui a son franc-parler et souvent quelqu’un qui est… disons… intentionnellement pénible. Les héros, les oreilles compatissantes et les grandes gueules ne posent pas particulièrement de problèmes, mais les personnes qui créent délibérément des difficultés peuvent être pénibles ; lorsqu’il devient carrément difficile de gérer une personne, cela peut provoquer des tensions avec les autres membres et amener du conflit dans une communauté qui, sinon, est heureuse. Il faut étouffer ce genre de problèmes dans l’œuf.
Une partie du défi, ici, c’est que les gens sont des gens, que les groupes sont des groupes et qu’il n’est pas rare qu’une personne (ou un petit nombre de personnes) se fasse connaître et soit critiquée derrière son dos et passe pour quelqu’un avec qui il est difficile de travailler. En plus de cela, la plupart des gens n’ont pas envie d’être impliqués dans un quelconque conflit et, du coup, la personne dont on se plaint ne peut pas toujours se rendre compte de la façon dont les gens la perçoivent, étant donné que personne ne veut la confronter à ce sujet. Il en résulte une des situations les plus dangereuses pour les membres d’une communauté — une réputation se propage, sans même que la personne concernée ne s’en rende compte. Et du coup, puisqu’elle ne le sait pas, elle n’a jamais l’occasion de changer de comportement. C’est une situation plutôt inconfortable.
Une réponse habituelle à cette conclusion consiste à dire : « ils sont si difficiles à gérer qu’essayer de les raisonner c’est peine perdue, de toute façon ». Même si cela se produit certainement de temps à autres, ne supposez pas trop vite que ce sera l’issue ; j’ai quelquefois eu la désagréable expérience de sentir que je devais faire savoir à certaines personnes, la réputation qu’elles avaient développée. Et, dans la plupart des cas, cela a été une réelle surprise pour elles. Et elles ont quasiment toutes modifié leur comportement après ce retour.
Sur un sujet lié, bien que ça n’est pas si courant dans la routine quotidienne d’un leader de communauté, un conflit va souvent se pointer ici ou là. Je voudrais juste partager deux éléments à ce propos.
La première chose, c’est de comprendre comment les conflits naissent. Pour expliquer cela, permettez-moi de vous raconter une anecdote. La semaine dernière, un de mes amis est venu en avion dans la baie de San Fransisco pour une conférence. Il est arrivé le soir, je suis donc allé le chercher à l’aéroport et nous sommes allés au pub pour discuter des dernières nouvelles. Là-bas, il commença à me raconter à quel point il était déçu d’Obama et de son administration. Il a cité des exemples : la réforme de la sécurité sociale, la réforme de Wall Street, les droits du numérique et d’autres choses. Ce qui l’embêtait n’était pas la politique menée en elle-même, mais il trouvait qu’Obama n’en faisait pas assez. Ma vision des choses était légèrement différente.
Je ne suis ni Démocrate, ni Républicain ; je prends ma décision sur chaque problème, sans m’aligner sur l’une ou l’autre des parties. Là où je diffère de mon ami, cependant, c’est que je suis un peu plus favorable à Obama et son travail quotidien. C’est parce que je crois que lui, et que n’importe qui dans un poste en relation avec le public — qu’il soit internationalement reconnu comme le président ou qu’il soit obscur et spécifique comme un gestionnaire de communauté — a conscience que l’histoire lue et comprise par le public est souvent un simple fragment de l’histoire complète. Il y a eu des cas, par le passé, où quelque chose de controversé a démarré dans les communautés auxquelles j’appartenais. De nombreux commentateurs et spectateurs n’avaient pas l’entière connaissance des faits, soit parce qu’ils n’avaient pas compris les nuances et les détails du sujet, soit parce que certains éléments de l’histoire n’avaient pas été partagés.
Bon, je sais ce que vous allez dire — , quoi, certains éléments n’avaient pas été partagés !? Il vaudrait mieux être transparent, n’est-ce pas ? Bien sûr que c’est nécessaire. Et nous devrions toujours nous attacher à être ouverts et honnêtes. Mais il y a des cas où il serait inapproprié de partager certaines parties de l’histoire. Cela pourrait être en raison de fragments de conversations privées avec des gens qui ne souhaitent pas partager leurs commentaires ou tout simplement faire son boulot bien comme il faut sans éclabousser les réputations. Par exemple, j’ai toujours eu comme pratique de ne pas faire de coups bas à des concurrents, peu importe la situation. Par le passé, il y a eu des comportements critiquables de la part de certains concurrents dans les coulisses. Mais je ne vais pas me mettre à salir leurs réputations car cela n’aurait pas vraiment d’intérêt. Je dois cependant accepter que des critiques de la communauté peuvent ne pas connaître toute la situation avec toutes les magouilles ayant eu lieu dans les coulisses.
Enfin, à propos de conflits, je crois que j’ai appris une vraie leçon de vie au sujet de l’approche idéale à propos des critiques et des issues heureuses. Bien que les billets de blogs aient eu un impact très positif sur la manière dont les gens peuvent exposer leur pensée et partager leurs opinions et visions des choses, ils présentent une facette bien plus sombre. Les blogs sont aussi devenus un moyen d’exprimer parfois un peu trop rapidement des opinions excessivement zélées. Malheureusement, j’ai un exemple plutôt embarrassant de quelqu’un qui est tombé dans ce piège : c’est votre serviteur.
Pour commencer, quelques éléments de contexte. Il existait une entreprise appelée Lindows qui distribuait une version de Linux qui présentait beaucoup de similarités visuelles et fonctionnelles avec Windows. Microsoft voulout interdire l’emploi du nom « Lindows » et une bataille s’engagea pour changer le nom. D’abord, Lindows résista. Mais après que la pression eut monté, l’entreprise se rebaptisa Linspire.
Maintenant, le problème. Je prends la liberté de l’expliquer dans les termes de l’article lui-même :
Il y a peu de temps, un type nommé Andrew Betts a décidé de retirer les éléments non-libres de Linspire et de publier les parties libres dans une distribution dérivée de Linspire qu’il a appelée Freespire. Le fait de rediffuser des distributions ou du code n’a certainement rien de nouveau et s’inscrit parfaitement dans la culture de l’open source. À vrai dire, bien des distributions que nous utilisons aujourd’hui ont été dérivées d’outils existants.
Malheureusement, Linspire a considéré que c’était un problème et a demandé à Freespire de changer de nom. En lisant l’annonce du changement, son langage et son style, j’ai l’impression que tout ça pue le pur marketing. Loin de moi l’idée d’insinuer que Betts a été contraint d’écrire cette page ou que les drones marketing de Linspire l’ont écrite et annexée en son nom, mais cela ne me semble pas sonner très juste. Je me serais attendu à trouver des lignes du style « Le nom de Freespire a été changé pour Squiggle afin d’éviter toute confusion avec le produit Linspire. », mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, on a droit à des morceaux choisis de marketing comme « Afin de prévenir toute confusion, j’ai contacté Linspire qui m’a fait une offre extrêmement généreuse pour nous tous. » La vache ! Quelle peut bien être cette offre-exclusive-qu’on-ne-rencontre-qu’une-fois-dans-sa-vie-et-qu’on-ne-trouve-pas-dans-les-magasins ? Fort heureusement, il poursuit : « Ils souhaitent que tous ceux qui ont suivi mon projet puissent faire l’expérience du vrai Linspire, ET GRATUITEMENT !!! ». Maintenant, dites-nous, je vous prie, comment nous pouvons obtenir cette vraie version du logiciel « ET GRATUITEMENT » ?
« Pour une période limitée de temps, ils mettent à disposition un code de réduction dénommé FREESPIRE qui vous donnera une copie numérique gratuite de Linspire ! Veuillez visiter http://linspire.com/ pour les détails. » Ho… merci.
Dans un billet de mon blog, J’ai décoché à Linspire un bon coup de genou dans les bijoux de famille. J’ai raconté l’histoire, protesté contre ce que je considérais comme de l’hypocrisie considérant leur propre bataille dans des histoires similaires de marques déposées, et j’ai fulminé. J’aurais aimé que Guitar Hero existe à cette époque, cela aurait été un bien meilleur moyen d’utiliser mon temps.
Je me suis trompé. Mon article n’allait jamais servir à quoi que ce soit. Peu de temps après la publication de l’article, le PDG d’alors, Kevin Carmony, m’envoya un courriel. Il n’avait pas l’air satisfait de ma prestation. Son objection, et elle était valable, visait l’absence de concertation mutuelle préalable. Ma première réaction fut de répondre sur mon blog. La réalité de l’histoire était beaucoup moins noire. Et les gens de Linspire n’était pas les ogres que j’avais dépeints. J’ai présenté mes excuses à Kevin et me suis senti idiot.
Beaucoup de conflits sont résolus par des discussions privées où les gens peuvent être ouverts et concentrés sur les solutions sans être dérangés. Au fil des années, j’ai vu beaucoup d’exemples d’une guerre publique houleuse par blogs interposés continuant, alors que, dans les coulisses, il y avait un échange calme et une recherche de solutions.
 Jono Bacon a appris à communiquer avec toutes les communautés
Jono Bacon a appris à communiquer avec toutes les communautés
Pour conclure
Lorsque j’ai commencé à écrire cet article, il était bien plus court. Mais j’ai continué à ajouter des éléments un par un. Il est sûrement déjà assez long pour que je puisse compter le nombre de personnes lisant cette partie sur les doigts d’une main. Je vais donc l’arrêter ici. Je pourrais continuer éternellement avec des anecdotes croustillantes et des expériences dans lesquelles j’ai été suffisamment chanceux pour être impliqué et pour étendre mes horizons. Mais je finirais par écrire L’art de la communauté II : cette fois-ci, c’est personnel.
La vie est une expérimentation permanente. Et j’espère que votre investissement dans la lecture de cet article vous a apporté un peu d’expérience.
1 http://artofcommunityonline.org
2 http://communityleadershipsummit.com
Crédit photos : gidgetkitchen (CC-BY-SA) et Ubuntu-news.ru
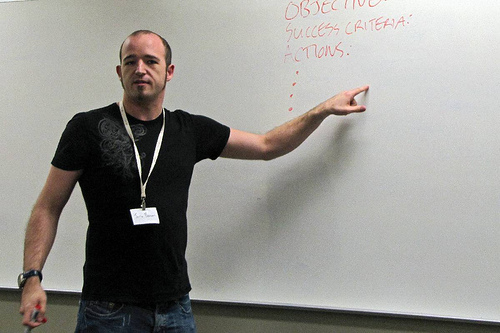 Jono Bacon au tableau blanc
Jono Bacon au tableau blanc Jono Bacon a appris à communiquer avec toutes les communautés
Jono Bacon a appris à communiquer avec toutes les communautés