Pourquoi j’ai choisi de publier sous licence Creative Commons By-Sa
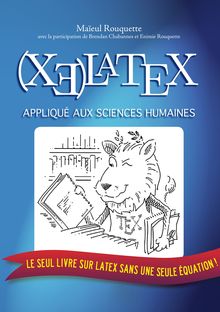 Notre récente traduction Ce que pense Eric Raymond de la clause NC des Creative Commons (pas du bien) a fait réagir, dans les commentaires et sur Identica/Twitter. Il faut dire que cette clause « non commerciale » est un point de friction au sein de la communauté car inexistante dans le monde des licences du logiciel libre.
Notre récente traduction Ce que pense Eric Raymond de la clause NC des Creative Commons (pas du bien) a fait réagir, dans les commentaires et sur Identica/Twitter. Il faut dire que cette clause « non commerciale » est un point de friction au sein de la communauté car inexistante dans le monde des licences du logiciel libre.
Maïeul Rouquette nous a alors proposé de publier l’article ci-dessous.
Ce que nous faisons d’autant plus volontiers que le livre en question est tout à fait intéressant : LaTeX appliqué aux sciences humaines (« le seul livre sur LaTeX sans une seule équation ! » peut-on lire en accroche sur la couverture).
Pourquoi j’ai choisi de publier sous licence Creative Commons By-Sa
Maïeul Rouquette – septembre 2012
J’ai récemment publié un livre sous Licence Creative Commons – Paternité – Partage à l’Identique, en l’occurrence un manuel sur XeLaTeX appliqué aux sciences humaines. Je tiens à expliquer pourquoi j’ai choisi cette licence.
Tout d’abord, commençons par lever un malentendu. Je ne suis pas de ces personnes qui pensent que tous les livres, ou même simplement tous les logiciels, devraient être publiés sous Licence Libre. Car si je perçois bien l’intérêt du livre libre pour la liberté du lecteur, je sais également qu’il existe un principe qui dit que la « Liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres », je pense que la liberté du lecteur s’arrête là où commence celle de l’auteur[1]. Il était donc dans ma liberté de ne pas publier sous Licence Libre, et je le fais d’ailleurs pour certains travaux.
Je suis donc attaché au droit d’auteur, dans la mesure où sans l’initiative et le travail de l’auteur, une œuvre n’existerait pas, et qu’il est donc libre de l’usage qu’il en est fait. Le travail que j’ai produit n’est pas seulement de l’information, des données, qui doivent être librement reproductibles, mais aussi une forme particulière de ces données, un caractère original. C’est à ce titre d’œuvre présentant un caractère original (et mis en forme) que le droit d’auteur s’applique à mon œuvre. C’est ce caractère original qui m’autorise à utiliser le pronom possessif mon — ou plutôt notre puisque j’ai été aidé par deux autres personnes.
On pourra noter que le lien existant entre l’œuvre et l’auteur n’est pas lié seulement à des conditions juridiques, mais aussi à la prise de conscience qu’il ne saurait y avoir d’œuvres « neutres », y compris la plus technique qui soit. Prendre garde de la personne qui est à l’origine directe de l’œuvre[2], c’est également se donner les moyens d’avoir un regard critique plus aigu sur cette œuvre.
C’est donc un choix volontaire, pour un cas particulier, de publier sous Licence Libre, en l’occurrence la CC By-Sa. Et c’est ce qui, je pense, rend mon explication d’autant plus intéressante.
Commençons par les libertés que j’accorde à mon lecteur
Je l’autorise à recopier ce livre, à le diffuser partout et par tous les moyens possibles et imaginables. Pourquoi ne l’autoriserai-je pas ? La seule raison qui pourrait faire que je m’y oppose serait financière : en permettant la libre diffusion, je peux me priver d’une certaine « manne » de revenu.
Cependant, outre qu’il n’est pas garanti qu’en l’absence de cette autorisation de diffusion les lecteurs auraient effectivement acheté le livre, je ne m’attendais pas à pouvoir vivre avec une telle œuvre, du fait de sa portée relativement limitée. De plus, n’étant pas dans une situation financière particulièrement délicate et n’ayant pas besoin de plus d’argent que je n’en ai aujourd’hui, je n’ai pas écrit cette œuvre par intérêt pécuniaire.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des enjeux financiers derrière l’œuvre : j’ai dû payer une certaine somme pour l’édition de l’ouvrage, pour le travail de couverture, pour l’impression des différents brouillons etc. Ainsi chaque exemplaire papier vendu me permet de compenser cette avance. Néanmoins, le gros de « perte » que j’ai à subir sur ce livre n’est pas financier, mais de temps : toutes les heures passées à écrire ce livre, à produire une œuvre dans l’intérêt d’autres personnes, sont autant d’heures que je n’ai pas passées à d’autres aspects de ma vie. Non que je regrette ce temps passé, mais simplement pour signaler que même si je n’étais pas remboursé de mon avance, ce ne serait pas quelque chose de plus dramatique que la perte d’heures. Évidemment, si ma situation financière était plus précaire, je me serais posé les questions autrement — mais dans de tel cas je n’aurais pas pris le temps d’écrire cet ouvrage.
J’autorise ensuite le lecteur à modifier mon ouvrage. J’ai dit quelques mots tout à l’heure du lien existant entre l’œuvre et l’auteur. Si ce lien est réel, il l’est tout autant que celui entre l’œuvre et chacun de ses lecteurs. La même œuvre lue par deux personnes différentes n’est pas tout à fait la même œuvre, à vrai dire la même œuvre lue par une même personne dans des conditions différentes n’est pas tout à fait non plus la même œuvre. Si donc il existe un lien entre l’œuvre et le lecteur, pourquoi ne pas donner les possibilités à mon lecteur de moduler encore plus aisément ce lien par l’intervention directe dans l’œuvre ?
Plus pragmatiquement, mon œuvre n’est sans doute pas exempte de lacunes, d’erreurs : permettre aux lecteurs de les corriger, c’est lui permettre d’atteindre un niveau plus haut d’exigences. Sans oublier qu’étant donné le sujet, il y a fort à parier que certains passages doivent rapidement être mis à jour. Or comme rien ne me garantit que je puisse encore m’y consacrer demain, et que jusqu’à preuve du contraire la communication entre le monde post-mortem et le monde pre-mortem n’est pas encore tout à fait au point, il est important d’assurer, y compris juridiquement, une pérennité de l’œuvre.
Continuons par celles que je n’accorde pas
Le lecteur ne peut diffuser et modifier mon livre qu’à deux conditions
- M’attester, moi et mes coauteurs, comme auteur original.
- Accorder les mêmes droits à ses futurs lecteurs.
Pour le 1), je crois avoir suffisamment expliqué pourquoi je pensais qu’il y avait un lien entre l’auteur et l’œuvre, qui justifie de connaître le nom de l’auteur. À ceci, j’ajouterais deux éléments :
- en tant qu’historien qui travaille sur des sources anonymes je sais que les problèmes d’anonymat et de pseudonymat sont très compliqués à gérer, alors autant faciliter le travail des futurs historiens. Bien sûr, le fait que mon nom soit attaché à l’œuvre n’exclut absolument pas qu’un jour on puisse se demander si l’œuvre est réellement de Maïeul Rouquette, et pas d’un Pseudo-Maïeul Rouquette. À charge pour le futur philologue, si tant est que ce livre intéresse un futur philologue, de trouver qui est l’auteur de l’œuvre, mais autant lui alléger tout de suite la tâche en lui donnant un indice.
- Comme tout humain, j’ai un certain ego. Attacher mon nom à une œuvre est une manière de flatter mon ego. Il faut bien le dire, puisque l’ego est vraisemblablement, avec l’altruisme, l’une des motivations premières des bénévoles, dans tous les domaines.
En ce qui concerne le 2), autrement dit le choix d’une gauche d’auteur, elle est plus discutable du point de vue des libertés. En effet, si quelqu’un publie une version dérivée de mon œuvre sans autoriser les modifications à ses futurs lecteurs, en quoi cela me dérange ?
À titre personnel, cela ne me dérange absolument pas, cela ne lèse pas mes intérêts. Mon ego restera flatté, puisque mon nom devra être mentionné.
En revanche, forcer le partage à l’identique correspond à l’une de mes convictions : la nécessité qu’il existe des biens communs. Or à l’heure des privatisations à tous crins, la grande force de la gauche d’auteur, c’est de permettre de produire collectivement du bien public, y compris venant de personnes qui n’ont pas pour premier intérêt le bien public.
Finissons par une restriction que je n’ai pas mise
Je n’ai pas mis la restriction « Pas d’utilisation commerciale ». Pourquoi ? Ce n’est pas parce que je pense que toute œuvre devrait par nature être libre — car la restriction « Pas d’Utilisation commerciale » empêche une œuvre sous CC d’être vraiment libre, au sens de la FSF.
Simplement, imaginons qu’une personne fasse un usage commercial de mon œuvre sans apporter de valeur ajoutée, c’est-à-dire se contente de reprendre l’œuvre, de la diffuser moyennant finance et d’empocher la somme d’argent. Dans un tel cas, j’aurais un manque à gagner financier, puisqu’au lieu de passer par le site de mon éditeur, la personne aura acheté une autre version papier du livre — j’imagine mal une personne en acheter une version électronique, sachant que je la mets à disposition gratuitement sur Internet. Néanmoins dans un tel cas je serais mis au courant, ne serait-ce que par le régime du dépôt légal, qui me permettra de trouver des versions « non officielles » de la version papier. Il me sera alors assez aisé d’avertir mes lecteurs, par mon blog par exemple, en leur expliquant que s’ils souhaitent me rémunérer, il faut acheter la version officielle.
Maintenant, supposons un usage commercial à partir d’un vrai travail sur l’œuvre, par exemple une réécriture, une amélioration etc. : à quel titre empêcherais-je une personne ayant produit une telle œuvre, et donc étant un nouvel auteur, de gagner de l’argent dessus ?
Conclusion
- Le choix d’une licence libre est un choix pragmatique : permettre à des personnes de connaître mon œuvre et éventuellement de l’améliorer.
- Le choix de la clause « Paternité » est un choix :
- Épistémologique : je ne crois pas que l’on puisse totalement séparer l’œuvre de son auteur.
- Narcissique : j’ai passé des heures sur mon livre, alors j’aimerais que je sois reconnu comme celle qui a fourni ce travail.
- Le choix de la clause « Partage à l’Identique » est un choix politique : lutter, à ma modeste échelle, pour le bien commun, contre la privatisation.
- Le choix de l’absence de clause « Non-commercial » est un choix pragmatique : puisque la mention de la paternité de l’œuvre est assurée par la clause « Paternité », je fais confiance à l’intelligence du lecteur pour rémunérer, si besoin, la personne ayant apporté un « vrai » travail
Maïeul Rouquette
Assistant diplômé en histoire du christianisme ancien et littérature apocryphe chrétienne
Université de Lausanne (FTSR/IRSB)
http://apocryphes.hypotheses.org
http://geekographie.maieul.net/-LaTeX-
Notes
[1] Ce qui n’implique pas que je sois d’accord avec certaines dérives actuelles du droit de la propriété intellectuel, par exemple les DRM, qui a mes yeux trahissent le sens originel. Rappelons qu’en droit classique, un auteur ne peut pas contrôler le devenir de l’exemplaire papier de son livre une fois vendu — ce qu’on appelle l’épuisement du droit d’auteur.
[2] Car il y a des milliers d’auteurs indirects : pour prendre le présent ouvrage, il n’aurait pu exister sans tout le travail de la communauté LaTeX.




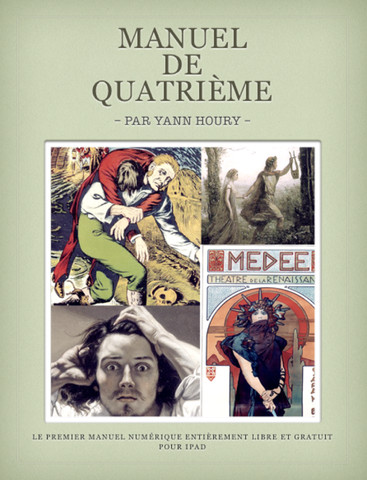
 This Machine Kills Fascists…
This Machine Kills Fascists…

