#SpanishRevolution ? Traduction 1.1 du Manifeste « Democracia Real Ya »
 « Nous ne sommes pas contre le système, c’est le système qui est contre nous ! »
« Nous ne sommes pas contre le système, c’est le système qui est contre nous ! »
« Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir ! »
C’est avec de tels slogans que de nombreux espagnols contestent et occupent l’espace public depuis près d’une semaine, en utilisant massivement le réseau pour se coordonner.
Pas de mots d’ordre, pas de revendications précises, pas de leaders, pas d’idéologie (sauf à considérer que le petit livre de Stéphane Hessel Indignez-vous ! puisse servir de référence commune), c’est un mouvement qui déconcerte et qui n’a pas eu encore beaucoup d’écho chez nous, affaire DSK oblige.
Mais qui sait si il ne fera pas tâche d’huile en France et en Europe car, pour le coup, vérité (notamment économique) en deçà des Pyrénées est la même au delà, modulo le fait que tous les pays n’ont pas encore un taux de chômage de sa jeunesse à… 40% !
Pour en savoir plus il y a l’article Wikipédia à suivre au jour le jour (si possible en langue originale). Il y a aussi cette excellente traduction d’Owni : Comprendre le révolution espagnole[1].
« Quelque chose de grand est en train de se passer ici », nous dit-on dans ce billet. On y apprend également que l’un des éléments déclencheurs du mouvement fut le passage d’une loi présentant de forte similitudes avec notre Hadopi et notre Loppsi (la Ley Sinde). Une loi qui fit l’objet d’un pacte entre les trois grands partis coalisés (PSOE, PP et CiU) et qui, no comment, donna l’impression à une majorité d’internautes qu’elle était un cadeau fait aux groupes de pression au détriment des citoyens.
Certains n’y verront peut-être qu’un apéro Facebook amélioré, d’autres au contraire évoquent déjà la contagion du printemps arabe au sein même de nos démocraties (ou de ce qu’il en reste).
Nous verrons bien… Mais en attendant nous vous proposons ci-dessous la traduction française du manifeste de l’un des fers de lance du mouvement, le collectif « Democracia Real Ya ! », « une vraie démocratie, maintenant ! ».
Remarque : On peut considérer cette traduction comme la version 1.1 de celle que l’on peut trouver actuellement sur Internet et qui était, à nos yeux, nettement perfectible, étant entendu que vous pouvez continuer à proposer des améliorations en vue d’une version 1.2 🙂
Manifeste de « Democracia Real Ya ! »
Nous sommes des personnes simples et ordinaires. Nous sommes comme toi. Des gens qui se lèvent chaque matin pour étudier, pour travailler ou pour chercher du boulot ; des gens qui ont une famille et des amis. Des gens qui travaillent dur tous les jours pour vivre et offrir un meilleur futur à ceux qui les entourent.
Parmi nous, certains se considèrent progressistes, d’autres plutôt conservateurs. Certains sont croyants, d’autres pas. Certains ont des idéologies affirmées, d’autres sont apolitiques. Mais nous sommes tous préoccupés et indignés par la situation politique, économique et sociale actuelle. Par la corruption des politiciens, des patrons, des banquiers… qui nous laissent impuissants et sans voix.
Cette situation nous fait souffrir au quotidien ; mais si nous nous unissons nous pouvons la modifier. C’est le moment de nous mettre en marche pour bâtir ensemble une société meilleure. Pour ce faire, nous soutenons fermement que :
- Les priorités de toute société développée doivent être l’égalité, le progrès, la solidarité, le libre accès à la culture, le développement durable et le bien-être des personnes.
- Il existe des droits fondamentaux que la société a le devoir de garantir : le droit au logement, au travail, à la culture, à la santé, à l’éducation, à l’engagement politique, à l’épanouissement personnel et le droit à l’accès aux biens nécessaires à une vie saine et heureuse.
- Le fonctionnement actuel de notre système politique et gouvernemental ne répond pas à ces priorités et il devient un obstacle pour le progrès de l’humanité.
- La démocratie, par essence, émane et appartient au peuple, mais, dans ce pays, la majorité de la classe politique ne lui prête pas attention. Le rôle des politiciens devrait être de faire entendre nos voix aux institutions, en facilitant la participation politique des citoyens grâce à des voies de démocratie directe pour le bénéfice de l’ensemble de la société. Et non celle de s’enrichir et prospérer à nos dépens, en se pliant aux exigences des pouvoirs économiques et s’accrochant au pouvoir par la dictature partitocratique du PPSOE[2].
- La soif de pouvoir et son accumulation entre les mains de quelques-uns créent inégalités, tensions et injustices, ce qui mène à la violence et que nous refusons. Le modèle économique en vigueur, obsolète et antinaturel, coince le système social dans une spirale qui se consomme par elle-même en enrichissant une minorité et en plongeant les autres dans la pauvreté. Jusqu’à l’effondrement.
- L’accumulation d’argent est la finalité du système, sans prendre en considération le bien-être de la société et de ceux qui la composent ; gaspillant nos ressources, détruisant la planète, générant du chômage et des consommateurs frustrés.
- Nous sommes les rouages d’une machine destinée à enrichir une minorité qui ne sait plus reconnaître nos besoins. Nous sommes des citoyens anonymes, mais sans nous rien ne serait possible car nous faisons tourner le monde.
- Nous ne devons plus placer notre confiance en une économie qui ne tourne jamais à notre avantage. Il nous faut éliminer les abus et les carences que nous endurons tous.
- Nous avons besoin d’une révolution éthique. L’argent ne doit plus être au dessus tout, mais simplement à notre service. Nous sommes des êtres humains, pas des marchandises. Je ne suis pas le produit de ce que j’achète, pourquoi je l’achète et à qui je l’achète.
Pour toutes ces raisons, je suis indigné(e).
Je crois que je peux changer les choses.
Je crois que je peux aider.
Je sais que tous ensemble nous le pouvons.
Il ne tient qu’à toi de nous rejoindre.
Notes
[1] Crédit photo : Fito Senabre (Creative Commons By-Sa)
[2] Contraction des deux partis PP et PSOE, un peu comme si on disait UMPS chez nous.
 Ça y est, les premiers « ordinateurs Google », les
Ça y est, les premiers « ordinateurs Google », les  S’il fallait rechercher une unité, une cohérence, voire une politique, à la ligne éditoriale du Framablog, on pourrait bien les trouver du côté de la notion de
S’il fallait rechercher une unité, une cohérence, voire une politique, à la ligne éditoriale du Framablog, on pourrait bien les trouver du côté de la notion de  On fait souvent, et à juste titre, le procès du droit d’auteur à l’ère de l’avènement du numérique. Une manière de résoudre le problème est alors de l’assouplir, en garantissant certains droits ou certaines libertés aux utilisateurs. Et cela donne par exemple la licence GNU/GPL pour les logiciels libres et les licences Creative Commons pour les œuvres culturelles.
On fait souvent, et à juste titre, le procès du droit d’auteur à l’ère de l’avènement du numérique. Une manière de résoudre le problème est alors de l’assouplir, en garantissant certains droits ou certaines libertés aux utilisateurs. Et cela donne par exemple la licence GNU/GPL pour les logiciels libres et les licences Creative Commons pour les œuvres culturelles. Pour un débutant participer au logiciel libre peut être si intimidant qu’on n’hésite pas à évoquer « un aquarium à requins » pour qualifier la communauté !
Pour un débutant participer au logiciel libre peut être si intimidant qu’on n’hésite pas à évoquer « un aquarium à requins » pour qualifier la communauté !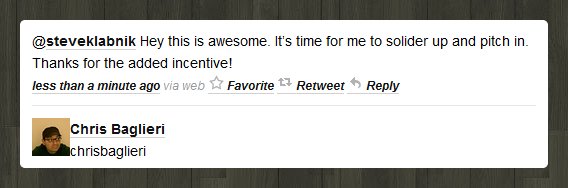
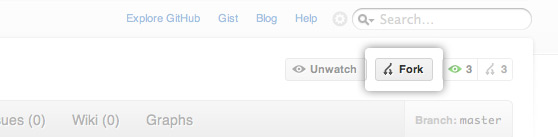
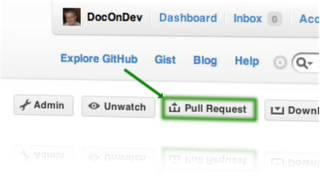
 En février dernier nous mettions en ligne un
En février dernier nous mettions en ligne un  Sortie tout récemment, la dernière version 11.04 de la distribution GNU/Linux
Sortie tout récemment, la dernière version 11.04 de la distribution GNU/Linux