Librologie 6 : À quoi rêvent les moutons électriques
Bonjour tout le monde,
Ceux et celles pour qui ces chroniques Librologiques sont d’une lecture un peu aride (c’est également mon cas, le croiriez-vous), seront peut-être rassurés de savoir que l’épisode d’aujourd’hui termine (provisoirement) l’approche quelque peu théorique entamée avec l’épisode 3, intitulé La Revanche des… Ah non, attendez que je m’y retrouve — j’y suis : User-generated multitude, c’est cela.
Dans l’épisode d’aujourd’hui, donc, je vous propose de revenir sur les pratiques culturelles sous licences Libres, leur utilité et l’adéquation ou non de celles-ci (les licences Libres) pour celles-là (les pratiques culturelles, faut suivre aussi)[1]. Plus que jamais, les commentaires sont là pour recueillir vos réactions, réflexions, témoignages et — ô surprise — vos commentaires.
Bonne lecture !
Valentin Villenave
Librologie 6 : À quoi rêvent les moutons électriques
Peut-on appliquer les licences Libres aux œuvres de l’esprit ?
(C’est-à-dire, étendre les modèles de licences alternatives, autorisant la libre diffusion voire la modification des œuvres, au-delà des seuls logiciels Libres ?)
C’est une question récurrente sur les forums et listes électroniques Libristes.
Une question que l’on n’amène en général pas frontalement, mais que l’on va glisser au détour d’une phrase — on la trouvera d’ordinaire introduite par des marqueurs tels que « je ne suis pas sûr que », « reste à savoir si », « il ne me semble pas évident », etc. — quand on n’entre pas directement dans l’attaque peu subtile « vous voulez obliger les artistes à publier sous licences Libres (et donc, à crever de faim) ? C’est du stalinisme pur ! ».
Une question sur laquelle, naturellement, chacun a peu ou prou son opinion pré-établie. Nul besoin d’argumenter, de réfléchir ou de démontrer.
C’est que cette question n’en est, évidemment, pas vraiment une.
C’est un troll.
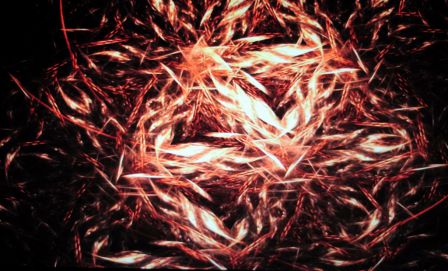
J’ai déjà tenté ailleurs — longuement — de me pencher sur cette question, dans l’espoir de tordre le coup définitivement à ce serpent de mer trolloïde du milieu Libre. Cependant il me semble intéressant de prendre le temps de critiquer le point de vue selon lequel les licences Libres ne devraient convenir qu’aux programmes informatiques, et notamment d’examiner quels idéologèmes le sous-tendent. En effet, Libriste ou non, nul n’est à l’abri de ses propres préjugés, au premier rang desquels cette mythologie déjà évoquée qui consiste à voir en l’œuvre d’art un objet échappant aux contingences ordinaires, et en l’artiste-créateur (pour peu qu’il soit professionnel, bien sûr) un être en marge des exigences sociales.
D’un point de vue légal et pratique, pourtant, bien peu de choses distinguent un programme informatique de tout autre contenu immatériel : un logiciel est une œuvre de l’esprit soumise à la « Propriété Littéraire et Artistique » — encore une distinction arbitraire, au demeurant, qu’il conviendrait de mettre en question. Et un nombre croissant d’artistes s’expriment d’ailleurs au moyen d’outils informatiques qui les amènent parfois à créer de véritables « programmes », au sens strict. (Des pratiques artistiques sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir.)
Pourquoi, dès lors, séparer arbitrairement ces œuvres de l’esprit en, d’un côté, l’art, de l’autre les logiciels ? Certes, il peut arriver que les « œuvres d’art » posent des contraintes inédites aux licences, et nécessitent quelques adaptations juridiques (c’est le propos des licences Creative Commons, dont j’ai parlé ailleurs, et de la licence Art Libre qui, nous le verrons plus bas, est timidement recommandée par le projet GNU). Mais le principe de base reste le même, et il a été établi que les libertés garanties à l’utilisateur de logiciels peuvent se transposer aisément à l’amateur d’art.
Ce qui sous-tend en fait cette dichotomie arbitraire, c’est le « bon sens » ordinaire par lequel tout un chacun délimite sa conception de l’art. Les bouleversements artistiques du XXe siècle semblent avoir quelque peu mis à mal les critères traditionnels d’appréciation du public : peut-on encore dire que « l’art, c’est ce qui plaît » après Picasso ? Que « l’art, c’est ce qui est original » après l’urinoir de Duchamp ou les boîtes de soupe de Warhol ? Peut-on encore définir l’art par la « légitimité » sociale de son auteur, après le Coucher de soleil sur l’Adriatique peint par l’âne Lolo (sic) ?

Reste un critère auquel se raccrocher (voire se cramponner, d’autant plus fermement que tous les autres sont en déroute) : celui de l’utilité. Une œuvre d’art, nous dit le bon sens ordinaire, n’est pas quelque chose dont on se sert pour accomplir telle ou telle tâche. Cette position est également celle de la Loi, qui depuis deux ou trois siècles oppose à l’Art (absolu) les « arts utiles », c’est-à-dire inventions et méthodes de fabrication. Il sera donc communément admis que l’art « noble », digne de respect, se doit d’être inutile : méprisons donc de bon cœur les fanfares ou la musique militaire (fusse-t-elle de Schubert), et les berceuses que l’on chante aux enfants.
Mais cette fois, c’est le reste de la vie qui revient en contrebalance : parmi tous les objets dont nous faisons « usage », combien sont, de facto, indispensables ou simplement, objectivement utiles ? Une large part des logiciels installés sur nos ordinateurs, par exemple, ne sont ni strictement nécessaires ni même utiles (jusqu’à l’absolument inutile). Ainsi, les jeux vidéo sont apparus exactement en même temps que les ordinateurs. Sans même aller jusque là, n’importe quelle interface moderne comporte une majorité d’éléments qui n’ont pour seule raison d’être, que de plaire. Si les logiciels servent à se divertir, et le design à plaire, il n’y a alors plus aucune raison pour considérer l’informatique différemment de, par exemple, la musique : de même que le comte Kayserling commanda à Bach des variations pour clavecin afin de l’aider à dormir la nuit, le citoyen moderne se laissera bercer par les moutons électroniques de son économiseur d’écran.
C’est donc dire, d’une part, que le critère d’« utilité » n’est pas un commutateur binaire, mais plutôt un axe linéaire sur lequel existent une infinité de degrés, et d’autre part que, quand bien même l’on tracerait une barrière nette, l’on serait surpris de voir que ce qui « tombe » d’un côté ou de l’autre n’est pas nécessairement ce à quoi l’on s’attendrait. J’irai même jusqu’à affirmer que le geste du programmeur n’est ni moins technique, ni moins intrinsèquement chargé d’expressivité, ni moins ontologiquement digne d’admiration ou de terreur, que celui de l’« artiste » ; la seule distinction de l’artiste (au sens bourdieusien du terme) est d’ordre social, et nous avons vu combien cette quantification est illusoire.
De même, l’opinion « naturelle » qui consiste à voir en l’Œuvre d’Art un objet achevé, signé et sacré, là où l’objet utilitaire (et tout particulièrement le programme informatique) est un objet transitoire, temporaire, criblé de défauts et dont on s’empressera de se débarrasser pour en obtenir une nouvelle version, plus récente, plus aboutie, en attendant encore la prochaine, cette vision disais-je, est éminemment liée à notre contexte historique : en-dehors de notre société occidentale de ces cinq ou six derniers siècles, les pratiques culturelles et rituelles ne sont pas nécessairement distinctes, et il est bien rare pour un « auteur » d’éprouver le besoin de signer individuellement son œuvre ; en retour, dans notre monde post-industriel (ou pleinement industriel, si l’on suit Bernard Stiegler) où l’artisan n’est plus qu’un souvenir, il est communément admis que tout objet utilitaire est le fruit du travail indistinct d’une légion d’ingénieur anonymes, et l’on se souciera bien peu de savoir si le logiciel que l’on utilise a un ou plusieurs auteurs. Si l’informatique a tout de même produit des noms célèbres, c’est avant tout par ce processus de « mythification » qu’est le star-system : Bill Gates ou Steve Jobs fascinent davantage pour leur success-story que pour leur travail technique, et de son côté le mouvement Libre cherche en ses grands informaticiens des héros (Linus Torvalds) ou, si l’on peut dire, des hérauts (Richard Stallman ou Sir Tim Berners-Lee) — ce que je décrivais précédemment sous le terme de « culte ».
Unicité de l’auteur, singularité sociale de l’artiste, intégrité de l’œuvre : autant de notions historiquement datées — et qui, même d’un point de vue historique, s’avèrent bien illusoires : aussi loin que nous puissions regarder, les artistes ont toujours dû s’adapter aux goûts du public, aux contraintes économiques ou politiques, et partager avec leur contemporains la paternité de leur travail. J’ai déjà eu l’occasion d’aborder l’exemple des compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles, qui, s’ils signaient certainement leurs œuvres, ne se privaient pas d’emprunter ici et là — quand ce n’était pas les interprètes eux-même qui ré-arrangeaient ou faisaient réécrire certains passages ! J’ai également tenté d’expliquer que les musiciens d’antan que nous révérons aujourd’hui comme des génies intemporels, n’avaient probablement pas de préoccupations d’une autre hauteur que les faiseurs-de-culture d’aujourd’hui. Depuis plus d’un siècle, le cinéma nous rappelle de façon éclatante combien l’élaboration d’une œuvre est une production, ici au sens industriel du terme — au point que même Fox News en vient à s’alarmer de la prolifération des franchises et autres remakes : nous attendons le prochain James Bond comme la prochaine version de tel jeux vidéo ou système d’exploitation, en espérant qu’il sera encore plus plaisant et nous en donnera davantage pour notre argent. C’est ignorer que trois siècles plus tôt, le public britannique de Händel attendait probablement de la même façon son prochain oratorio !
Signe ultime de cette industrialisation de la culture, que nous avons déjà présenté : les mêmes industriels qui érigent les « créateurs » en figures sacrées, s’empressent dans un même mouvement de réduire leur production à sa simple quantification marchande sour le terme « contenu », qui peut désigner indifféremment des films, des pistes musicales ou des images, en un mot, tout ce que l’on nous peut vendre, littéralement, au poids.
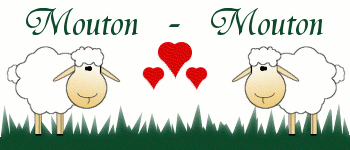
Il y a quelque chose de paradoxal à constater que, même parmi les Libristes les plus endurcis, ceux-là même qui encouragent les informaticiens et chercheurs à publier sous licences Libres le fruit de leur travail, n’ont pas la même attente (voire exigence) de la part des auteurs et artistes. Sur le site gnu.org déjà mentionné, Richard Stallman lui-même indique :
Nous n’adoptons pas le point de vue que les œuvres d’art ou de divertissement doivent être Libres ; cependant si vous souhaitez en libérer une nous recommandons la Licence Art Libre.
Une autre page reprend même à son compte le critère d’utilité que j’évoquais plus haut :
Les œuvres qui expriment l’opinion de quelqu’un — mémoires, chroniques et ainsi de suite — ont une raison d’être fondamentalement différente des œuvres d’utilité pratique telles que les logiciels ou la documentation. Pour cette raison, nous leur demandons des autorisations différentes, qui se limitent à l’autorisation de copier et distribuer l’œuvre telle-quelle.
La licence Creative Commons Attribution-Pas d’œuvres dérivées est utilisée pour les publications de la Free Software Foundation. Nous la recommandons tout particulièrement pour les enregistrements audio et/ou vidéo d’œuvres d’opinion.
Nous avons pourtant vu que Stallman a très tôt compris l’importance potentielle des licences Libres au-delà du code informatique, et se plaît à définir le mouvement Libre comme un mouvement social, politique ou philosophique ; cette soudaine timidité lorsqu’il s’agit de l’art n’en est que plus surprenante — et n’a pas manqué d’être pourfendue par ceux et celles qui aspirent à un mouvement Libre digne de ce nom dans les domaines culturelles.
L’hypothèse que je pourrais formuler, est que rms n’est tout simplement pas intéressé par l’art. La culture « de divertissement » l’intéresse probablement, ainsi que la littérature qu’il nomme « d’opinion » ; cependant, difficile de se défaire de l’impression que ces formes intellectuelles dépourvues « d’utilité pratique » lui semblent, somme toute, subalternes. Si rms a — quoique tardivement — pris conscience des dangers que pose à la démocratie la répression de la libre circulation des œuvres, le point de vue des artistes eux-même lui demeure clairement étranger.
Peut-être est-ce là le plus grand échec du mouvement Libre : de n’avoir pas, de lui-même, dépassé plus tôt les frontières de l’informatique et de cette absurde notion d’utilité. Comme me l’exposait tout récemment Mike Linksvayer lui-même, il est presque honteux qu’aient dû se développer, avec quinze ans de retard, des licences spécialement pensées pour l’art et la culture, au lieu d’une simple évolution de licences logicielles telles que la licence GPL. Ce décalage d’une ou deux décennies vis-à-vis de l’informatique Libre est, encore aujourd’hui, un des (nombreux) handicaps dont souffre le monde culturel Libre.
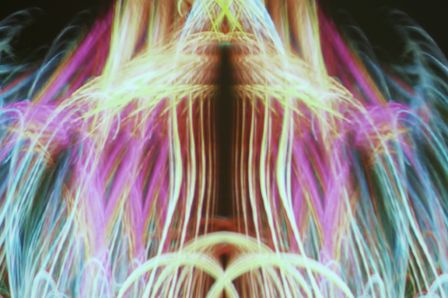
Le milieu des licences Libres est donc encore largement déconnecté des milieux artistiques. Les Libristes eux-mêmes sont en général nettement plus familiers de l’informatique que des pratiques culturelles (particulièrement « classiques », j’y reviens plus bas) ; leurs modes de consommation culturelle sont plus tournés vers la culture de masse — où l’on ignore notoirement toute possibilité de licences alternatives — que vers la création artistique ou la culture classique. Ceux-là même qui veillent à n’installer sur leurs ordinateurs que des logiciels Libres (à quelques éventuels compromis près), sont à même de faire une consommation immodérée de « contenus » propriétaires — la culture geek étant d’ailleurs presque entièrement construite sur un patrimoine non-libre : Le Seigneur des anneaux, Star Trek, La Guerre des étoiles, Le Guide du routard galactique…
Pour certains, il y a là une évidence décomplexée : de toute façon, les œuvres d’art n’ont pas à être sous licences Libres, ce n’est pas fait pour cela. Pour d’autres au contraire, c’est un état de fait presque honteux : l’on ne demanderait pas mieux que de pouvoir n’écouter que de la « musique libre », par exemple, mais les œuvres existantes sont tellement peu connues / difficiles d’accès / introuvables / pauvres… Reproches d’ailleurs partiellement mérités (nous y reviendrons) — et qui auraient aussi bien pu, au demeurant, être adressés aux logiciels Libres eux-même il y a une quinzaine d’années.
Peut-être est-ce, au moins en partie, pour expier cette mauvaise conscience que ce même public Libriste se rue sur quelques œuvres ou sites web culturels publiés sous licences alternatives : les films (au demeurant admirables) de la fondation Blender, les dessins de Nina Paley ou encore le site Jamendo (sujets sur lequels nous reviendrons prochainement)… Cependant que d’autres fonds Librement disponibles, nettement plus fournis, restent largement ignorés : je veux parler du patrimoine écrit, notamment dans le domaine public. Nous évoquions récemment le projet Gutenberg, auquel il faudrait ajouter, dans le domaine des livres, Wikisource ou même Gallica, mais également le domaine des partitions musicales (IMSLP.org, mutopiaproject.org, cpdl.org), ou celui des films en noir et blanc (archive.org)… autant de formes culturelles qui ne font pas recette auprès du public Libriste dans son écrasante majorité (lequel public se montre d’ailleurs souvent peu concerné par la défense du domaine public en général).
Si les Libristes sont principalement tournés vers les cultures « de consommation », la grande majorité des artistes et auteurs, inversement, ne connaît guère d’autre modèle que le droit « d’auteur » traditionnel, avec l’inféodation qu’il comporte à tout un système d’intermédiaires (éditeurs, distributeurs, sociétés de gestion de droits) dont il est presque impossible de sortir, et qui empêche même d’envisager l’existence d’alternatives quelles qu’elles soient. J’ai moi-même eu l’occasion d’évoquer la sensation d’apatride que peut avoir un musicien dans le milieu Libre, et un Libriste dans le milieu musical.
Il n’en faut saluer que davantage la bonne volonté de tous ceux qui, de part et d’autre, s’emploient à lancer des ponts, même de façon parfois maladroite ou mûs par la « mauvaise conscience » que j’évoquais plus haut. La devise du Framablog exprime à merveille ce point de vue :
mais ce serait peut-être l’une des plus grandes opportunités manqués de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d’autre que du code.
On ne peut donc que souhaiter que le public Libriste, d’une part, mette progressivement en question ses propres modes de consommation culturelle, et d’autre part, sache s’abstraire de cette idéologie rampante qui consiste, en célébrant la « sublime inutilité » de l’art, à mettre les artistes hors du monde, dans une case clairement délimitée et quantifiable, et s’assurer qu’ils y restent. La figure sacralisée de l’artiste-créateur (tout comme celle du « professionnel », autant de termes que j’ai déjà démontés) que brandissent les industriels de la culture en toute hypocrisie, ne sert qu’à masquer cette démarche de marginalisation des artistes, de ringardisation organisée de la culture savante, et en dernière analyse, d’une certaine forme de mépris.
Une pensée Libriste digne de ce nom, au contraire, me semble devoir accepter l’idée qu’une œuvre d’art — utile ou non ! — puisse être, tout comme un programme informatique, partagée, retravaillée, voire détournée sous certaines conditions. Le rôle du mouvement Libre est pour moi de remettre l’art en mouvement, et l’auteur à sa place : celle d’un citoyen parmi d’autres, venant à une époque parmi d’autres.
Notes
[1] Crédit illustrations : Paul Scott (CC by-sa), Boronali – Coucher de Soleil sur l’Adriatique (CC by-sa), Mouton – Mouton (Art Libre) et Paul Downey (CC by)
 À l’occasion de la sortie du framabook
À l’occasion de la sortie du framabook 

 Ce n’est pas forcément tous les jours que la
Ce n’est pas forcément tous les jours que la  On l’a évoqué longuement dans un précédent
On l’a évoqué longuement dans un précédent  Nouvelle fournée des
Nouvelle fournée des 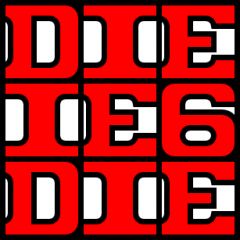 Mon titre est un peu accrocheur et inexact mais il témoigne d’un mouvement d’origine norvégienne de
Mon titre est un peu accrocheur et inexact mais il témoigne d’un mouvement d’origine norvégienne de