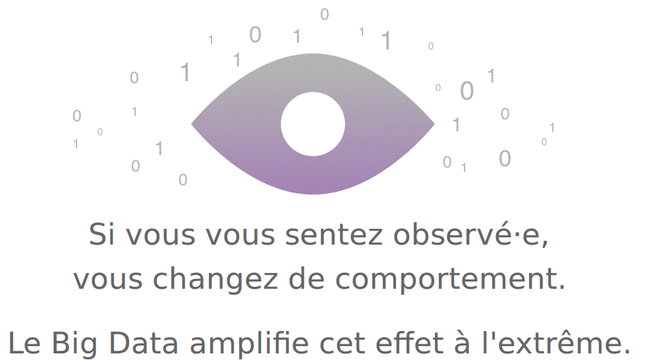IA génératives : la fin des exercices rédactionnels à l’université ?
Stéphane Crozat est membre de Framasoft, auteur de « Traces » et de « Les libres », et surtout, enseignant à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC). Il nous livre ci-dessous une réflexion personnelle – initialement publiée sur son blog – au sujet de … Lire la suite