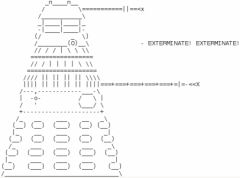Voici un sujet dont on parle trop peu parce que ceux qui en sont victimes pratiquent souvent le déni et n’aiment pas apparaître vulnérables aux yeux de leurs pairs.
Voici un sujet dont on parle trop peu parce que ceux qui en sont victimes pratiquent souvent le déni et n’aiment pas apparaître vulnérables aux yeux de leurs pairs.
Quitte à ce que cela craque complètement un jour et qu’il n’y ait plus d’autre issue que de disparaître momentanément (ou pire définitivement) de la circulation.
Il s’agit du phénomène de burnout que Wikipédia traduit par syndrome d’épuisement professionnel[1].
Il touche également les associations et l’activité bénévole car c’est avant tout d’un trop plein de travail et de responsabilités dont il est question. Et tous ceux qui me connaissent d’un peu près savent que j’en suis parfois passé par là au sein de Framasoft.
Parce que, oui, le Libre n’est pas épargné. Il serait même, à parcourir la traduction ci-dessous, parmi les plus durement touchés, à cause des ses spécificités mais aussi parce qu’Internet, aussi pratique soit-il, peut parfois manquer de patience, d’attention et de bienveillance.
Un article qui cherche à mieux comprendre pour mieux prévenir.
Et n’hésitez pas à laisser votre témoignage dans les commentaires, histoire de libérer aussi la parole et aider ceux qui sont susceptibles de tomber dans ce piège que l’on se fabrique presque toujours tout seul.
Remarque : Nous avons choisi de traduire systématiquement ci dessous « burnout » par « surmenage », même si le mot anglais commence à se diffuser chez les francophones et évoque mieux le processus d’aller au bout de ses forces en épuisant ponctuellement ou durablement toute son énergie.
Linus Torvalds et d’autres à propos du surmenage dans les communautés
Des développeurs open source parlent du stress des codeurs dans le monde de Linux.
Linus Torvalds and Others on Community Burnout
Bruce Byfield – 30 août 2011 – Datamation
(Traduction Framalang : Yonnel, Deadalnix, Mammig2, Martin, Raphaelh, Penguin)
Traînez autant de temps que vous le voudrez dans la communauté du libre et de l’open source, et vous ne manquerez pas de rencontrer des exemples de surmenage. Un collègue prend trop de choses à sa charge, et d’un coup il ne travaille plus, avec de moins bons résultats.
Il a du mal à se concentrer sur son travail. Il néglige sa vie privée. Face aux contestations, il est sur la défensive et devient étrangement agressif. Et pour finir il s’en va, pour souvent ne jamais revenir.
Le surmenage n’est pas l’apanage de la seule communauté linuxienne, bien entendu. Et pourtant ce problème semble toucher la communauté telle une épidémie, et ses membres semblent réticents à en parler en public.
Selon le « community manager » d’Ubuntu Jono Bacon et la journaliste et contributrice d’Ubuntu Amber Graner, qui donnent des conférences adaptées de « The Burnout Cycle » d’Herbert Freudenberger et Gail North, les gens les contactent par la suite en privé pour parler de leur propre expérience de surmenage.
Et de même, la contributrice au noyau Linux et co-fondatrice d’Ada Initiative, Valerie Aurora, se rappelle d’une discussion avec une douzaine de femmes activistes dans les nouvelles technologies, où elles ont découvert que toutes étaient soit en surmenage, soit en train de s’en remettre, soit l’avaient été.
Personne ne semble être à l’abri, pas même Linus Torvalds. Bien qu’il commence par dire « je n’ai jamais vraiment été victime de surmenage », il en vient ensuite à parler d’une situation qui a tout des premiers stades du surmenage :
« Nous avions de très grosses disputes vers 2002 (cf « Linus ne sait pas ce qu’il demande »), je posais des patches à droite et à gauche, et ça ne marchait pas vraiment. C’était pénible pour tout le monde, à commencer par moi.
Personne n’aime la critique, et il y avait beaucoup de descentes en flèche. Et comme ce n’était pas un problème strictement technique, on ne pouvait pas identifier un patch et dire « hé, regardez, ce patch améliore de 15 % la vitesse » ou autre chose du genre : il n’y avait donc pas de solution purement technique. À la fin, la solution était de meilleurs outils et une charge de travail mieux répartie ».
Quelle est la cause du surmenage, en particulier dans la communauté du libre ? Que faire pour l’éviter, à la fois individuellement et au niveau de la communauté ? Ces questions, de plus en plus de leaders du logiciel libre ont du mal à y répondre. Le surmenage commence seulement à être reconnu comme un problème sur lequel se pencher.
Les origines du surmenage
L’organisation dans le libre rend les membres de la communauté particulièrement exposés au stress. Selon Bacon, les contributeurs étant répartis autour de la planète et certains étant volontaires, chacun doit alors gérer lui-même sa charge de travail.
Mais lorsque quelqu’un peut travailler n’importe où sur un projet à n’importe quelle heure, fixer des limites devient alors ardu. Comme pour un jeu de simulation en temps réel, il n’y a pas de moment idéal pour arrêter. En réalité, à cause des réponses instantanées qui sont la norme sur Internet, certains peuvent s’agacer de ne pas voir les autres immédiatement disponibles.
Le stress peut augmenter car la première génération des membres de communautés sont maintenant largement d’âge mûr, et certains commencent à avoir des difficultés à travailler aux heures auxquelles ils étaient habitués, que ce soit dû à la fatigue ou aux obligations familiales.
D’autre part, selon Graner, certains membres de communautés ajoutent une couche à leur stress en prenant davantage de travail pour se prouver quelque chose à eux-mêmes. Elle observe, par exemple, que chez Ubuntu, ceux qui ne font pas de développement peuvent se sentir moins impliqués dans le projet que les développeurs, ou prennent davantage de responsabilités dans l’espoir que leurs sacrifices soient payants et qu’ils puissent accompagner les développeurs à l’Ubuntu Developer Summit.
« Ils pensent que s’ils n’en font pas toujours davantage et ne deviennent pas cette super personne de la communauté, alors les gens penseront qu’ils n’en font pas assez », affirme Graner.
Pourtant, comme le fait remarquer Torvalds, le surmenage n’est pas uniquement lié au stress. « Personnellement les grosses engueulades ponctuelles ont tendance à me plaire et à me gonfler à bloc », affirme-t-il. « Cela peut être stressant, mais ça peut être aussi revigorant, et je pense même que, sans ces éruptions occasionnelles, votre projet a tendance à s’endormir, ou alors c’est que vous n’y croyez plus assez. »
Cependant il ajoute: « mais le stress continuel peut aussi être vraiment usant. Pour moi, ça a toujours été plus ou moins un problème de gestion du flux de travail. Le stress vient du manque d’énergie suffisante (ou du nombre d’heures dans une journée) pour faire ce que je dois faire. C’est donc pour ça, au niveau du noyau Linux, que je pense que les gros moments de stress ont toujours tourné autour de problèmes d’organisation du flux de travail. »
Bacon perçoit le surmenage de manière similaire, en le définissant ainsi : « vous cumulez le stress des jours précédents, et cela augmente jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le surmonter. »
À l’opposé, l’ancien leader de la communauté Fedora Paul Frields voit l’origine du surmenage dans les interactions dans un groupe :
« Les gens n’ont pas tous les mêmes attentes. Celle par exemple d’aspirer à ce que les autres membres de l’équipe aient le même degré d’implication que vous, sans tenir compte des capacités, du temps disponible ou des situations personnelles des autres. Ou peut également souhaiter, consciemment ou non, que tout le monde adore et adopte votre nouveau concept original et radical là, maintenant, tout de suite. Si ces attentes ne se concrétisent pas, et que vous continuez à ruminer longtemps là-dessus, il y a de très fortes chances pour que vous soyez bientôt en surmenage. »
Une autre source possible de surmenage pour les femmes en particulier est leur sous-représentation dans la communauté. Selon le projet, les femmes représentent en général de un à cinq pour cent de la communauté. Non seulement doivent-elles subir les remarques sexistes, les présentations pornographiques, voire une hostilité pure et simple, mais elles ont le sentiment de se retrouver tout de suite en situation de faire leurs preuves – tout autant par rapport aux femmes déjà présentes que par rapport à la majorité masculine.
« C’est un peu comme à l’armée », dit Graner, qui a participé à la première guerre du Golfe. « Vous devez en faire dix pour cent de plus que n’importe qui d’autre pour être perçue comme aussi bonne qu’eux. »
Pour celles qui essaient vraiment de changer cette culture, le stress est encore plus intense. « Il y a tout simplement trop peu de femmes dans l’open source pour assumer tout le travail à faire de ce côté-là », constate Aurora. « Un seul pour cent au sein d’une communauté et c’est déjà mathématiquement le surmenage assuré. Vous êtes en situation précaire, vous recevez plein de messages disant que vous n’êtes pas à votre place, Vos heures et vos heures de temps libre pour ce militantisme n’y changeront rien. Vous vous en voulez de ne pas faire du code, et d’avoir des doutes tout court. »
De plus il n’y souvent qu’une seule figure de proue du féminisme à la fois. « Vous devenez une cible de choix pour les critiques et les menaces », explique Aurora. « Vous en payez sacrément le prix. À chaque fois que quelqu’un devient la représentante de la cause des femmes dans l’open source, sa carrière en pâtit. »
Pour compliquer encore les choses, tous genres confondus, le surmenage est un mal difficile à diagnostiquer ou à admettre. « On distingue fort bien les symptômes chez les autres sans nous apercevoir que bien souvent c’est notre propre reflet que l’on regarde », dit Graner. « Et comme le mot surmenage a souvent une connotation péjorative cela ne pousse pas à la confidence. »
Un tel déni est surtout fréquent chez les leaders en surmenage, soit parce qu’ils se considèrent essentiels, soit parce qu’ils ont plus l’habitude de venir en aide plutôt que d’avoir besoin qu’on les aide eux-mêmes. Mais dans tous les cas ce déni ne fait qu’aggraver la situation en rendant les gens plus réticents à faire ce qu’il faut pour s’en sortir.
Traiter le surmenage
Torvalds suggère que, pour lui, la clef pour se remettre d’un surmenage est :
« d’apprendre à laisser aller les choses. Si l’on ne le fait pas pour l’ensemble du projet, il faut au moins ne plus essayer de le contrôler entièrement. Avec le noyau Linux, je pourrais être le mainteneur principal, mais je fais simplement confiance aux autres pour faire ce qu’il faut. Il y a toujours des parties du projet que je suis de très près, mais même pour celles-ci, je suis vraiment content quand des personnes à qui je fais confiance font le travail à ma place.
Sinon, abandonnez purement et simplement le projet. C’est ce que j’ai fait pour git (le logiciel de gestion de versions décentralisée) : ça me plaisait vraiment, mais il me semblait aussi ne pas pouvoir prétendre être le mainteneur à plein temps dont le projet avait besoin. Et j’ai vraiment été ravi de trouver un très bon mainteneur (Junio Hamano). Cela restait quelque part mon bébé, mais en même temps, le mieux pour git était que quelqu’un d’autre le gère ».
Bien sûr, comme l’ajoute Torvalds, « les gens semblent parfois avoir du mal à lâcher prise, moi y compris. »
Pour répondre à la résistance naturelle au lâcher prise, Frields suggère: « il vous faut la volonté de faire un examen de conscience, de vérifier votre équilibre et votre capacité à vous engager pleinement pour votre accomplissement. Et plus de la volonté, il vous faut réellement et en toute conscience prendre effectivement le temps de le faire. »
Bacon est encore plus précis. En partant de sa propre expérience de surmenage, qui s’est produite environ un an après avoir rejoint Canonical, il a beaucoup réfléchi à la façon d’organiser une vie équilibrée qui pourrait le rendre, lui et d’autres, plus résistants au surmenage.
Ne pas être célibataire est une des meilleures garanties contre le surmenage, selon Bacon, mais il fait remarquer que même les célibataires peuvent passer une soirée loin de la communauté et prendre du bon temps avec des amis. Il suggère également d’avoir d’autres activités (pour Bacon, c’est de faire de la musique avec son groupe Severed Fifth), de faire du sport régulièrement, de suivre un régime plus sain et moins calorique.
Dans ce régime, il préconise de réduire la dose de caféine, à laquelle de nombreux membres de la communauté sont littéralement accros ; Bacon lui-même décrit le sevrage de ses six canettes de Coca par nuit, avec tous les vomissements et les tremblements que cela a entraîné, comme « une des expériences les plus affreuses de ma vie », et fait figurer la restriction de caféine en haute place parmi les changements mis en place pour réduire les probabilités de surmenage.
Le surmenage peut aussi être régulé à l’intérieur de la communauté, en créant une culture commune qui rencontre l’adhésion de tous. Une culture où, selon les termes de Graner, « si vous n’êtes pas à cent pour cent, alors vous ne nous rendez pas service », et où l’on vous encourage à prendre régulièrement des pauses réparatrices et salvatrices.
Graner suggère également que le travail au sein du logiciel libre « doit être un effort collectif pour qu’aucune personne ne soit responsable de l’ensemble ». En se basant sur son expérience personnelle dans l’armée, elle conseille à chacun d’apprendre, ou tout du moins d’avoir de sérieuses notions, sur la fonction et le rôle des autres participants au projet. Une telle rotation a le mérite de réduire la tendance à se sentir indispensable, et propose une diversité qui peut aider à diminuer toute sensation de surmenage. Cela implique qu’en cas de surmenage d’une personne, les autres membres du projet puissent en reprendre les rênes et les responsabilités avec un minimum d’adaptation.
Graner suggère aussi que les rôles d’un projet soient clairement définis, ce qui arrive rarement dans un projet distribué qui compte un grand nombre de bénévoles. De cette façon, les personnes seront moins susceptibles de prendre de nouvelles responsabilités.
À ces suggestions, Aurora ajoute que le surmenage peut aussi être atténué par « des expressions personnalisées de soutien venant de différentes personnes – envoyer un email qui dit je pense que tu fais un très bon travail, et que tu as raison peut souvent faire la différence ». En fait, Aurora explique que « n’importe quelle forme de reconnaissance » peut aider :
« Cela paraît trivial, mais toute forme de surmenage vient en partie du sentiment que ce que vous faites est insignifiant et n’est pas apprécié à sa juste valeur. Je pense qu’Internet est malheureusement un lieu propice à vous donner l’impression que ce que vous faites n’est pas apprécié. Les personnes critiques, voire mesquines, sont apparemment plus enclines à envoyer des reproches que les gentilles à formuler des remerciements, et l’absence de visages humains ou d’intonations de voix rend les incompréhensions courantes ».
Aurora cite sa propre expérience de mise en place, dans le cadre de son travail, d’une politique anti-harcèlement lors des conférences, entreprise dans un moment de quasi-surmenage, et qui a été accueillie avec tellement d’emails d’encouragement qu’elle aurait pu « en pleurer de joie ». Ce soutien aura été une reconnaissance fondamentale à un moment crucial de sa vie.
Notons enfin le rôle important qu’ont les leaders de communautés pour améliorer les situations. Bacon suggère qu’un dirigeant ayant « un engagement quotidien au sein de sa communauté » est le mieux placé pour remarquer des signes de surmenage.
Bacon suggère également d’engager autour du surmenage une discussion franche et sincère, mais qui apporte également concrètement du soutien, quitte à proposer à certains de prendre un congé ou de réduire les responsabilités. Cette discussion devrait se faire en face à face si possible, au pire par téléphone, mais jamais par email ou chat, car le manque de signaux non-verbaux peut conduire à des incompréhensions, en particulier pour quelqu’un qui se sent déjà inadapté à son travail. Pendant cette conversation, le leader de la communauté doit bien faire comprendre qu’il n’est pas en train de réprimander, mais plutôt de donner impressions et suggestions dans l’intérêt de tous. Si nécessaire, on peut adoucir la perception de cette discussion en encourageant la personne à qui l’on parle à effectuer le même type d’intervention si le leader de communauté venait lui aussi à montrer des signes de surmenage.
Préparer le retour
Tout comme le surmenage n’a pas de cause unique, il n’y a pas de remède rapide, unique et miracle pour l’éviter ou le soigner. Cela signifie qu’il est difficile de prédire si les victimes du surmenage pourront surmonter leurs problèmes et revenir ou si elles vont simplement disparaître de la communauté. D’autant que l’on commence tout juste à accepter d’en parler explicitement et à étudier des stratégies de prévention.
En se rappellant son propre surmenage, Graner raconte : « mon surmenage n’est pas arrivé du jour au lendemain, pas plus que le retour. Il y a eu des moments où je me disais que si je ne revenais pas, si je ne reprenais pas toutes mes activités précédentes, j’aurais échoué. Mais personne ne le pensait sauf moi. J’étais la seule qui me faisait des reproches, à me mettre ainsi la pression. J’ai été obligée de me dire : « non, tu n’es pas en situation d’échec, au contraire tu es désormais plus responsable. »
La bonne nouvelle, c’est que ceux qui reviennent d’un surmenage ont souvent une conscience plus aiguë de ce qui s’est mal passé, et éviteront plus facilement un nouveau surmenage. « Une fois que vous avez subi un surmenage total, vous êtes mieux à même de prévenir le prochain et modifier avant votre comportement en conséquence », explique Graner. Une telle prise de conscience représente sûrement l’une des armes les plus efficaces contre le surmenage, car ces personnes reviennent mettre en pratique et témoigner de ce qu’elles ont appris de cette difficile expérience.
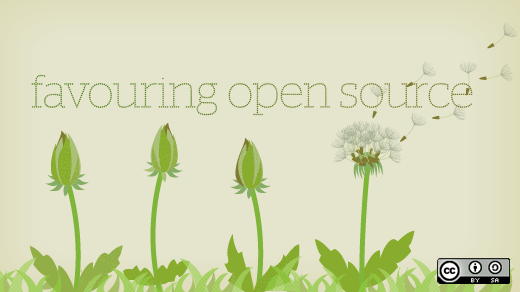
 Voici un sujet dont on parle trop peu parce que ceux qui en sont victimes pratiquent souvent le déni et n’aiment pas apparaître vulnérables aux yeux de leurs pairs.
Voici un sujet dont on parle trop peu parce que ceux qui en sont victimes pratiquent souvent le déni et n’aiment pas apparaître vulnérables aux yeux de leurs pairs.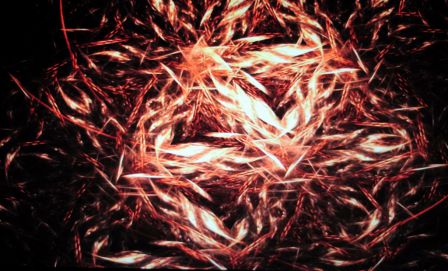

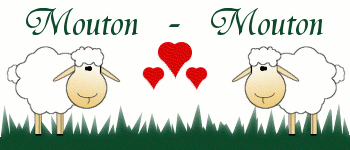
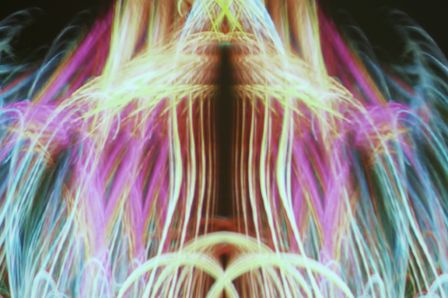
 En… 1994
En… 1994 
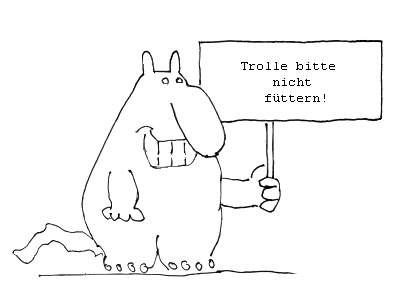
 Les institutions européennes, toujours promptes à donner la leçon, ont peut-être d’autres chats à fouetter actuellement mais il nous semble bon de leur rappeler un passé peu glorieux et un présent scandaleux[
Les institutions européennes, toujours promptes à donner la leçon, ont peut-être d’autres chats à fouetter actuellement mais il nous semble bon de leur rappeler un passé peu glorieux et un présent scandaleux[