 Nous sommes toujours ravis d’accueillir en ces lieux la prose d’Antoine Moreau, précurseur et visionnaire de l’Art Libre, à moins que ce ne soit l’art libre.
Nous sommes toujours ravis d’accueillir en ces lieux la prose d’Antoine Moreau, précurseur et visionnaire de l’Art Libre, à moins que ce ne soit l’art libre.
Justement, le simple fait de mettre ou ne pas mettre de majuscules au concept procède déjà du choix voire du parti pris. Et si le parti est pris, il n’est plus libre (cette dernière phrase étant une tentative maladroite de « faire moi aussi mon Antoine Moreau », mais c’est impossible, il est unique !).
Une conférence donnée à la Biennale de Montréal le 3 mai dernier qui interroge les relations entre l’art et la culture libre[1], en soulignant l’importance du copyleft, cet étrange mais fondatrice « interdiction d’interdire ».
De l’art libre et de la Culture Libre.
URL d’origine du document
Antoine Moreau – 3 mai 2009 – Licence Art Libre
Introduction.
La rupture esthétique a ainsi installé une singulière forme d’efficacité : l’efficacité d’une déconnexion, d’une rupture du rapport entre les productions des savoir-faire artistiques et des fins sociales définies, entre des formes sensibles, les significations qu’on peut y lire et les effets qu’elles peuvent produire. On peut le dire autrement : l’efficacité d’un dissensus[2].
Si l’expérience esthétique touche à la politique, c’est qu’elle se définit aussi comme expérience de dissensus, opposée à l’adaptation mimétique ou éthique des productions artistiques à fins sociales[3].
Avec la venue de l’internet et la généralisation du numérique dans de nombreuses pratiques culturelles nous observons la mise en place d’un nouveau type de culture nommée « Culture Libre »[4] basée sur le partage et la diffusion des productions de l’esprit. « Libre » fait ici référence aux logiciels libres dont le code-source est ouvert. Ils sont définis par quatre libertés fondamentales : liberté d’exécuter le programme, d’en étudier le fonctionnement, de redistribuer des copies et d’améliorer le programme (et de publier ces améliorations).
La question des droits d’auteur est au cœur de cette nouvelle donne culturelle. Un juriste, Lawrence Lessig, en 2001, s’est inspiré des principes de création des logiciels libres pour rédiger des licences dites « libres »[5] pour les œuvres non logicielles. Mais on ne pourrait réduire l’intention d’ouvrir la création à des questions de droit et je vais essayer de vous montrer que c’est le processus de création artistique lui-même qui ouvre et libère la création.
Un an avant l’apparition des licences Creatives Commons, en janvier puis en mars 2000, j’organisais avec un groupe d’artistes[6] les Rencontres Copyleft Attitude. Elles ont donné naissance à la Licence Art Libre, rédigée en juillet 2000[7]. C’est une licence libre de type copyleft, inspirée de la General Public License[8] et recommandée par la Free Software Foundation en ces termes :
We don’t take the position that artistic or entertainment works must be free, but if you want to make one free, we recommend the Free Art License[9].
Voici un extrait du préambule de la Licence Art Libre :
Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les oeuvres dans le respect des droits de l’auteur.
Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression. (…) L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une oeuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des oeuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.
Elle s’appuie sur le droit français, est valable dans tous les pays ayant signé la Convention de Berne[10].
Cette initiative d’artistes, n’était pas tant motivée par des questions liées au droit d’auteur ou à l’informatique, que par le processus de création qu’ils éprouvaient dans leurs pratiques. Il s’agissait d’observer ce que le numérique et l’internet fait à la création pour en prendre acte et agir en conséquence. Agir en phase avec l’écosystème du net et du numérique qui ne fait, en fait, que confirmer nos pratiques artistiques ordinaires. Le logiciel libre ouvre tout simplement la voie pour formaliser nos intentions de créations libres.
Aujourd’hui, cette préoccupation artistique est devenue une occupation sociale, culturelle, politique et économique. En m’appuyant notamment sur les notions de « société close » et « société ouverte » développées par Bergson[11], je vais tenter de clarifier ce qui se joue entre la « culture libre » et l’« art libre ».
Tout d’abord essayons de comprendre ce que fait la Culture Libre à la Culture.
1. Ce que fait la Culture Libre à la Culture.
Si nous entendons par « Culture » ce qui « permet à l’homme non seulement de s’adapter à son milieu, mais aussi d’adapter celui-ci à lui-même, à ses besoins et à ses projets », alors la « Culture Libre » est une adaptation à cette nouvelle donne naturelle qu’est l’immatériel, mais également ce qui « rend possible la transformation de cette nature »[12] portée par le numérique.
Ce nouveau paradigme, nous devons reconnaître qu’il procède d’une nouvelle dogmatique[13]. Il s’agit, pour la Culture Libre, comme pour toute culture, d’instituer ce qui va faire tenir une société et ses sujets à l’intérieur de celle-ci. Cette nécessité institutionnelle est indéniable et la Biennale de Montréal consacrée à la Culture Libre en est le signe. Voyons maintenant ce que l’Art Libre fait à la Culture Libre.
2. Ce que fait l’Art Libre à la Culture Libre.
Distinguons la culture de l’art. Sans les opposer frontalement, il s’agit de ne pas les confondre, prendre acte du hiatus qu’il y a entre ces deux notions. Disons-le d’une formule simple, qui prend la lettre comme image : la culture est une police de caractères, l’art est du vent dans les glyphes[14]. Le sculpteur Carl André le dit autrement : « La culture, c’est ce que d’autres m’ont fait. L’art, c’est ce que je fais à d’autres[15]. »
Ce qui diffère l’art libre de la Culture Libre, c’est ce je-ne-sais-quoi et presque-rien[16] qui procède davantage de la sensibilité que du raisonnement. L’art libre est une trouée dans la Culture Libre. Car si toute culture peut être comparée à un édifice, l’art est alors une fenêtre ou une porte, toutes ouvertures, tout vide qui laisse passer l’air. L’air de rien, l’art est là dans le passage qui permet la respiration. Ce que fait l’art libre à la Culture Libre, c’est d’ouvrir ce qui s’offre à l’ouverture, de mettre en branle ce qui se met en mouvement, d’émanciper ce qui se libère. Car si la Culture Libre procède d’une intention de liberté, l’art libre procède d’une liberté libre, celle qu’exprime le poète aux semelles de vent lorsqu’il constate : « Que voulez-vous, je m’entête affreusement à adorer la liberté libre (…)[17]. »
La « liberté libre » c’est ce qui est imprenable, comme on le dit de la vue imprenable qui offre un paysage protégé des captations propriétaires. C’est ce que fait, précisément, le copyleft en interdisant la prise exclusive des œuvres ouvertes qui s’offrent au bien commun. C’est l’objet de la Licence Art Libre et la licence Creative Commons Attribution-Share Alike[18], licences copyleft pour ce qui concerne les créations hors logiciel.
L’art libre échappe donc très concrètement à l’appropriation exclusive. Comme tous langages, il traverse et nourrit les esprits pour à nouveau se transporter et ainsi de suite, sans cesse et sans fin, de façon à créer au passage, des objets tangibles, traces de langages. Mots, images, sons, gestes, etc. Ainsi, l’art, libre, se renouvelle et demeure vivant. Imprenable définitivement, il ne se prend et ne se comprend que momentanément dans le mouvement même de son apparition et de sa création. Et ce moment là est aussi un moment d’éternité. L’art libre, grâce au copyleft, ne peut pas être captif d’une emprise qui voudrait en arrêter le cours. C’est la raison pour laquelle, par ailleurs, même s’il produit des objets apparemment finis, l’art libre est davantage un mouvement gracieux qu’un objet quand bien même serait-il gratuit. Il ne s’agit pas de nier la production d’objets, mais d’observer l’opération qui se fait entre esprit et matière. Ceci est amplifié avec l’immatériel qui :
(…) trouve sa source dans la séparation du matériel et du logiciel. (…) Tout document informatiquement conservé n’existe que sous forme de bribes disjointes, qu’il peut être dupliqué et multiplié, retouché et transformé. Il ne s’agit pas de matière d’une chose, mais d’un état de la matière, celle des circuits. Il ne s’agit pas des circuits en tant que circuits mais de leur état physique. Il ne s’agit pas de matériel versus immatériel, mais d’état de la matière (…)[19].
En posant le copyleft comme principe conducteur, l’art libre[20] renoue avec ce qu’a toujours été l’art depuis la nuit des temps, avant même que soit reconnue son histoire : une mise en forme de ce que produit l’esprit, insoumise à la culture qui voudrait la comprendre et la dominer. Cet exercice invente des formes qui découvrent l’esprit humain au delà de l’imagination, au delà d’un projet, d’une projection calculée. Sans raison, si ce n’est celle qui excède le raisonnement calculateur. Car il s’agit d’être en présence de ce qui se donne, du don qui élève, sans penser au retour sur investissement. C’est en cela que l’art est une pratique libre par excellence qui émancipe y compris l’idée de liberté quand celle-ci devient un mot d’ordre, un absolu, un fétiche ou une qualité culturelle.
Pour paraphraser Adorno nous dirons alors que : l’art libre c’est ce qui résiste à son assimilation culturellement libre[21].
Mais l’art libre, en trouant la culture libre, en procédant par négativité, n’est pas pour autant iconoclaste et négateur. Il ne détruit pas son cadre d’exercice, il le travaille au corps, il en fait de la dentelle. Plus celle-ci est fine, plus elle est forte. L’art libre porte attention à ce qui fait tenir la fabrique de l’esprit humain : la culture aérée par l’art. Sans ce souci d’aération, c’est l’étouffement, c’est le renfermement. Y compris le renfermement « libre » d’une « Culture Libre ». C’est bien pourquoi l’initiative de Copyleft Attitude, qui a eu pour conséquence la rédaction de la Licence Art Libre, n’a pas été le fruit d’un raisonnement savant mais le passage à l’acte d’une intuition. Car si la Culture Libre est intelligente, on parle même d’intelligence collective, l’art libre, lui, est une pratique qui se passe sans trop de réflexion. C’est ce passage à l’acte qui ouvre et invente la vie et la création qui va avec.
Il est de l’essence du raisonnement de nous enfermer dans le cercle du donné. Mais l’action brise le cercle. Si vous n’aviez jamais vu un homme nager, vous me diriez peut-être que nager est chose impossible, attendu que, pour apprendre à nager, il faudrait commencer par se tenir sur l’eau, et par conséquent savoir nager déjà. Le raisonnement me clouera toujours, en effet, à la terre ferme. Mais si, tout bonnement, je me jette à l’eau sans avoir peur, je me soutiendrai d’abord sur l’eau tant bien que mal et en me débattant contre elle, et peu à peu je m’adapterai à ce nouveau milieu, j’apprendrai à nager (…) Il faut brusquer les choses, et, par un acte de volonté, pousser l’intelligence hors de chez elle[22].
Voyons maintenant de quelle nature est l’art libre en émettant l’hypothèse qu’il est une création qui tend à l’incréé.
3. L’art libre tend à l’incréé.
Décréation : faire passer du créé dans l’incréé.
Destruction : faire passer du créé dans le néant. Ersatz coupable de la décréation.
(…)
La création : le bien mis en morceaux et éparpillé à travers le mal.
Le mal est l’illimité, mais il n’est pas l’infini.
Seul l’infini limite l’illimité[23].
Nous le constatons, l’art libre est un art qui n’a pas forcément les qualités reconnues habituellement à la création artistique. Du fait de son ouverture, il prend aussi le risque d’une destruction. Mais, son mouvement procède d’une décréation qui ouvre sur l’incréé car, s’il œuvre, c’est en passant. Il peut-être passable et fort médiocre comme possiblement génial. Si nous essayons de trouver des repères dans l’histoire de l’art récente nous pourrions dire qu’il relève de l’art brut inventé par Dubuffet et du readymade de Duchamp. Art brut, parce qu’il est fait par « l’homme du commun à l’ouvrage »[24] sans trop de volonté artistique et readymade parce qu’il est déjà fait et qu’il suffit de l’observer avec des yeux d’artiste.
Quel est le plus difficile de tout ? Ce qui te paraît le plus facile : Voir avec tes yeux ce qui se trouve devant tes yeux[25].
Maintenant que nous avons posé l’art libre en rapport avec la Culture Libre, posons-nous la question :
4. Une Culture Libre est-elle possible, est-elle souhaitable ?
Non seulement la Culture Libre est possible mais elle est inévitable, car elle procède d’une logique (im)matérialiste propre à la numérisation de la culture mondiale via les pratiques qui vont avec et notamment via l’internet, mais pas seulement. Par contre, elle n’est souhaitable que si, et seulement si, elle comprend le mouvement imprenable d’une création qui tend à l’incréé. Sinon,
(…) se referme le cercle momentanément ouvert. Une partie du nouveau s’est coulé dans le moule de l’ancien ; l’aspiration individuelle est devenue pression sociale ; l’obligation couvre le tout[26].
Pour maintenir ce qui s’ouvre et ne pas voir refermer le cercle, l’institution du copyleft est nécessaire car il interdit de refermer ce qui a été ouvert. S’agirait-il finalement de modifier le Code de Propriété Intellectuelle de façon à ce que soit inclus, comme droit de l’auteur, la copie, la diffusion et la modification des œuvres sans autoriser la captation exclusive ? Une sorte de domaine public, mais qui reste ouvert et ne peut être refermé. Sans doute, cette piste est-elle à envisager[27].
5. L’art libre : de l’art tout simplement possible.
Et si c’était l’art, activité considérée comme dépassée[28], qui, avec le copyleft comme principe de création, demeurait toujours possible ? Possible car impossible à clore de façon définitive. Un possible toujours à faire, une impossible affaire dont on n’a pas fini de faire le tour. Car la « réelle présence »[29] de l’art (libre) ne se confond pas avec le présent de la Culture (Libre), même s’il peut y prendre part. L’art libre serait alors le fil conducteur ténu mais persistant de ce qu’une Culture Libre promet, mais sans pouvoir le faire tenir durablement : une société ouverte à tous et à chacun et qui ne se referme pas mais poursuit tout simplement son mouvement gracieux d’ouverture.
Ainsi, pour celui qui contemple l’univers avec des yeux d’artiste, c’est la grâce qui se lit à travers la beauté et c’est la bonté qui transparaît sous la grâce. Toute chose manifeste, dans le mouvement que sa forme enregistre, la générosité infinie d’un principe qui se donne[30].
« De l’art libre et de la Culture Libre », Antoine Moreau
Texte de la conférence donnée le 03 mai 2009 lors de la Biennale de Montréal
Copyleft : ce texte est libre, vous pouvez le copier, le diffuser et le modifier selon les termes de la Licence Art Libre
 « Si tu avais un bouton pour envoyer un euro très facilement à l’artiste, tu le ferais », disait récemment Richard Stallman, sur 01net, en pleine tourmente Hadopi.
« Si tu avais un bouton pour envoyer un euro très facilement à l’artiste, tu le ferais », disait récemment Richard Stallman, sur 01net, en pleine tourmente Hadopi. « Nous sommes actuellement dans une période où la situation qui a rendu le copyright inoffensif et acceptable est en train de se changer en situation où le copyright deviendra destructif et intolérable. Alors, ceux que l’on traite de « pirates » sont en fait des gens qui essayent de faire quelque chose d’utile, quelque chose dont ils n’avaient pas le droit. Les lois sur le copyright sont entièrement destinées à favoriser les gens à prendre un contrôle total sur l’utilisation d’une information pour leur propre bénéfice. Elles ne sont pas faites, au contraire, pour aider les gens désirant s’assurer que l’information est accessible au public ni empêcher que d’autres l’en dépossèdent. »
« Nous sommes actuellement dans une période où la situation qui a rendu le copyright inoffensif et acceptable est en train de se changer en situation où le copyright deviendra destructif et intolérable. Alors, ceux que l’on traite de « pirates » sont en fait des gens qui essayent de faire quelque chose d’utile, quelque chose dont ils n’avaient pas le droit. Les lois sur le copyright sont entièrement destinées à favoriser les gens à prendre un contrôle total sur l’utilisation d’une information pour leur propre bénéfice. Elles ne sont pas faites, au contraire, pour aider les gens désirant s’assurer que l’information est accessible au public ni empêcher que d’autres l’en dépossèdent. » Une petite surprise vous attend aujourd’hui à l’
Une petite surprise vous attend aujourd’hui à l’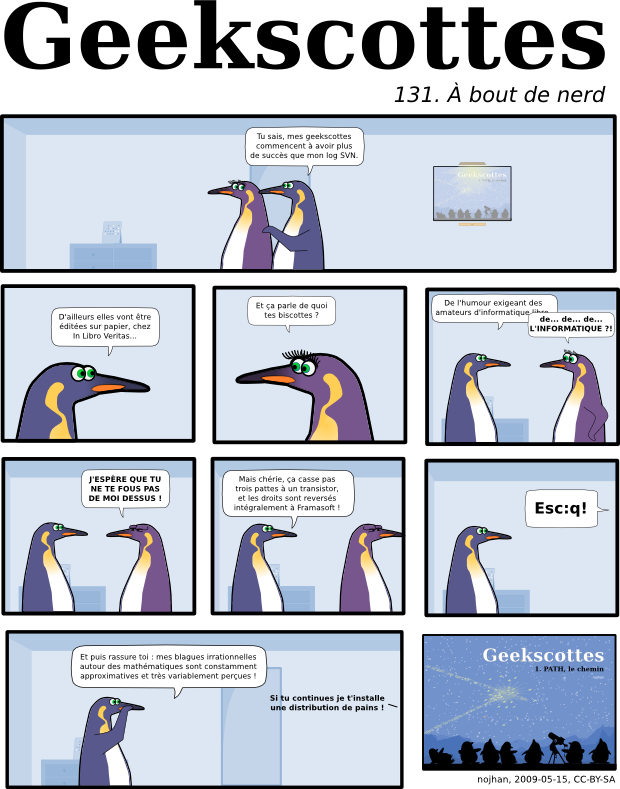
 Nous sommes toujours ravis d’accueillir en ces lieux la prose d’
Nous sommes toujours ravis d’accueillir en ces lieux la prose d’ Nous y sommes, le projet de loi
Nous y sommes, le projet de loi  Il y a de cela 2 mois, j’évoquais
Il y a de cela 2 mois, j’évoquais  Framasoft en général et le Framablog en particulier vous ont souvent raconté des histoires de
Framasoft en général et le Framablog en particulier vous ont souvent raconté des histoires de