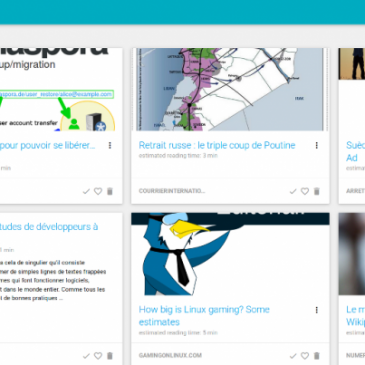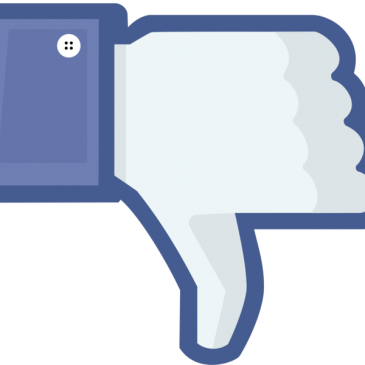28 ans d’existence du World Wide Web : vous reprendrez bien un peu d’exploitation ?
À l’occasion du 28e anniversaire du World Wide Web, son inventeur Tim Berners-Lee a publié une lettre ouverte dans laquelle il expose ses inquiétudes concernant l’évolution du Web, notamment la perte de contrôle sur les données personnelles, la désinformation en … Lire la suite