Temps de lecture 30 min
Bonjour à vous, courageux public du Framablog !
Avec l’épisode d’aujourd’hui et le prochain, qui concluera cette première partie de saison Librologique, je vous propose d’ébaucher le portrait de deux personnalités importantes du monde Libre, parfois complémentaires, parfois opposées.
Contrairement à Linus Torvalds ou Richard Stallman avec qui nous avions ouvert ces chroniques, il ne s’agit pas là de programmeurs ni de techniciens, mais d’auteurs : de ces auteurs qui réfléchissent sur leur propre droit — puisque le droit d’auteur, c’est bien conçu pour… les auteurs, non ? (Comment ça, « rien compris » ?)
V. Villenave.
Librologie 8 : Les petits cœurs de tatie Nina
« En 1988, à l’âge tendre de 20 ans, je quittai ma ville natale de Urbana, Illinois, pour Santa Cruz en Californie, afin d’y poursuivre le rêve naïf de devenir hippie, new-age et ésotérique. Au lieu de quoi je suis devenue illustratrice et cynique. »
C’est ainsi que Nina Paley raconte son histoire, de la banlieue de Chicago (Urbana, dont son père a été un maire courageux) à la Californie — le choix de Santa Cruz n’est pas innocent : indissociable des bouleversements sociaux des années 1960-1970, cette ville correspond bien à l’arrière-plan idéologique de la « Nouvelle Gauche » de cette époque, effectivement liée au mouvement hippie, mais également à l’avènement d’une conception nouvelle des sciences humaines (sociologie, psychiatrie alternative,…). Avec toutefois une tournure moins optimiste dans le cas de Paley : par exemple, elle revendique son choix de ne pas faire d’enfants comme un choix militant ; membre revendiquée du Mouvement pour l’Extinction Volontaire de l’Espèce Humaine, sa principale préoccupation politique (tout au moins dans la période 1995-2005) semble être la surpopulation humaine.

- Extinction Volontaire des Humains
- Une facette peu connue de Nina Paley…
Dès ses premières publications, N. Paley se définit clairement comme cartooniste : ses récits se présentent sous forme de comic strips (en une ou deux lignes, avec une chute humoristique) ; ses décors sont limités au strict nécessaire, et ses personnages (souvent animaliers) sont dessinés de façon schématique et expressive — signe symbolique du cartoon, les mains n’ont que quatre doigts. Le mot cartoon, qui désignait à l’origine de simples dessins, a glissé peu à peu vers le domaine de l’animation ; nous verrons que c’est à peu de choses près l’évolution que suivra Paley elle-même.
À cette filiation s’ajoute, dès l’origine, une nette dimension autobiographique : sa série Nina’s Adventures (les aventures de Nina) commence dès 1988 et se poursuivra (avec talent) pendant plus de dix ans. Ce format d’auto-fiction en bande dessinée, encrée et éditée directement par l’auteur, renvoie évidemment à un courant de bande dessinée alternative (voire underground) américain qui s’est développé dans les décennies précédentes, allant des intellectuels New-Yorkais (notamment d’origine ashkénaze comme Eisner, Spiegelman, ou Paley elle-même) aux anarcho-libertariens de San Francisco (Crumb). (Le lecteur francophone ne manquera pas de remarquer que c’est précisément en 1987, à l’époque où débute la carrière de Paley, que se tient le en France le fameux colloque de Cerisy qui préfigurera le renouveau de la bande dessinée francophone dite « d’art et d’essai », avec des groupes comme OuBaPo ou L’Association.)
Voici comment Paley présentera plus tard, en 2000, sa démarche qu’elle qualifie — non sans humour — d’anarcho-syndicaliste :
— À quoi sert l’Anarcho-Syndicat ?
— L’Anarcho-Syndicat [NdT : jeu de mot intraduisible avec le mot syndicate, circuit de distribution de médias de masse aux États-Unis] a pour vocation exclusive de distribuer et promouvoir la merveilleuse bande dessinée Nina’s Adventures de Nina Paley.— Que signifie l’intitulé Anarcho-Syndicat ?
— Étant ma propre employée, cela revient à dire que je m’exploite moi-même pour en tirer profit. Cependant je me suis organisée et ai réuni mes forces avec moi-même pour former un anarcho-syndicat. J’ai ainsi pu renverser mon régime d’oppression Capitaliste, et suis devenue un Collectif Unipersonnel Prolétarien en autogestion.[…]— Êtes-vous vraiment disposée à consacrer 10 % de vos bénéfices pour démanteler le Capitalisme ?
— C’est très sérieux. Malheureusement nous n’avons encore réalisé aucun bénéfice à ce jour. Mais nous sommes déterminées à démanteler le Système, du moment que nous participons totalement au système en question afin de générer les fonds qui nous permettront de le renverser.— Euh, pardon ?
— Et vous pouvez nous y aider en vous abonnant à la merveilleuse bande dessinée Nina’s Adventures de Nina Paley. C’est sympa, c’est mode, c’est sophistiqué et c’est amusant ! Les lecteurs l’adorent, et vous l’adorerez aussi.— Mais que deviennent les 90 % restants de vos bénéfices ?
— Ça suffit, achetez la BD.
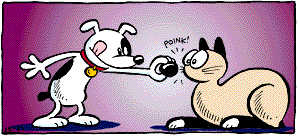
- Fluff
- © Nina Paley, 1997. (Licence indéterminée.)
À cette série s’en ajouteront d’autres, qu’elle décrit elle-même comme mainstream — et qui seront d’ailleurs distribuées par des syndicates traditionnels de la bande dessinée américaine commerciale : notamment la série animalière Fluff et The Hots, série là encore partiellement autobiographique. À partir de 2009, Paley reviendra sur toutes ces séries achevées, en récupèrera les droits ou les numérisera pour les entreposer sur l’Internet Archive, puis les republier sous licence Libre, et enfin constituer un recueil complet, organisé et correctement édité. Il convient en effet de mentionner que N. Paley, jusqu’au milieu des années 2000, ne publie que sous droit d’auteur « traditionnel » — elle se plaint même, à l’occasion, que son « copyright » soit enfreint lorsque des gens reproduisent ses dessins ici ou là. Si elle distribue elle-même une partie de ses travaux (notamment en ligne, dès l’apparition du Web), c’est toujours sous des termes contraignants et dans une démarche directement commerciale — comme peut d’ailleurs l’illustrer son choix répété de noms de domaines en .com, ou son goût pour le merchandising de produits dérivés.
Ce qui ne signifie pas pour autant que son travail n’évolue pas : à la fin des années 1990, elle se lance dans une carrière de cinéaste avec plusieurs courts-métrages expérimentaux fort intéressants, animés en volume avec de la terre glaise ou travaillés directement sur la pellicule. Au début des années 2000, elle se tourne vers l’ordinateur comme outil d’expression artistique, et en particulier vers le logiciel Macromedia Shockwave-Flash qu’elle dit « adorer ». C’est avec cet outil qu’elle produira désormais la totalité de son œuvre, sous forme de dessins animés vectoriels parfois mélangés à des collages, comme dans le court-métrage anti-nataliste The Stork, où une cigogne livrant des bébés s’avère être un bombardier transformant l’environnement en urbanisme monstrueux…
L’épiphanie Libriste viendra entre 2005 et 2008 avec le long-métrage Sita Sings The Blues (Sita chante le blues en français) qui constituera un virage à la fois artistique et idéologique. La genèse de ce film mérite d’être évoquée, puisque Paley elle-même la présente comme indissociable de l’œuvre elle-même. En 2002, Nina Paley rejoint son mari en Inde, où elle passe trois mois et découvre notamment l’épopée mythologique du Ramayana. De passage à New York, elle reçoit un courriel lapidaire de son époux qui met fin à leur mariage. La détresse émotionnelle, s’ajoutant aux influences mythologiques indiennes et à la découverte des romances enregistrées dans les années 1920 par la chanteuse de jazz Annette Hanshaw, lui fournit le matériau artistique pour… un premier court-métrage, Trial by Fire, qui sera développé en 2005 (à la suite d’une nouvelle rupture amoureuse) en un long-métrage. Élaboration qui ne se fera pas sans mal : outre la nécessité de trouver des financements, la bande sonore du film soulève de nombreuses questions juridiques : si les chansons de Hanshaw se trouvent dans le domaine public au regard du droit fédéral américain, l’État de New York ne les considère pas comme telles. Pour autant, Paley ne renonce pas et pose l’incorporation de ces chansons comme une exigence artistique incontournable — ou plus exactement, nous le verrons, sacrée.

- Annette Hanshaw
- Auteur inconnu. (Fair Use sur Wikimedia Commons)
Il faudra pas moins de trois ans de travail, un bataillon d’avocats bénévoles et deux instituts (l’Electronic Frontier Foundation et la Clinique du droit de Propriété Intellectuelle Glushko-Samuelson) pour venir à bout de ce problème… en n’y apportant qu’une demie-solution, puisqu’il s’agira en définitive d’une dépénalisation partielle, qui coûtera à Paley 70 000 dollars (au lieu des 220 000 demandés à l’origine). Aujourd’hui encore, ces enregistrements prêtent le flanc aux menaces juridiques (pour la plupart fantaisistes), comme nous l’avons récemment vu lorsque YouTube® a supprimé la bande sonore du film sous pression de la « SACEM » allemande.
C’est en négociant les droits pour cette bande-son que Paley se retrouve, pour ainsi dire, contrainte à publier son film sous une licence Libre : les ayant-droits exigeant un pourcentage sur toute vente du film, le film ne sera pas vendu mais disponible gratuitement. Vengeance symbolique certes, mais Paley ne s’arrête pas là et ajoute avoir pris pleinement conscience des effets néfastes du « copyright » sur la création artistique. Au fil de ses rencontres et côtoiements avec les milieux promouvant les licences alternatives, Paley en est devenue non seulement une membre reconnue mais la porte-parole distinguée (voire, nous y reviendrons, l’égérie) : en 2007 elle sera engagée comme « artiste en résidence » de l’association Question Copyright (remettre en question le droit d’auteur), créée pour l’occasion par le programmeur Karl Fogel — dont on lira avec intérêt les écrits, notamment sur le logiciel Libre et sur l’histoire du droit d’auteur. À dater de ce moment, la majeure partie (sinon la totalité) de son travail d’auteur sera non seulement teintée, mais fondamentalement motivée, par un militantisme Libriste remarquablement complet : promotion des licences alternatives, protection du domaine public lutte contre la criminalisation du partage de la culture, combat pour les libertés civiques, dénonciation de la propagande des industriels de la culture… Le motif le plus récurrent étant sans doute son aversion envers le système juridique, où le droit prétendument « d’auteur » et les brevets — et même les marques commerciales — auto-alimentent un terrorisme administratif constant dépourvu de fondement, sur lequel repose cette engeance nuisible que sont les avocats : toutes proportions gardées, Paley tourne en ridicule les avocats avec le même acharnement et la même obsession personnelle que Molière brocardait les médecins de son temps.

- Copying Is Not Theft
- © Nina Paley, 2009. Licence cc by-sa.
La « chanson du copyright » (The Copyright Song), en 2009, exprimera très clairement cette reconversion. Financé notamment par une bourse de 30 000 dollars de la Fondation Andy Warhol pour les Arts Visuels, ce clip musical d’une minute a pour but explicite de susciter une vague d’enthousiasme et de versions dérivées comme, par exemple, la Free Software Song de Richard Stallman. Les paroles, en quatre couplets, ne développent qu’une seule idée simple (et bien connue des Libristes et Pirates), à savoir que les biens immatériels ne sont pas privatifs et que dans un contexte de copie immatérielle, il est simplement ridicule de parler de « vol ». L’animation illustre les paroles, de façon dépouillée et intelligible (quoique redondante) ; quant à la ligne mélodique, sa simplicité (accord parfait arpégé, tessiture restreinte, mouvements conjoints) touche à la maladresse (suremploi des fonctions tonales, syncope d’harmonie à la mesure 6) — pour ne rien dire de l’arrangement jazzy « officiel » réalisé pour Paley par son compère de longue date Nik Phelps.
Ce style engagé, simple et efficace devient ainsi la signature de Nina Paley au sein du mouvement Libre. À sa Copyright Song s’ajoutent d’autres clips vidéo, notamment celui très réussi en hommage à l’Electronic Frontier Foundation, ainsi qu’une nouvelle série en bande dessinée dérivée : le comic strip Mimi and Eunice, non seulement prépublié sur le blog Techdirt mais dont la lecture est même officiellement recommandée par Richard Stallman !
Le charme indéniable de cette simplicité de moyens n’échappe pas, au demeurant, à l’ambiguïté de toute séduction : en préférant l’attractivité et l’efficacité à des raisonnements plus longs et développés, ne serait-il pas tout aussi facile de mettre en œuvre les mêmes moyens pour énoncer et défendre de fausses vérités ou des sophismes ? L’exemple ci-dessous juxtapose, à la version originale de la Copyright Song, un pastiche en anglais qui lui fait dire exactement l’inverse de son propos :
Copying is not theft. |
|
Copyright is not wrong ; |
Autre critique nettement plus sérieuse, il y a de quoi s’étonner du fait que Paley chante (littéralement) les louanges du mouvement Libre… en utilisant un logiciel éminemment propriétaire. Certes, elle a rendu disponibles les fichiers source de sa chanson, fichiers hélas de bien peu d’utilité pour un public Libriste auquel Paley se révèle, de ce fait, étrangère — tout au moins d’un point de vue technique. (Ou comme le trahit également son usage immodéré de réseaux sociaux propriétaires.)
D’un point de vue juridique, en retour, Paley est l’une des voix critiques envers les licences non-libres utilisées par le projet GNU et la Free Software Foundation ; elle s’est également élevée à plusieurs reprises contre les licences de type Non-Commercial, qui ne peuvent entièrement être considérées comme Libres (question complexe). En menant parallèlement (avec Karl Fogel) une réflexion de fond quant aux moyens de bénéficier financièrement de son travail, elle a également proposé un certain nombre de licences ou labels pouvant intéresser les auteurs Libres, notamment le label creator-endorsed (« approuvé par l’auteur »), la licence Creative Commons PRO et l’initiative copyheart.

- Au-dessus de tous
- « Je me croyais au-dessus de tous… et je me retrouve au même niveau. C’est pas si mal, en fait. »
♡ Nina Paley, 2011.
Pour justifiées qu’elles puissent être, ces initiatives ne semblent pas toujours pleinement cohérentes. À commencer par certains choix terminologiques qui ne seront pas sans éveiller quelques réticences dans notre perspective Librologique : « créateur », « pro »… Ce qui est fort dommage, puisque la suggestion d’un label « approuvé par l’auteur » me paraît tout à fait judicieuse, afin de distinguer, dans un contexte de licences Libres pouvant donner lieu à une profusion d’œuvres dérivées de qualité et d’intérêt variables, les œuvres qui bénéficient d’un soutien particulier de l’auteur d’origine, soit qu’elles présentent à ses yeux un intérêt artistique, soit qu’elles lui semblent (par exemple dans le cas d’une traduction) refléter fidèlement sa pensée.
Quant au terme de « pro », notons qu’il est ici utilisé dans une logique exactement inverse à celle de Jamendo™ que nous avons amplement critiquée : un auteur « pro », pour Paley, c’est un auteur qui a besoin du Copyleft le plus poussé (celui de la licence GPL, Art Libre ou en l’occurrence CC by-sa), et non d’être poussé à renoncer à sa licence :
CC-PRO est une licence Creative Commons qui répond aux besoins spécifiques des auteurs, artistes et musiciens professionnels. CC-PRO s’appuie sur la licence la plus puissante afin de garantir que les œuvres de haute qualité seront promues et reconnues. En offrant la meilleure des protections contre à la fois le plagiat et la censure, cette licence capte l’attention, invite à la collaboration et sollicite la reconnaissance de votre public le plus important : les autres professionnels.
CC-PRO. Parce que le travail d’un professionnel mérite d’être reconnu.
Des licences Libres en tant qu’instrument de puissance — ou : comment ruiner un point de vue légitime par des choix terminologiques désastreux. La communauté Libre au sens large, et en particulier la fondation Creative Commons, ne sembla pas transportée d’enthousiasme par cette suggestion, au grand dam de Paley. Découragée vis-à-vis des licences en général (sinon des subtilités juridiques quelles qu’elles soient), plutôt que d’adopter une licence plus intègre telle que Art Libre, elle lance fin 2010 une nouvelle initiative :
Copier une œuvre est un acte d’amour. L’amour n’est pas assujetti à la loi.
♡ 2010 par Nina Paley. Veuillez me copier.
Paley baptise cette initiative le copyheart, que je pourrais traduire (mais seulement si j’y étais obligé sous la menace des baïonnettes) par « droit d’au-cœur » :
Le symbole ♡ ne peut pas être déposé (je l’espère) et donc pas contrôlé. Ça me va tout à fait. Il se peut, et il arrive, que d’autres gens utilisent le symbole ♡ pour signifier toutes sortes de choses. Mais ce symbole possède une signification culturelle partagée, qui transcende tout usage qu’une personne pourrait en faire. Son véritable pouvoir réside dans le fait que ce n’est pas une licence, ni une marque commerciale. Ce symbole n’est pas soumis à la loi.
C’est sur le site copyheart.org qu’elle développera son raisonnement (à la première personne du pluriel, sous une forme de questions-réponses qui n’est pas sans évoquer sa page « anarcho-syndicaliste » que nous citions plus haut) :
Nous apprécions et utilisons des licences Libres lorsqu’elles viennent à propos ; cependant, elles ne règlent pas le problème des restrictions au droit d’auteur. Plutôt que de tenter d’éduquer le monde entier aux complexités du droit de propriété littéraire et artistique, nous préférons annoncer clairement nos intentions en une phrase simple :
♡ Copier est un acte d’amour. Veuillez me copier. — Le symbole « copyheart » ♡ est-il déposé ?
— Non. C’est juste une pétition de principe. Son efficacité ne dépend que de l’usage qu’en font les gens, et non des pouvoirs publics. Voici d’autres symboles qui ne sont pas déposés, mais dont la signification et l’intentionnalité sont largement comprises (même de façon imparfaite) :
✝ ☪ ✡ ☺ ☮ ♻ [NdT : Ce n’est pas tout à fait exact.]
— Le symbole « copyheart » ♡ traduit-il un engagement légal ?
— Probablement pas, mais vous pourriez tenter l’expérience :
- Adjoignez à votre œuvre le message « copyheart » ?.
- Attaquez quelqu’un en justice pour copie illégale.
- Attendez de voir ce que vous répondra le juge.
Pour nous, les lois et la « propriété de l’imaginaire » n’ont pas la moindre place dans les relations amoureuses ou culturelles des gens. Créer de nouvelles licences, de nouveaux contrats et engagements devant la loi ne fait que perpétuer le problème, en amenant la loi — c’est-à-dire la force étatique — dans des domaines où elle n’a rien à faire. Le fait que le symbole ♡ ne constitue pas un engagement légal, n’est pas un bug : c’est un plus !
À tous les efforts de formalisation, juridique et intellectuelle, poursuivis par le mouvement Libre depuis trois décennies, Paley substitue une simple parole « amoureuse » (sinon élégiaque, comme nous le verrons). Cette démarche n’est pas révolutionnaire (elle rappelle notamment le datalove, le kopimi ou encore le « No Copyright » du Piratpartiet), et Paley ne cherche d’ailleurs pas à la présenter comme telle ; elle est, au sens propre, réactionnaire : réaction face au droit « d’auteur » classique, nous l’avons vu, mais également réaction face aux licences Libres elles-même. Pour spontané et rafraîchissant qu’il puisse paraître, ce mouvement d’humeur ne laisse pas de m’interloquer : sans y chercher, comme d’autres, l’indice d’un affligeant irénisme néo-hippy, j’y vois plutôt une révolte libertarienne, anti-étatique et ici anti-système-légal, attitude typiquement américaine et qui n’est pas sans rappeler celle de Linus Torvalds — lequel est d’ailleurs exactement de la même génération que Paley.

- Conseil
- « Peux-tu me donner un conseil ?
— Pourquoi me demander comment vivre ta vie ?
— Comme ça, lorsque ça tourne mal je sais à qui le reprocher. »
Mais surtout, je ne peux que me demander s’il n’y a pas quelque chose d’irresponsable à proposer un modèle de diffusion culturelle sans même vouloir considérer ses possibles implications juridiques. Par exemple, omettre (ici délibérément) le signe © sur une œuvre, en droit américain, a longtemps revenu à renoncer à tous droits dessus (patrimoniaux et moraux, puisque ces derniers n’existent pas en tant que tels) — comme un grand studio hollywoodien en a autrefois fait l’expérience involontairement. (Cette bizarrerie est en théorie « corrigée » depuis la ratification de la Convention de Berne en 1988, mais l’absence du signe © est toujours unanimement déconseillée.)
Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure Paley elle-même connait — et respecte — les véritables droits des véritables auteurs. Ainsi, les nombreux effets sonores que Paley utilise dans ses dessins animés, ne sont jamais « crédités » au générique — pas plus que l’abondant matériel photographique dont elle se sert sous forme de collages, dans ses animations ou bandes dessinées : le fair use n’exonère pourtant pas de citer ses sources. Ce qui nous amène à un regard différent sur le film Sita Sings The Blues, qui a tant fait parler de lui quant aux chansons de Hanshaw… mais dont personne, à ma connaissance, n’a souligné les autres emprunts, plus discrets mais moins assumés. Quant aux chansons elles-même, il ne me semble pas qu’elles soient sans soulever de questions. Comme le fait remarquer agressivement un documentariste, c’est en pleine connaissance de cause que Paley a choisi d’inclure dans son film des œuvres potentiellement problématiques, là où tout autre cinéaste se serait torturé pendant longtemps sur la question du choix des musiques et de l’obtention des droits.
On peut donc voir dans la démarche de Paley, aussi bien une admirable intégrité artistique sans concession… ou une attitude méprisante et irresponsable. À ces deux points de vue possibles, le Libriste que je suis en ajoute un troisième : de même que les programmeurs de logiciels Libres, depuis plus de trente ans, sont obligés de tout réinventer et ré-implémenter par eux-même, la solution la plus saine pour Paley n’aurait-elle pas été d’engager une poignée de musiciens (qui ne demanderaient pas mieux) pour recréer une bande sonore pleinement Libre, sur les mêmes gestes et mêmes intentions musicales ? En fin de compte, Sita Sings The Blues restera, non comme le premier long-métrage Libre que beaucoup attendaient (et attendent encore), mais comme une opportunité historique magistralement manquée : outre ses emprunts incertains ou (seulement) partiellement dépénalisés, les fichiers source du dessin animé (d’ailleurs très peu mis en avant sur son site) requièrent l’utilisation d’un logiciel propriétaire — et n’ont d’ailleurs même pas été rendus publics. Quelles que soient ses intentions, quelle que soit sa licence, ce film n’incite pas à la création d’œuvres dérivées : ni d’un point de vue technique, ni d’un point de vue juridique… ni même, d’ailleurs (nous y reviendrons plus bas), d’un point de vue artistique.
Les lacunes juridiques ou le manque de rigueur intellectuelle sont, certes, des travers pardonnables — et dont personne n’est exempt — ; cependant, Paley s’étant faite porte-parole du mouvement Libre, détentrice d’un parole publique (ses conférences constituent pour elle une importante source de revenus), ses travaux et son discours ne peuvent que se trouver happés dans l’ambiguïté de toute personne qui a à la fois des convictions à défendre… et un produit à vendre. Dans la brochure publicitaire que je mentionnais il y a peu, Paley évoque le lien financier qui l’unit à son public :
À l’époque où mon film était encore illégal et que l’argent se perdait à flots dans les frais de justice et de licences, j’ai dit comme une plaisanterie que si ce film était gratuit, au moins je pourrais vendre des T-shirts. Et j’ai alors réalisé que c’était en fait là que l’argent se trouvait : dans les produits dérivés et les soutiens volontaires.
Quand un artiste est fauché, tout le monde se dit que son travail ne doit pas être si bon que ça, alors que c’est sans rapport. J’ai aussi vu des artistes qui refusaient de créer à moins d’être payés. Pour moi, au contraire, je n’ai jamais touché autant d’argent que lorsque j’ai commencé à utiliser la licence Creative Commons by-sa. Je suis au premier plan ; je n’ai pas besoin d’investir dans de la promotion, mes fans le font pour moi et achètent mes produits dérivés. C’est en partageant que je devenue visible.
Discours sensiblement différent de celui de Konrath, pour qui le « poids » d’un auteur est financièrement quantifiable. De fait, Paley est aussi prompte à critiquer les auteurs cupides… que ceux qui dénoncent (hypocritement selon elle) l’exploitation des bénévoles. Dialectique pas entièrement surmontée par Paley, qui semble elle-même, dans cette autre interview extraite du documentaire Libre Copier n’est pas voler, éprouver quelques difficultés à articuler ensemble ses motivations artistique, financière et « amoureuse » :
Vous savez, je ne fais pas ça pour l’argent. Je fais ça par amour ; la plupart des artistes font ça par amour. J’ai aussi besoin de me nourrir, donc… j’ai l’amour de l’argent — euh, je veux dire, ce n’est pas la même sorte d’amour mais : je, je suis du genre, pro-argent. Je suis très pro-revenu pour les artistes. Mais en fait je suis pro-art. L’art — je suis au service de l’art, c’est cette vie que j’ai choisie, euh, c’est mon job. L’art vient d’abord.
Il y a donc une large part d’irrationnel dans l’affection débordante que témoigne à Paley son très large public, affection dont les motivations sont sans doute multiples. La communauté Libriste, très certainement, lui est infiniment reconnaissante d’avoir embrassé la « cause » du copyleft : ainsi de ce Libriste qui voit respectivement en Richard Stallman et Nina Paley… « son papa et sa maman ». Une composante d’attirance hétérosexuelle (physique ou imaginaire) n’est sans doute pas non plus à exclure, dans une communauté geek très majoritairement masculine et prompte à se trouver des égéries parmi les personnalités de sexe féminin, pour peu qu’elles soient versées dans l’informatique (par exemple telle ex-ministre française, à tort, ou telle actrice américaine, à raison — ô combien) — phénomène d’ailleurs à double tranchant, comme le montre cet internaute anonyme qui remplace entièrement la page Wikipédia de Paley par : « Nina Paley est moche ».
Ces facteurs d’explication, toutefois, ne semblent pas suffisants. En particulier, ils ne permettent pas de comprendre pourquoi le succès de Paley s’étend au-delà de la seule sphère Libriste ou geek, et pourquoi, par exemple, le film Sita Sings The Blues se retrouve gratifié d’un score ahurissant de 100 % sur le site de critiques Rotten Tomatoes — score que n’atteignent pas d’autres films indépendants qui arborent eux aussi leur faible budget. Le film de Paley est même parvenu à enchanter jusqu’au célébrissime et redoutable Rogert Ebert, lui aussi natif de la ville d’Urbana.

- Sita Sings The Blues
Pourtant ce long-métrage ne me semble pas exempt de reproches : montage maladroit (quelques lenteurs injustifiées, dialogues en champ/contrechamp poussifs), construction narrative pas toujours bien gérée (enchaînements parfois trop systématiques ou au contraire peu cohérents, déséquilibre global de la progression dramatique) esthétique indécise (du dessin scanné-tremblotant au dessin vectoriel somme toute assez impersonnel, en passant par des procédés de collages pas toujours motivés), manque de caractérisation des personnages (à l’exception notable des fameuses « trois silhouettes » qui conversent informellement avec un accent indien) ce film, surtout, vieillit mal : ce qui aurait été une prouesse technique d’animation 2D au début des années 2000 (voir le court-métrage Fetch récompensé à l’époque par quelques festivals), a bien du mal à impressionner aujourd’hui. Quelque expressivité que recherche Paley (qui a été jusqu’à « rotoscoper » à la main la danseuse Reena Shah), les formes géométriques et les couleurs tranchées persistent à renvoyer constamment à un « degré zéro » du cartoon, où le lyrisme n’opère plus, et où se désamorce la volonté de l’auteur, pourtant parfois ostensiblement réaffirmée, de réaliser une œuvre malgré tout « sérieuse ».
Cette insuffisance n’est malheureusement pas rattrapée par la bande son : même en étant sensible au charme des goualantes des années 1920 (ce qui n’est hélas pas mon cas), l’accompagnement musical est en fait constitué en majorité… de musique synthétique parfaitement actuelle (réalisée notamment par Todd Michaelsen), et à vrai dire assez pauvre, quoiqu’elle tente de se donner quelques accents exotiques indéterminés. J’exposais plus haut mon regret qu’il n’ait pas été fait appel à des musiciens d’aujourd’hui pour ré-inventer des chansons aussi expressives que celles de Hanshaw ; comme si la réalisatrice, mue par la croyance que seul des objets musicaux anciens, sacralisés, pourraient atteindre à une telle expressivité, s’était montrée de ce fait bien moins exigeante quant à la qualité des objets musicaux « profanes », c’est-à-dire modernes.
Le point de vue que je développe ici, naturellement, repose sur beaucoup de subjectivité. Il montre néanmoins qu’il n’est pas impossible d’être déçu par Sita Sings The Blues, et partant, que les (au demeurant nombreuses) qualités intrinsèques du film ne suffisent pas à expliquer ce fameux score de « 100 % ». C’est qu’opère un envoûtement d’un autre ordre : derrière le mythe ancien qu’elle met en scène, se trouve en fait une parole mythologique de Paley elle-même. Pour détourner le propos de Roland Barthes sur Minou Drouet, l’enfant-poète des années 1950, « une légende est une légende. Oui, sans doute. Mais une légende dite par Nina Paley, ce n’est déjà plus tout à fait une légende, c’est une légende décorée, adaptée à une certaine consommation, investie de complaisances visuelles, de révoltes, d’images, bref d’un usage social qui s’ajoute à la pure matière ». Là où une légende se prête à de multiples interprétations, le film de Paley nous dicte un mode de signification, et transforme son auteur même en figure, son écriture même en message. Sita Sings The Blues est plus qu’un exploit technique, fruit du travail tenace et courageux d’une seule personne avec des moyens très restreints : il est le récit — épique — de cet exploit. L’objet mythologique est donc moins le personnage de Sita, que le parcours de cette artiste qui, jeune, inconnue, (très relativement) isolée, a travaillé pendant de nombreuses années avec pour seule motivation d’exprimer avec originalité et courage, l’histoire de sa découverte de l’Inde, de ses ruptures amoureuses et de son émotion à l’écoute de vieilles chansons (je dis bien : l’histoire de son émotion, plus que l’émotion elle-même).
Ostensiblement poétique (et renvoyant d’ailleurs fréquemment à des motifs enfantins), l’écriture visuelle de Paley peut se décrire comme la poésie de Minou Drouet que Barthes moquait en son temps : « une suite ininterrompue de trouvailles, [qui] produit elle-même une addition d’admirations » — la comparaison s’arrête toutefois là, dans la mesure où Paley, comme nous le voyions ci-dessus, cherche à raconter une histoire personnelle et autrement expressive, où la thématique de l’amour tient une place prépondérante. Ce qui nous renvoie, curieusement, au « copyheart » vers lequel Paley se tournera quelques années plus tard : qu’il soit narratif et autobiographique comme dans Sita Sings The Blues, ou symbolique sous forme de petits cœurs, ce motif amoureux contamine tout le projet artistique de l’auteur (du moins tel qu’elle le déclare), qui semble ainsi vouloir s’abstraire, non seulement de rigueur juridique comme nous l’avons vu, mais même de toute conceptualisation ou formalisme. On peut se demander si l’art, tel que le pratique et l’envisage Paley depuis 2004, n’est pas voué à se réduire à une parole élégiaque.
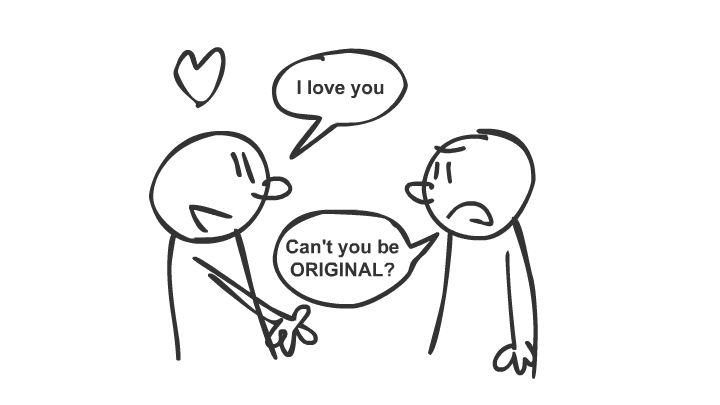
- Le culte de l’originalité
- « Je pense que chaque message humain peut se résumer en un seul, qui ne pourra jamais être dit assez : Je vous aime. »
♡ Nina Paley, 2009.
La critique de Barthes à laquelle je fais ici référence n’est donc pas incongrue ; il y a bien une écriture « mythologique » dans Sita Sings The Blues, mais pas au sens où l’entend l’auteur. Le mythe est ici l’œuvre elle-même… et ce mythe ne laisse de fait aucune place à une pensée du réel, par exemple socio-politique, que Paley balaye elle-même un peu rapidement : « Certains académiciens bon chic bon genre ont décidé, sans se donner la peine de regarder l’œuvre, que toute personne de couleur blanche qui entreprend un tel projet est par définition raciste, et que c’est encore un exemple de néo-colonialisme. ». Je n’irais certes pas jusque là, mais je dois avouer un certain malaise en voyant, dans l’« interlude » du film, les personnages de la mythologie indoue siroter un soda, grignoter du popcorn ou des hotdogs, tels des américains moyens. Peu importe qu’il s’agisse là d’une allusion, non pas aux États-Unis directement, mais à Bollywood et à l’Inde moderne, occidentalisée (quoique toujours fondamentalement inégalitaire) : n’est-ce pas occulter que ladite Inde moderne subit la domination économique écrasante desdits États-Unis, à grands coups d’OMC, de FMI, de call-centers délocalisés et acculturants, de brevets et d’OGM ?
De fait, l’on n’entend plus Paley, aujourd’hui, parler de surpopulation (sinon de façon détournée), de justice sociale ou de défense des minorités. Cette page de sa vie militante est manifestement tournée, entièrement remplacée par son engagement Libriste. Tout comme, dans un même temps, son travail artistique autrefois polygraphique et polytechnique, semble avoir perdu en hardiesse ce qu’il a gagné en cohérence et en accessibilité. De même, enfin, que son site web autrefois exubérant d’humour, de curiosités et d’auto-ironie, se résume aujourd’hui à un blog WordPress relativement terne. Peut-être Nina Paley, avec le succès, a-t-elle enfin trouvé une place à part entière dans le monde culturel Libre, un équilibre apaisant, un âge de raison artistique. Ou peut-être est-ce là, tout simplement, ce que l’on nomme vieillir.


pere.despeuples
Merci pour cet article. c’est très long, et donc dur à lire mais c’est informatif, documenté et ça a l’air exhaustif. Pour ce qui est du ton, je le trouve dur. Je comprends que les enjeux sont complexes et que précisément pour cette raison, il faut traquer le « diable dans les détails », essayer de laisser le moins de place possible à l’approximation, et pointer les contradictions dans les démarches libristes superficielles et/ou incohérentes…mais Nina Paley n’est qu’un être humain et donner l’impression de rejeter ceux qui défendent imparfaitement la cause risque de nous isoler. je comprends bien que ce n’est pas du tout l’idée ni l’intention de valentin, mais je pense qu’on gagnerait à avoir l’air plus fédérateur. Naïf de ma part ?
libre fan
Merci aussi, Valentin, pour cet article très bien écrit. Tu as sans doute raison pour tout mais je pense qu’on ne peut pas attendre de grand-monde d’utiliser des logiciels libres. Moi aussi, le Flash me dégoûte mais les webmestres adorent ça et je conçois que des artistes s’amusent comme des fous avec ça. Ce serait bien qu’ils prennent un joujou libre. Paley n’est pas la seule à faire du libre avec du propriétaire: voir les gens de Lacrymosa (n’utilisent pas Blender). J’avais fait la remarque sur framablog lors de la sortie libre de Sita qu’il restait à Nina Paley de découvrir les logiciels libres (de les utiliser bien sûr) et les formats ouverts.
Quant à lui reprocher d’utliliser les réseaux sociaux, regarde autour de toi tous les Libristes qui les utilisent ou qui sont sous Mac ont des iTrucs ou surfent avec Chrome/Chromium. Ici même, je dois bloquer Google Analytics ou le bouton Twitter qui devraient être exclus sur Framablog. Il n’y a qu’une minorité qui dit zut à Facebook et tout ça et on doit nous traiter de crétins.
Plus fondamentalement, je pense que l’idée de Nina Paley est que l’art est copie (voir sa vidéo avec les statues tournantes). Tout est bon à copier dans la culture et on peut se servir comme on veut pour en faire ce qu’on veut. Je ne pense pas que ce soit du mépris. Il faudrait juste savoir si elle-même se laisse copier mais il semble que oui.
Elle fait de l’art de manière très différente de ce qu’ont fait l’équipe d’Elephants Dreams. Tu aimerais sans doute qu’elle fasse plutôt comme eux. Ce n’est pas sa manière, c’est sûr.
Je t’ai trouvé bien sévère avec Sita qui m’a réjouie (mais je ne suis qu’une spectatrice). Les 3 Indiens qui commentent la légende sont des répliques des étudiants américains et j’ai trouvé ça très amusant. Y voir du néocolonialisme ou de l’irrespect me semble déplacé. Je pense plutôt que que le propos de Paley n’est pas de représenter des étudiants indiens en Inde mais de mélanger l’ancien et le moderne, de signifier combien une antique légende est toujours vivante, et que par elle la différence entre deux lieux géographiques et culturels si distants est vidée par la légende qui représente (au sens théâtral) une tranche de vie.
Bref, elle a fait sienne cette légende étrangère et c’est ce qui est intéressant. J’aime beaucoup aussi son cynisme qui nous permet de rire d’elle (sans méchanceté) sans craindre de la blesser.
Enfin, ta comparaison avec Molière est très judicieuse, je trouve. Quand on voit le poids des avocats et des procès en tous genres (patents, copyright) aux US, et vu ses histoires avec «sa» musique dans Sita, on comprend qu’elle en ait marre. Je comprends aussi qu’elle en ait marre d’expliquer que oui, vous pouvez copier ma musique. Beaucoup d’artistes aiment faire ce qu’ils font sans avoir à se soucier du reste: d’où la SACEM, d’où Jamendo. Elle au moins a décidé de lancer sa nouvelle licence, bidon d’accord, mais qui est un message clair. Elle n’a pas choisi la voie de Stallman-Moglen mais on peut l’accepter. Il y a toutes sortes de voies/voix.
Je ne connais pas la vie artistique américaine donc je ne sais pas si Nina est originale ou une simple copie qui nous est parvenue en France.
Property is Poopery. C’est peut-être léger comme argument, mais c’est bien drôle et notre ex-ministre de la culture maintenant inventant un droit de lecture pour le compte d’Orange doit être folle de rage en lisant de telles obscénités. Les surréalistes en ont dit d’autres.
Pandark
J’ai lu tout le billet, et j’ai juste envie de dire à l’auteur qu’il n’a rien compris.
Ce qui m’a vraiment embêté, c’est que j’ai l’impression que l’auteur est complètement passé à côté du second degré et de l’humour que j’apprécie beaucoup chez Nina Paley.
On dirait vraiment que ce portrait fait à charge, et je pense vraiment qu’elle méritait mieux que ça.
Je n’ai pas trop aimé non plus le démontage en règle de Sita Sings the Blues, expliquant grosso modo que les gens ont tord d’aimer et que si vraiment ils persistent alors ce n’est pas pour ses qualités (il n’en a pas) mais par une manipulation utilisant leurs émotions (Quoi ? apprécier une œuvre pour des raisons émotionnelles ? c’est inconcevable !).
Et aussi puis force de se référer à Stallman pour la terminologie, l’auteur oublie que les termes Libre et Free existaient avant que rms se les approprie et qu’ils ont de nombreux autres sens. Free Art ne veut pas dire GPL-Free Art, et parler des Libristes comme une bande de geek vénérant rms (des GNU/Libristes ?) et ayant se cherchant une « maman libre » d’adoption… au minimum c’est réducteur.
Personnellement, rms n’est pas mon messie, et pire, je ne suis même pas persuadé que les licences GNU soient toujours les meilleurs.
De toute manière, même Stallman dit clairement que l’on ne peut pas appliquer à la lettre le modèle du logiciel libre sur n’importe quoi. Les licences généralement utilisées par les artistes, que soit Art Libre ou Creative Commons, n’obligent absolument pas à redistribuer un « code source » des documents utilisés. Des gens qui ne savent pas lire de musique peuvent faire des mashups ou des remix ; on peut réutiliser des dessins ou des photographies sans avoir des croquis préliminaires ou d’un négatif. En général, il n’y a pas « une source », juste un format d’acquisition ou le format choisi lors du premier enregistrement. D’ailleurs, la limitation qui a empêché Nina Paley d’utiliser les chansons d’Annette Hanshaw sans l’accord des ayants droits n’était pas pratique ou matérielle mais bien uniquement légale.
Cet prise en otage du mot Libre me rappelle ces gens qui appelaient à ne pas soutenir Oxyradio entre autre parce qu’en disant « musique libre » pour « musique de libre diffusion », ils étaient censé aller contre la propagation du « vrai » libre et par extension du logiciel libre.
Je ne pense pas qu’il soit très malin de reprocher aux gens qui font le promotion de la Culture Libre de ne pas être des fondamentalistes du Libre (Free-as-in-zealot). Surtout qu’en parlant des réseaux sociaux non-libres, on pourrait renvoyer la question à l’auteur du billet.
Quand à la vente de produits dérivés, c’est juste un des moyens les plus répandus de gagner ou récolter de l’argent avec du libre, et en l’occurrence il ne s’agit pas seulement d’une marque déposée plaquée sur un t-shirt à peine adapté par un sous traitant mais aussi de vraies créations originales.
L’article fourmille de liens. J’ai suivi quelques uns d’entre eux, et trouvé le contraire de ce qu’ils annoncent. Le défaçage vandaliste de la page wikipedia ne concerne un seul paragraphe et l’IP utilisée a uniquement servi à des actes de vandalisme bête et méchant sur Wikipedia. La Free Software Song date de presque vingt ans avant la chanson dont elle est censé être dérivée d’après le billet…
vvillenave
Bonsoir tous (et toute !),
Alors, dans l’ordre mais en vrac :
@pere.despeuples (grand ou petit?) :
C’est amusant que vous trouviez mon ton « dur » : le maître de ces lieux (a.k.a. aKa) a lui-même présenté cet article en utilisant le mot « tendresse »… http://identi.ca/notice/84529339
Comme vous l’avez très justement compris, il n’y a aucune intention de « rejet » dans ma démarche, et je n’ai d’ailleurs à aucun moment reproché à Nina Paley de « défendre imparfaitement la cause », bien au contraire : recherchez « un militantisme Libriste remarquablement complet » dans mon texte, et l’énumération qui suit.
Concernant le ton, il est certain que j’ai tenté d’éviter le bisounoursisme trop souvent arboré par les geeks qui parlent 1) de Libre 2) d’art 3) de femmes 4) de Nina Paley — tout simplement parce que mon projet dans ces chroniques est précisément de tenter d’élaborer une critique du mouvement Libre en passant notamment par les travers idéologiques véhiculés par certains de ses « mythes ». Je n’écris donc que sur des sujets auprès desquels je trouve un tel angle d’attaque : c’est pour cela, par exemple, que je n’ai pas encore envisagé d’article sur les licences Creative Commons, qui se prêtent pourtant à bien des critiques mais ne me fournissent pas — encore — de parole « mythologique » remarquable. (À l’exception de l’infâme dépliant publicitaire récemment paru sous l’intitulé « The Power Of Open », financé par Google® et que j’ai commencé à mettre en pièces avec l’article précédent sur Jamendo et celui-ci sur Paley.)
Pour tout vous dire, je suis à l’origine un fan de Nina Paley, autant que beaucoup de lecteurs du Framablog. Comme s’en souviennent peut-être ceux qui ont eu l’occasion d’assister à une conférence que j’ai donnée il y a quelques mois, mon propos était à l’origine une **défense** de Paley suite au reproche « d’irénisme » que faisait Antoine Moreau à son « copyheart ». C’est en cherchant à approfondir le sujet que j’ai découvert d’autres pistes, d’autres facettes : autrement dit, je me suis peu à peu rendu compte que ma propre opinion de Paley était jusque là très irrationnelle, et que je la voyais moins comme une personne ou un auteur, que comme un _mythe_. Cet article (qui a été plusieurs fois réécrit, d’où sa longueur) est donc le compte-rendu de ce cheminement, dans un ton volontairement froid, neutre et critique : notamment, je désigne Paley par son nom de famille plutôt que par son prénom, comme on le ferait habituellement plutôt pour un homme que pour une femme.
@libre fan:
Message transmis à Lacrymosa, qui méritent effectivement des coups de pieds quelque part 🙂
Très franchement, savoir qui utilise quel logiciel, ça m’importe peu : si Nina Paley faisait du ASCII-Art, ça ne me viendrait pas à l’idée de demander si elle le fait sous Microsoft NotePad® ou sous Kwrite. Par contre la question des _formats_, est une question absolument primordiale dès que l’on veut publier sous copyleft. Dire « vous avez le droit de créer de nouvelles œuvres à partir de mon œuvre » sans donner les moyens concrets pour cela, c’est manquer d’intégrité ou de cohérence. Dans le cas de Paley, je crois que c’est avant tout une phase transitoire : n’oublions pas qu’on parle de quelqu’un qui n’avait aucune idée de ce qu’étaient les licences Libres il y a encore cinq ans. Phase transitoire également pour le Flash, qui sera tombé aux oubliettes d’ici quelques années comme un mauvais souvenir, et que quelques logiciels Libres permettront d’importer sans souci du fla ou du swf.
Les Libristes sous Mac et sur Facebook/Google+… euh… bon, je suis de bonne humeur donc on évitera pudiquement le sujet. Et le Google Analytics ou le bouton Twitter du Framablog, ça mérite effectivement un châtiment corporel indiqué ci-dessus.
Alors pour Sita, attention hein, j’ai moi-même _explicitement_ écarté toute lecture néocolonialiste. Je n’accuse pas Paley d’irrespect (ça ne me ressemblerait pas) mais de légèreté : il me semble qu’un américain qui se retrouve dans un pays _de fait_ colonisé (ou du moins sous une intense domination économique et culturelle) par les États-Unis, se doit de garder un regard lucide sur son _propre_ pays et son _propre_ impérialisme. Et ce regard critique, je n’en trouve aucune trace dans le film de Paley ni dans ses écrits. Et cette absence me met mal à l’aise. Je n’ai rien dit d’autre.
« Beaucoup d’artistes aiment faire ce qu’ils font sans avoir à se soucier du reste » -> c’est très vrai. De même que la plupart des citoyens n’en ont cure de savoir qui les gouverne ou si les Droits de l’Homme sont respectés près ou loin de chez eux, tant qu’ils se voient donner du pain et des jeux. Reste à savoir si un auteur qui fait (pleinement, volontairement) le choix de publier sous une licence Libre, peut se permettre de rester à sa « place » d’artiste, sans se soucier « du reste ».
(Juste une remarque en passant : votre phrase me semble d’ailleurs tout à fait intéressante de par son emploi du terme « artiste », que j’ai critiqué ici (notamment épisode 3 et 6, notamment en passant par La Distinction de Bourdieu et L’Écrivain en vacances de Barthes.) : je dirais pour ma part que quelqu’un que l’on désigne comme « artiste », se définit précisément… comme quelqu’un qui « n’a pas à se soucier du reste ». Que ce soit parce qu’il n’en éprouve pas le besoin ou parce que ce n’est pas sa _place_.)
@Pandark:
Ahem. Première petite remarque de forme, si votre propos était de démontrer que l’on peut aimer le travail de Nina Paley (c’est mon cas) sans être un fanboy irrationnel et agressif… vous êtes mal parti. Mais tentons de discuter sur le fond.
Les produits dérivés. Oui, vous avez remarqué que vendre des produits dérivés est une démarche commerciale. Ça tombe bien, c’est exactement ce que j’ai dit. (Comme quoi les grands esprits, etc.) Quant à la qualité des produits en question, n’ayant pas encore reçu mon mug Mimi&Eunice il m’est impossible de me prononcer mais je vous fais pleinement confiance.
L’humour. Oui, c’est vrai, Nina Paley a beaucoup d’humour. Il se trouve qu’après avoir passé de longues heures à lire ce qu’elle a écrit entre 1988 et 2011 (est-ce votre cas ?), j’avoue trouver plus drôles et plus surprenants ses travaux des années 1990-1998 que ce qu’elle fait depuis cinq ans. Question de (léger) glissement esthétique et idéologique. Mais aussi question de goût.
Deuxième remarque : je suis ravi que vous ayez lu tout le billet, mais peut-être un peu vite. Je n’ai pas tenté d’attaquer le film « Sita Sings The Blues » au démonte-pneus, j’ai simplement dit ce que j’en pensais (en particulier en ce qui concerne la musique, qui se trouve être mon domaine d’expertise). Vous me faites dire (si je comprends bien votre propos) que ce film n’a _pas_ de qualités ? Ma phrase exacte était :
« [Mon] point de vue, [qui] repose sur beaucoup de subjectivité, […] montre qu’il n’est pas _impossible_ d’être déçu par Sita Sings The Blues, et que les (au demeurant nombreuses) qualités intrinsèques du film ne suffisent pas à expliquer ce fameux score de « 100% » [sur Rotten Tomatoes] ».
Vous avez donc lu à l’envers. Ne vous frappez pas, ça arrive.
Par contre, j’admets que ma phrase sur la Free Software Song prêtait à confusion (pour peu que l’on y mette un tantinet de mauvaise volonté, hmm ?) :
« ce clip musical d’une minute a pour but explicite de susciter une vague d’enthousiasme et de versions dérivées comme [l’a fait], par exemple, la Free Software Song de Richard Stallman [en son temps] »
Ça va mieux comme ça ?
Je compatis pour la « prise d’otage » odieuse que vous dénoncez courageusement. Il n’en demeure pas moins que le terme « licence Libre » a un sens. Un sens documenté, formalisé, conceptualisé : je sais, ça fait tout plein de mots de plusieurs syllabes donc c’est un peu fatigant, la vie est mal faite. http://valentin.villenave.net/Quelq…
Et lorsque l’on fait dire à un mot ce qu’il ne veut pas dire (ou que l’on entretient une confusion délibérée), ça s’appelle soit une maladresse soit de la propagande (ma chronique précédente l’illustre).
Bon, pour tout ce qui est de rms aussi, je ne peux que vous suggérer de relire (pas trop vite, cette fois !) les chroniques précédentes (épisode 1 et plus particulièrement épisode 6), où j’ai tenté de développer les questions précises que vous soulevez.
RTFL: Read The Fine Librologies 🙂
Pour répondre à votre remarque ad-hominem: je ne suis **pas** sur Twitter® et Facebook®. Je n’y ai aucun « ami » et n’y ai mis les pieds qu’une seule fois (le jour de l’ouverture de mon compte). J’y ai ouvert un compte pour une seule raison, qui est d’éviter que quelqu’un d’autre le fasse à ma place. Voici la version anglaise de mon message d’accueil sur Facebook, n’hésitez pas à me dire si ça ne vous paraît pas assez vendeur :
« » »
This is but a placeholder.
Do not bother friending me.
Do not try and contact me through f*book.
Do not expect me to update this page. Ever.
If you’re still interested in me now, just do yourself a favor, go out on the proper Web and visit my personal website.
«
pere.despeuples
Oui, l’angle du mythe façon Barthes. Je comprends. C’est cohérent et récurent dans vos chroniques. et loin de moi l’idée que vous détestez Nina Paley. le côté « dur », c’était juste une impression que j’avais en sortie de lecture. Là j’ai la flemme de relire une deuxième fois pour infirmer/confirmer mon impression. En tous cas, vous lire structure les idées. et pour le détail :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_…
vvillenave
@pere.despeuples: Merci. Ces chroniques étaient à l’origine un hommage-pastiche au texte de Barthes (comme je l’ai exposé dans l’épisode 0), même si le projet a quelque peu dérivé depuis.
[off-topic] Puisqu’on en est à l’échange de lien bolcheviques, http://empirelapinoubolchevique.wor… [/ot] 🙂
Grand Guide Pug
Moi c’est plutôt le Petit Père des Putes, mais bon.
pvincent
((double commentaire possible))
merci, je découvre Nina Paley et « copyheart », très belle idée.
peux-tu expliquer davantage ta proposition de traduction, stp ?
à l’écoute, en prononçant vite, il me semble que « droit-au-cœur » résonne harmonieusement.
point subjectif, le ressenti après lecture.
captivé par la première moitié de l’article, j’ai atteint la fin du texte avec un goût acerbe, un peu désabusé. à contrario, je trouve l’idée « copyheart » tellement magnifique, plus simple et radicale que « copyleft ».
dans un précédent librologie, tu nous avais ouvert les yeux sur les limites visionnaires de rms lorsqu’il postule le caractère « inutile » de l’art.
à la question l’art a-t-il une valeur (et si oui combien) ? Nina Paley offre une réponse appropriée. C’est parce que des notions comme la vie, la paix, la santé, l’éducation ou l’amour sont inestimables qu’on peut les considérer comme sans valeur, haut dessus de tout.
libre fan
@valentin: il n’y a rien d’irrespectueux dans Sita. Comme je l’ai dit elle s’approprie une histoire. Les textes même sacrés sont dignes d’être interprétés.
On dit souvent «artiste» par raccourci mais je comprends bien que ce terme a été accaparé et détourné par le gouvernement et l’hadopi.
Ah, j’oubliais: le titre de ton article dessert ton texte, à mon avis. J’ai failli ne pas lire en pensant retrouver une version d’Antoine Moreau. On lit déjà beaucoup sur Framablog Mme Michu. C’est un peu accablant.
@pvincent: «droit d’aucœur» est un joli mot qui copie «droit d’auteur». Ton «droit-au-cœur» est l’effet que produit la licence de Nina: elle nous va droit au cœur. Pour d’autres, elle leur casse les pieds.
vvillenave
@pvincent: J’ai hésité sur « droit-au-cœur », et j’ai fini par mettre « droit d’au-cœur » pour éviter que le mot « droit » ne se retrouve avec le même sens que dans « ligne droite » : « droit-au-cœur » est très joli mais me ne semble pas correspondre à la démarche de Nina Paley, pour qui l’œuvre n’est pas un objet à sens unique qui va en ligne droite de l’auteur vers le public, mais peut au contraire être redistribuée, recopiée, etc. (Même si, comme j’ai tenté de l’exprimer dans le dernier tiers de l’article, son œuvre reste très contingente à sa propre personne, au besoin « mythifiée ».) Mais la vérité est qu’il serait assez vain de chercher à traduire « copyheart », en fin de compte et quoi que l’on propose. Voilà pour la forme.
Alors maintenant, le fond. Je comprends qu’on puisse être (littéralement) séduit par l’initiative « copyheart ». Enfin, je le _conçois_ mais il m’est personnellement impossible de l’imaginer ou de le ressentir. Je me méfie en général des discours qui déclarent se fonder sur une passion quelle qu’elle soit. Cette attitude (critique, idéologique, brechtienne, intellectualiste, etc.), je la revendique : une version antérieure de cet article, dans mon cahier, comportait par exemple la phrase suivante :
« Sans pouvoir totalement exclure qu’il s’agisse d’un biais cynique de ma part, je ne peux m’empêcher de mettre en rapport la thématique amoureuse de Sita Sings The Blues avec celle du « copyheart ». Qu’elle soit autobiographique ou symbolique, cette thématique, centrale et omniprésente, me semble contaminer toute la démarche de Nina Paley, au point de définir par métonymie sa vision de l’Art. »
C’est cela qui est assez ambigu et étonnant chez Nina Paley : même si elle se décrit (voir la citation d’ouverture) comme « cynique », elle réactive en permanence des motifs d’émotions, en particulier de tendresse et d’amour — motifs d’ailleurs, même si je n’ai pas insisté sur ce point, traditionnellement rattachés à une certaine conception de la féminité. On peut le souligner sans nécessairement rejeter les émotions en question, mais il importe tout de même de rappeler que _même_ une vision en apparence purement affective et irréfléchie ne vient pas de nulle part et n’est pas exempte de bagage politique. « Copying is an act of love », pour moi, c’est _déjà_ un idéologème.
C’est une très bonne idée que de rapprocher la vision qu’ont Stallman et Paley de l’art : j’ai l’impression que pour l’un comme pour l’autre, l’art est une pratique (dé)limitée dont le seul but est, soit — pour l’auteur — de s’exprimer (témoignage, élégie), soit — pour le public — de se divertir. Ce divertissement peut s’entendre, chez Stallman, au sens pascalien du terme : la « consommation » de l’œuvre procure à son public toutes sortes d’émotions, mais qui demeurent inessentielles. Chez Paley, ces émotions ont, certes, une « valeur » indispensable… mais elles demeurent toujours, in fine, la seule justification de l’œuvre d’art.
Le fait que la première moitié de l’article soit plus plaisante à lire et moins désabusée que la seconde, s’explique assez naturellement : j’ai essayé de d’abord présenter l’auteur et son œuvre, _puis_ d’en faire une lecture critique. De plus, la progression de l’article est globalement chronologique, et reflète du coup mon propre sentiment de « vieillissement » que j’exprime dans la dernière phrase. C’est un thème que j’avais également esquissé dans l’épisode 2 sur Linus Torvalds, qui n’a qu’un an de plus que Nina Paley.
vvillenave
@libre fan :
Ne me faites pas dire le contraire de ce que j’ai dit : comme je l’ai dit plus haut, je n’accuse _pas_ Nina Paley d’irrespect. Et d’ailleurs je me soucie très, très peu que l’on « respecte » ou non ce qui est sacré. (À proprement parler, d’ailleurs, sacraliser un objet n’est **pas** le respecter : c’est édifier autour de lui une espèce d’attirail mythologico-social pseudo-transcendent qui n’a plus rien à voir avec l’objet d’origine, et en vient à le masquer.)
Ce qui me semble digne de respect et de considération, en revanche, ce serait bien le _peuple_ indien qui figure parmi les plus pauvres du monde, notamment du fait de l’hégémonie occidentale. Et ce n’est pas avec irrespect que Nina Paley l’évoque : elle ne l’évoque pas du tout. Après, on peut tout à fait considérer qu’une œuvre d’art, particulièrement onirique ou élégiaque, n’a pas à s’encombrer de considérations socio-géo-politiques. Mais cela témoigne d’une certaine vision de l’art, vision qui n’est pas exempte d’idéologie comme j’ai tenté de l’expliquer ci-dessus.
Certes, le mot « artiste » est un raccourci souvent pratique (de même que « pro »). Mais je ne pense pas que ce soit par hasard que ce soit sur ce mot que se fixent et brodent tous les pseudo-débats et la propagande ; j’y reviendrai dans un prochain épisode.
Le titre de l’article est parfaitement stupide, nous sommes bien d’accord. Je l’ai choisi parce qu’il allait bien avec celui de l’épisode 9 (pas encore paru). Et puis je me suis consolé en me disant qu’au moins ça faisait un chiasme phonétique : _(t)a_(t)i_ // _(n)i_(n)a_
En revanche, les « petits cœurs » sont le motif qui m’a conduit à écrire l’article, ce n’est pas un machin que j’ai rajouté par la suite. Comme je le disais ci-dessus, le point de départ est à chaque fois un objet possiblement « mythologique »… D’ailleurs le personnage de (sainte) « Mme Michu » en est un particulièrement gratiné, auquel je prévoyais justement de consacrer un futur article.
(Par contre il faudra m’orienter plus précisément vers les propos d’Antoine Moreau auxquels vous faites allusion. Ça m’intéresse.)
pvincent
@vvillenave merci pour l’éclaircissement, je retiens donc : « droit d’au-cœur » ou copyheart pour faire simple.
à noter que le symbole ? est reconnu par tous les principaux encodings
http://www.fileformat.info/info/uni…
libre fan
Merci Valentin pour les explications. Je suis bien d’accord sur tout en fait, sauf au sujet que l’Inde ne soit pas évoquée. C’est vrai mais ce n’est pas le propos. C’est peut-être un tort aussi, je n’en suis pas aussi sûre. Il y a aussi deux côtés en Inde: une société à la pointe technologique et informatique et une majorité de pauvres.
Pour Antoine Moreau, je n’en sais guère plus que ce que tu en dis: «…mon propos était à l’origine une **défense** de Paley suite au reproche « d’irénisme » que faisait Antoine Moreau à son « copyheart »». J’ai lu un texte analogue mais je ne sais plus où.
Est-ce que des gens qui aiment vraiment le Libre ont essayé d’expliquer certaines choses à Nina Paley ou est-ce qu’elle ne veut pas les écouter? (formats ouverts, logiciels libres, éviter Flash, Facebook, etc.)
@pvincent: pour l’encodage: je n’ai pas réussi à faire un cœur blanc mais toujours noir.
libre fan
@pvincent: je voulais dire avant de lire ton lien, j’avais un cœur noir: http://www.fileformat.info/info/uni…
Donc merci pour le lien 🙂 même si ce n’est sans doute pas une licence que j’utiliserais mais il faudrait réfléchir au vu des arguments pour et contre.
vvillenave
@libre fan : Attention, encore une fois, aux raccourcis : je n’ai pas dit que l’**Inde** n’est pas évoquée, j’ai parlé des aspects sociaux (population exploitée, que ce soit en contexte rural ou urbain).
Pour ce qui est de l’ouverture de Nina Paley aux formats et logiciels Libres, je pense que Nina Paley est en pleine progression depuis six ans — comme le montre notamment le lien suivant, que j’ai inclus dans l’article : http://blog.ninapaley.com/2010/11/1…
En ce qui concerne Facebook/tagada, je pense que l’état d’esprit de Paley est commercial et à court terme : être vue le plus possible, le plus vite possible et par le plus de gens possible. État d’esprit que l’on peut critiquer mais également comprendre : le choix du Libre, pour un auteur, est un choix extrêmement isolant (je parle d’expérience), et il est humain de chercher à compenser cet isolement (et ce manque à gagner, puisque Paley le dit elle-même).
libre fan
Un article bien amusant sur le blog de Nina Paley datant de sept. 2011:
http://blog.ninapaley.com/2011/09/2…
Elle n’est pas arrivé à sortir une bonne image d’un livre. Et elle en fait tout un plateau de fromage, et nous ressort de l’Adobe et tout ça. Un visiteur lui adresse ce message qui est resté sans réponse:
« Commentaire de yonemoto
October 13, 2011 at 11:31 pm
Nina! Use GIMP (it’s FOSS, too!). I grabbed a very nice picture of the horse on the first try. »
Traduction: «Nina, utilise GIMP (en plus c’est libre). J’ai tiré une très jolie image du cheval du premier coup».
Et ce visiteur a mis son image en ligne (sur Picassa, hum).
Nina Paley dit ailleurs (mais je ne retrouve pas le lien, ni la date) quelque chose comme: «Oui, je sais, les logiciels libres, mais tant qu’ils ne font pas aussi bien que mon [Mac et tout le bazar] je ne change pas.»
Et là c’est GIMP qui lui aurait rendu service, comme quoi, les préjugés ont la vie dure. Je me demande où elle en est de son envie de Synfig (youpih, je connais maintenant l’existence d’un nouveau logiciel libre [nouveau, pour moi]). Je me demande si elle a trouvé de l’aide. Les commentateurs étaient prêts à l’aider à installer Ubuntu, c’est sympa.
Sur le site de l’assoc’ QuestionCopyright.org http://questioncopyright.org, c’est un peu inquiétant de lire cet échange en 2009 entre un visiteur et Karl Fogel qui est le président de l’assoc et « an open source developer, author, and copyright reform activist. » Il a publié chez O’Reilly _Producing Open Source Software: How to Run a Successful Free Software Project_ (2005).
===========
Anonymous
Is there any chance of SVG versions of these logos? EPS is not an open standard and is not usable format for some.
#10 Re: Scalable Vector Graphics
Submitted by kfogel on Mon, 2009-03-23 22:36.
Oh, more than a chance. There will be scalable versions. We have some updated versions that I need to post first; then I’ll coordinate with Nina on getting SVG versions here.
By the way, I apologize — I didn’t realize EPS wasn’t an open standard. Can you describe the problems with it?
…
#12 Re: Scalable Vector Graphics
Submitted by fogel on Mon, 2009-04-06 14:16.
Okay, talked to Nina Paley … about this. She knows EPS as the standard for scalable vector graphics. Is there some other format you had in mind? Is SVG a specific format as well as a generic term? If so, can you convert the EPS to that format, or to whatever format is appropriate?
In other words, we need either more specifics here, or volunteerism, or both :-).
Thanks,
-Karl Fogel
=========
En résumé Karl Fogel, développeur Open Source [sic] ne sait pas que EPS n’est pas un format ouvert, ni quel problème ça peut poser. Il ne sait pas ce qu’est SVG non plus. Il se fie à l’avis de Nina qui, elle ne connaît que les logiciels Adobe (au moins à cette date) et pour qui EPS est la norme.
Il est vrai que GIMP, par exemple, étant capable d’ouvrir un fichier EPS, il est facile de dire que c’est donc une norme. On devrait mettre des fichiers XCF en ligne pour taquiner les photoshopeurs.
Ce qui est quand même étonnant, c’est que dans l’équipe (CA ou salariés), il y a au moins deux personnes qui font partie de GNOME.
Bref, je suis tout à fait d’accord avec ce que tu dis Valentin: contenu libre et formats ouverts, ça va de pair.
vvillenave
@libre fan : j’ai vu cet article (il y a un lien dans l’article ci-dessus sur « domaine public »). La question que soulève Nina Paley est parfaitement valable, c’est vrai que les documents d’archives mis à disposition du public (par exemple chez nous sur Gallica) sont en général dans une résolution épouvantable. Après, pour ce qui est des outils effectivement le Libre nous donne des choix qui sont souvent inconnus des auteurs eux-même. (Et Gimp ne tourne vraiment, vraiment pas bien sous Mac OS.)
Pour ce qui est du SVG contre l’EPS, disons que l’EPS a à peu près le même statut que le PDF : c’est un format non-libre mais suffisamment bien documenté pour être largement toléré par la communauté Libre ; LaTeX ou GNU LilyPond sont par exemple très orientés PostScript.
Le SVG est un format extrêmement précieux, mais encore jeune (et dont la spécification, il faut le dire, n’est pas entièrement stabilisée sur certains points, comme le canvas multi-pages). Il est, hélas, bien peu considéré par nombre de graphistes prétendument « professionnels », comme en témoigne cet échange, euh, ferme, entre Alain Hurtig et moi-même sur la liste cc-fr : http://lists.ibiblio.org/pipermail/…
Encore une fois, je pense que la patience est de mise. Si l’on en juge par l’évolution du Web, les standards ouverts finissent en général par l’emporter (qui se souvient du gif aujourd’hui ?).