 L’histoire retiendra que c’est dans un bar d’une petite ville du nord de l’Italie qu’est né le projet Arduino qui, de manière totalement inattendue, est en train de révolutionner le domaine de l’électronique à l’échelle mondiale, puisque pour la première fois tout le monde peut vraiment s’y essayer et découvrir qu’il aime ça !
L’histoire retiendra que c’est dans un bar d’une petite ville du nord de l’Italie qu’est né le projet Arduino qui, de manière totalement inattendue, est en train de révolutionner le domaine de l’électronique à l’échelle mondiale, puisque pour la première fois tout le monde peut vraiment s’y essayer et découvrir qu’il aime ça !
L’histoire retiendra également que rien de tout ceci n’aurait été possible sans le choix initial des licences libres qui a conditionné non seulement son bas prix et sa massive diffusion mais également son approche et son état d’esprit[1].
Acteur et non consommateur, on retrouve ici le goût de comprendre, créer et faire des choses ensemble. Concepts simple et plein de bon sens mais que notre époqu’Apple a fortement tendance à oublier.
PS : Ceci est la troisième traduction de suite initiée sur Twitter/Identica et réalisée dans un Framapad. Je remercie vivement tous les volontaires qui ont bossé dur hier soir pour arriver à un résultat d’un étonnante qualité quand on pense que les invitations sont ouvertes à tout le monde. On se donne rendez-vous, on communique, on se met d’accord sur tel ou tel passage via le chat intégré… au final on passe un moment ponctuel et commun agréable tout en travaillant (bénévolement). Je reste fasciné par le dynamisme et la bienveillance des gens et par la capacité d’Internet à favoriser cela. Si vous voulez vous aussi participer aux prochaines, il suffit de me suivre sur Twitter ou Identica avec le hashtag (que je viens d’inventer) « #EnFrSprint ».
La genèse d’Arduino
The Making of Arduino
David Kushner – Octobre 2011 – Spectrum
(Traduction Framalang : Yoha, Keyln, Fab et Luc)
Ou comment cinq amis ont conçu la petite carte électronique qui a bouleversé le monde du DIY (Do It Yourself – Faites-le vous-même).
La pittoresque ville d’Ivrea, qui chevauche la rivière bleue-verte Dora Baltea au nord de l’Italie, est connue pour ses rois déchus. En l’an 1002, le roi Arduin (Arduino en italien) devint le seigneur du pays, pour être détrôné par Henri II d’Allemagne, deux ans plus tard. Aujourd’hui, le Bar di Re Arduino, un bar dans une rue pavée de la ville, honore sa mémoire, et c’est là qu’un nouveau roi inattendu naquit.
C’est en l’honneur de ce bar où Massimo Banzi a pour habitude d’étancher sa soif que fut nommé le projet électronique Arduino (dont il est le cofondateur). Arduino est une carte microcontrôleur à bas prix qui permet — même aux novices — de faire des choses époustouflantes. Vous pouvez connecter l’Arduino à toutes sortes de capteurs, lampes, moteurs, et autres appareils, et vous servir d’un logiciel facile à appréhender pour programmer le comportement de votre création. Vous pouvez construire un affichage interactif, ou un robot mobile, puis en partager les plans avec le monde entier en les postant sur Internet.
Sortie en 2005 comme un modeste outil pour les étudiants de Banzi à l’Interaction Design Institute Ivrea (IDII), Arduino a initié une révolution DIY dans l’électronique à l’échelle mondiale. Vous pouvez acheter une carte Arduino pour seulement 30 dollars ou vous construire la vôtre à partir de rien : tous les schémas électroniques et le code source sont disponibles gratuitement sous des licences libres. Le résultat en est qu’Arduino est devenu le projet le plus influent de son époque dans le monde du matériel libre.
La petite carte est désormais devenu le couteau suisse de nombreux artistes, passionnés, étudiants, et tous ceux qui rêvaient d’un tel gadget. Plus de 250 000 cartes Arduino ont été vendues à travers le monde — sans compter celles construites à la maison. « Cela a permis aux gens de faire des choses qu’ils n’auraient pas pu faire autrement. », explique David A. Mellis, ancien étudiant à l’IDII et diplômé au MIT Media Lab, actuellement développeur en chef de la partie logicielle d’Arduino.
On trouve des alcootests, des cubes à DEL, des systèmes de domotique, des afficheurs Twitter et même des kits d’analyse ADN basés sur Arduino. Il y a des soirées Arduino et des clubs Arduino. Google a récemment publié un kit de développement basé sur Arduino pour ses smartphones Android. Comme le dit Dale Dougherty, l’éditeur et rédacteur du magazine Make, la bible des créateurs passionnés. Arduino est devenu « la partie intelligente dans les projets créatifs ».
Mais Arduino n’est pas qu’un projet open source ayant pour but de rendre la technologie plus accessible. C’est aussi une start-up conduite par Banzi et un groupe d’amis, qui fait face à un challenge que même leur carte magique ne peut résoudre : comment survivre au succès et s’élargir « Nous devons passer à l’étape suivante, et devenir une entreprise établie. » m’explique Banzi.
Arduino a soulevé un autre défi formidable : comment apprendre aux étudiants à créer rapidement de l’électronique. En 2002, Banzi, un architecte logiciel barbu et avunculaire (NDT : qui ressemble à un oncle) y a été amené par l’IDII en tant que professeur associé pour promouvoir de nouvelles approches pour la conception interactive — un champ naissant parfois connu sous le nom d’informatique physique. Mais avec un budget se réduisant et un temps d’enseignement limité, ses options de choix d’outils étaient rares.
Comme beaucoup de ses collègues, Banzi se reposait sur le BASIC Stamp, un microcontrôleur créé et utilisé par l’entreprise californienne Parallax depuis près de 10 ans. Codé avec le langage BASIC, le Stamp était comme un tout petit circuit, embarquant l’essentiel : une alimentation, un microcontrôleur, de la mémoire et des ports d’entrée/sortie pour y connecter du matériel. Mais le BASIC Stamp avait deux problèmes auxquels Banzi se confronta : il n’avait pas assez de puissance de calcul pour certains des projets que ses étudiants avaient en tête, et il était aussi un peu trop cher — une carte avec les parties basiques pouvait coûter jusqu’à 100 dollars. Il avait aussi besoin de quelque chose qui puisse tourner sur Macintosh, omniprésents parmi les designers de l’IDII. Et s’ils concevaient eux-mêmes une carte qui répondrait à leurs besoins ?
Un collègue de Banzi au MIT avait développé un langage de programmation intuitif, du nom de Processing. Processing gagna rapidement en popularité, parce qu’il permettait aux programmeurs sans expérience de créer des infographies complexes et de toute beauté. Une des raisons de son succès était l’environnement de développement extrêmement facile à utiliser. Banzi se demanda s’il pourrait créer un logiciel similaire pour programmer un microcontrôleur, plutôt que des images sur l’écran.
Un étudiant du programme, Henando Barragán, fit les premiers pas dans cette direction. Il développa un prototype de plateforme, Wiring, qui comprenait un environnement de développement facile à appréhender et une circuit imprimé prêt-à-l’emploi. C’était un projet prometteur — encore en activité à ce jour — mais Banzi pensait déjà plus grand: il voulait faire une plateforme encore plus simple, moins chère et plus facile à utiliser.
Banzi et ses collaborateurs croyaient fermement en l’open source. Puisque l’objectif était de mettre au point une plateforme rapide et facile d’accès, ils se sont dit qu’il vaudrait mieux ouvrir le projet au plus de personnes possibles plutôt que de le garder fermé. Un autre facteur qui a contribué à cette décision est que, après cinq ans de fonctionnement, l’IDII manquait de fonds et allait fermer ses portes. Les membres de la faculté craignaient que leurs projets n’y survivent pas ou soient détournés. Banzi se souvient : « Alors on s’est dit : oublions ça, rendons-le open source ! ».
Le modèle de l’opensource a longtemps été utilisé pour aider à l’innovation logicielle, mais pas matérielle. Pour que cela fonctionne, il leur fallait trouver une licence appropriée pour leur carte électronique. Après quelques recherches, ils se rendirent compte que s’ils regardaient leur projet sous un autre œil, ils pouvaient utiliser une licencesCreative Commons, une organisation à but non-lucratif dont les contrats sont habituellement utilisés pour les travaux artistiques comme la musique et les écrits. « Vous pouvez penser le matériel comme un élément culturel que vous voulez partager avec d’autres personnes. » argumente Banzi.
Le groupe avait pour objectif de conception un prix particulier, accessible aux étudiants, de 30$. « Il fallait que ce soit équivalent à un repas dans une pizzeria. » raconte Banzi. Ils voulaient aussi faire quelque chose de surprenant qui pourrait se démarquer et que les geeks chevronnés trouveraient cool. Puisque les autres circuits imprimés sont souvent verts, ils feraient le leur bleu ; puisque les constructeurs économisaient sur les broches d’entrée et de sortie, ils en ajouteraient plein à leur circuit. Comme touche finale, ils ajoutèrent une petite carte de l’italie au dos de la carte. « Une grande partie des choix de conception paraîtraient étranges à un vrai ingénieur », se moque savamment Banzi, « mais je ne suis pas un vrai ingénieur, donc je l’ai fait n’importe comment ! ».
Pour l’un des vrais ingénieurs de l’équipe, Gianluca Martino, la conception inhabituelle, entre chirurgie et boucherie, était une illumination. Martino la décrit comme une « nouvelle manière de penser l’électronique, non pas de façon professionnelle, où vous devez compter vos électrodes, mais dans une optique DIY ».
Le produit que l’équipe créa se constituait d’éléments bon marchés qui pourraient être trouvés facilement si les utilisateurs voulaient construire leurs propres cartes (par exemple, le microcontrôleur ATmega328). Cependant, une décision clé fut de s’assurer que ce soit, en grande partie, plug-and-play : ainsi quelqu’un pourrait la sortir de la boîte, la brancher, et l’utiliser immédiatement. Les cartes telles que la BASIC Stamp demandaient à ce que les adeptes de DIY achètent une dizaine d’autres éléments à ajouter au prix final. Mais pour la leur, l’utilisateur pourrait tout simplement connecter un câble USB de la carte à l’ordinateur — Mac, PC ou Linux — pour la programmer.
« La philosophie derrière Arduino est que si vous voulez apprendre l’électronique, vous devriez être capable d’apprendre par la pratique dès le premier jour, au lieu de commencer par apprendre l’algèbre. » nous dit un autre membre de l’équipe, David Cuartielles, ingénieur en télécommunications.
L’équipe testa bientôt cette philosophie. Ils remirent 300 circuits imprimés nus (sans composants) aux étudiants de l’IDII avec une consigne simple : regardez les instructions de montage en ligne, construisez votre propre carte et utilisez-la pour faire quelque chose. Un des premiers projets était un réveil fait maison suspendu au plafond par un câble. Chaque fois que vous poussiez le bouton snooze, le réveil montait plus haut d’un ton railleur jusqu’à ce que ne puissiez que vous lever.
D’autres personnes ont vite entendu parler de ces cartes. Et ils en voulaient une. Le premier acheteur fut un ami de Banzi, qui commanda une unité. Le projet commençait à décoller mais il manquait un élément majeur — un nom pour leur invention. Une nuit, autour d’un verre au pub local, il vint à eux : Arduino, juste comme le bar — et le roi.
Rapidement, l’histoire d’Arduino se répandit sur la toile, sans marketing ni publicité. Elle attira très tôt l’attention de Tom Igoe, un professeur d’informatique physique au Programme de Télécommunications Intéractives de l’Université de New York et aujourd’hui membre de l’équipe centrale d’Arduino. Igoe enseignait à des étudiants non techniciens en utilisant le BASIC Stamp mais fut impressionné par les fonctionnalités d’Arduino. « Ils partaient de l’hypothèse que vous ne connaissiez ni l’électronique, ni la programmation, que vous ne vouliez pas configurer une machine entière juste pour pouvoir programmer une puce — vous n’avez qu’à allumer la carte, appuyer sur upload et ça marche. » dit-il. « J’étais aussi impressionné par l’objectif d’un prix de 30$, ce qui la rendait accessible. C’était l’un des facteurs clefs pour moi. »
De ce point de vue, le succès de l’Arduino doit beaucoup à l’existence préalable de Processing et de Wiring. Ces projets donnèrent à Arduino une de ses forces essentielles : l’environnement de programmation convivial. Avant Arduino, coder un microcontrôleur nécessitait une courbe d’apprentissage difficile. Avec Arduino, même ceux sans expérience électronique préalable avaient accès à un monde matériel précédemment impénétrable. Maintenant, les débutants n’ont pas à apprendre beaucoup avant de pouvoir construire un prototype qui fonctionne vraiment. C’est un mouvement puissant à une époque où la plupart des gadgets les plus populaires fonctionnent comme des “boîtes noires” fermées et protégées par brevet.
Pour Banzi, c’est peut-être l’impact le plus important d’Arduino : la démocratisation de l’ingénierie. « Cinquante ans avant, pour écrire le logiciel, il vous fallait du personnel en blouses blanches qui savait tout sur les tubes à vide. Maintenant, même ma mère peut programmer. », développe Banzi. « Nous avons permis à beaucoup de gens de créer elles-même des produits ».
Tous les ingénieurs n’aiment pas Arduino. Les plus pointilleux se plaignent de ce que la carte abaisse le niveau créatif et inonde le marché des passionnés avec des produits médiocres. Cependant, Mellis ne voit pas du tout l’invention comme dévaluant le rôle de l’ingénieur : « il s’agit de fournir une plateforme qui laisse une porte entrouverte aux artistes et aux concepteurs et leur permet de travailler plus facilement avec les ingénieurs en leur communiquant leurs avis et leurs besoins ». Et il ajoute : « je ne pense pas que cela remplace l’ingénieur ; cela facilite juste la collaboration ».
Pour accélérer l’adoption d’Arduino, l’équipe cherche à l’ancrer plus profondément dans le monde de l’éducation, depuis les écoles primaires jusqu’aux universités. Plusieurs d’entre elles, dont Carnegie Mellon et Stanford, utilisent déjà Arduino. Mellis a observé comment les étudiants et les profanes abordaient l’électronique lors d’une série d’ateliers au MIT Media Lab. Mellis a ainsi invité des groupes de 8 à 10 personnes à l’atelier où le projet à réaliser devait tenir dans une seule journée. Parmi les réalisations, on peut noter des enceintes pour iPod, des radios FM, et une souris d’ordinateur utilisant certains composants similaires à ceux d’Arduino.
Mais diffuser la bonne parole d’Arduino n’est qu’une partie du travail. L’équipe doit aussi répondre aux requêtes pour les cartes. En fait, la plateforme Arduino ne se résume plus à un type de carte — il y a maintenant toute une famille de cartes. En plus du design originel, appelé Arduino Uno, on trouve parmi les nouveaux modèles une carte bien plus puissante appelée Arduino Mega, une carte compacte, l’Arduino Nano, une carte résistante à l’eau, la LilyPad Arduino, et une carte capable de se connecter au réseau, récemment sortie, l’Arduino Ethernet.
Arduino a aussi créé sa propre industrie artisanale pour l’électronique DIY. Il y a plus de 200 distributeurs de produits Arduino dans le monde, de grandes sociétés comme SparkFun Electronics à Boulder, Colorado mais aussi de plus petites strucutres répondant aux besoins locaux. Banzi a récemment entendu parler d’un homme au Portugal qui a quitté son travail dans une société de téléphonie pour vendre des produits Arduino depuis chez lui. Le membre de l’équipe Arduino Gianluca Martino, qui supervise la production et la distribution, nous confie qu’ils font des heures supplémentaires pour atteindre les marchés émergents comme la Chine, l’Inde et l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, près de 80% du marché de l’Arduino est concentré entre les États-Unis et l’Europe.
Puisque l’équipe ne peut pas se permettre de stocker des centaines de milliers de cartes, ils en produisent entre 100 et 3000 par jour selon la demande dans une usine de fabrication près d’Ivrea. L’équipe a créé un système sur mesure pour tester les broches de chaque carte, comme la Uno, qui comprend 14 broches d’entrée/sortie numériques, 6 broches d’entrée analogiques et 6 autres pour l’alimentation. C’est une bonne assurance qualité quand vous gérez des milliers d’unités par jour. L’Arduino est suffisament peu chère pour que l’équipe promette de remplacer toute carte qui ne fonctionnerait pas. Martino rapporte que le taux de matériel défectueux est de un pour cent.
L’équipe d’Arduino gagne maintenant suffisament pour payer deux employés à plein temps et projette de faire connaître de façon plus large la puissance des circuits imprimés. En septembre, à la Maker Faire, un congrès à New York soutenu par le magazine Make, l’équipe a dévoilé sa première carte à processeur 32 bits — une puce ARM — à la place du processeur 8 bits précédent. Cela permettra de répondre à la demande de puissance des périphériques plus évolués. Par exemple, la MakerBot Thing-O-Matic, une imprimante 3D à monter soi-même basée sur Arduino, pourrait bénéficier d’un processeur plus rapide pour accomplir des tâches plus complexes.
Arduino a eu un autre coup d’accélérateur cette année quand Google à mis à disposition une carte de développement pour Android basée sur Arduino. Le kit de développement d’accessoires (ADK) d’Android est une plateforme qui permet à un téléphone sous Android d’interagir avec des moteurs, capteurs et autres dispositifs. Vous pouvez concevoir une application Android qui utilise la caméra du téléphone, les capteurs de mouvements, l’écran tactile, et la connexion à Internet pour contrôler un écran ou un robot, par exemple. Les plus enthousiastes disent que cette nouvelle fonctionnalité élargit encore plus les possibilités de projets Arduino.
L’équipe évite cependant de trop complexifier Arduino. Selon Mellis, « Le défi est de trouver un moyen pour loger toutes les différentes choses que les personnes veulent faire avec la plateforme sans la rendre trop complexe pour quelqu’un qui débuterait. ».
En attendant, ils profitent de leur gloire inattendue. Des fans viennent de loin simplement pour boire au bar d’Ivrea qui a donné son nom au phénomène. « Les gens vont au bar et disent Nous sommes ici pour l’Arduino ! » narre Banzi. « Il y a juste un problème », ajoute-t-il dans un éclat de rire, « les employés du bar ne savent pas ce qu’est Arduino ! ».
 Stranger Than Paradise, Down by Law… quel choc narratif et esthétique que les premiers films de Jim Jarmusch[1] ! Toute ma jeunesse en somme…
Stranger Than Paradise, Down by Law… quel choc narratif et esthétique que les premiers films de Jim Jarmusch[1] ! Toute ma jeunesse en somme… L’histoire retiendra que c’est dans un bar d’une petite ville du nord de l’Italie qu’est né le projet
L’histoire retiendra que c’est dans un bar d’une petite ville du nord de l’Italie qu’est né le projet  Attention billet miné et sujet à polémiques !
Attention billet miné et sujet à polémiques !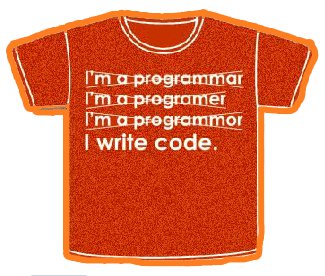 Outre sa dimension historique, culturelle et civilisationnelle, apprendre le latin c’est aussi mieux connaître les bases de notre langue française pour mieux la maîtriser.
Outre sa dimension historique, culturelle et civilisationnelle, apprendre le latin c’est aussi mieux connaître les bases de notre langue française pour mieux la maîtriser. Depuis plus d’un siècle les chiens du copyright aboient, la caravane qui transporte la création passe…
Depuis plus d’un siècle les chiens du copyright aboient, la caravane qui transporte la création passe… Bon ben voilà, c’est fait, le navigateur
Bon ben voilà, c’est fait, le navigateur  L’article que nous vous proposons traduit aujourd’hui est hors-sujet par rapport à ce que nous publions habituellement. Il est de plus sujet à caution car certainement un peu simpliste voire angélique dans son propos et ses arguments.
L’article que nous vous proposons traduit aujourd’hui est hors-sujet par rapport à ce que nous publions habituellement. Il est de plus sujet à caution car certainement un peu simpliste voire angélique dans son propos et ses arguments.