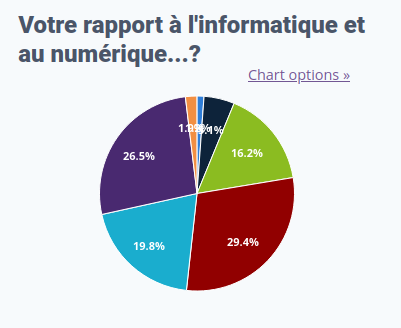Frama.space : du cloud pour renforcer le pouvoir d’agir des associations
Framasoft souhaite mettre à disposition, d’ici 3 ans, jusqu’à 10 000 espaces « cloud » collaboratifs, gratuitement, à destination des associations et collectifs militants. 40 Go et de nombreuses fonctionnalités à se partager entre 50 comptes sur un espace de type https://monasso.frama.space. … Lire la suite