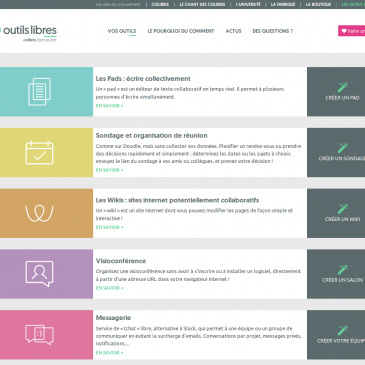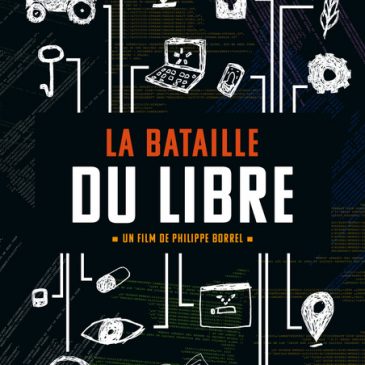Des Framapads plus beaux, grâce à une belle contribution
Framapad, c’est un de nos plus anciens services. C’est une page d’écriture, en ligne, ou vos ami·e·s peuvent venir collaborer en direct à la rédaction d’un texte. Un « Google docs », mais sans Google, sans pistage et même sans inscription !